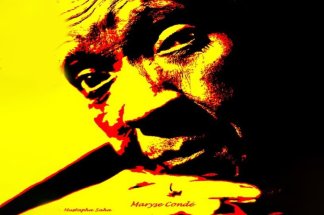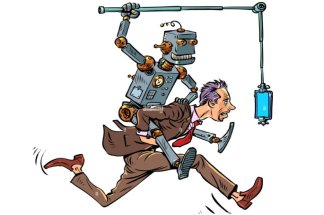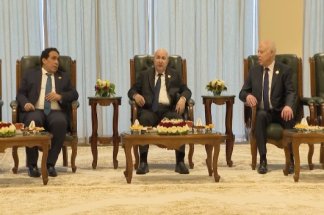chroniques
Le TAS ou l’atavique esprit de résistance

Paris. 18 Novembre 2019. Un ami de toujours m’informe par courriel de la victoire de l’équipe de football de deuxième division TAS à la finale de la Coupe du Trône face à la Hassania d’Agadir de première division. Contingence insignifiante à l’échelle mondiale, sacre historique pour les marocains. Les souvenirs d’enfance remontent volcaniquement à la surface. Le terrain d’Al-Hofra (le trou), surplombe l’école franco-musulmane. L’intitulé évite toute référence à la marocanité pour prévenir d’éventuelles contaminations nationalistes. Le lexique colonial, confessionnaliste à souhait, d’un côté les chrétiens, de l’autre côté les musulmans, ressuscite la nostalgie des croisades. La raison religieuse ne se discute pas.
.jpg)
Difficile d’imaginer à l’époque une cité plus surréaliste que les Carrières Centrales. Les bidonvilles labyrinthiques accueillent, dans la spontanéité solidaire, les ruraux proches et lointains. Les ruelles plongées dans la boue transforment la marche en acrobatie périlleuse. Les merveilleux patchworks de couleurs, les costumes ethniques, au milieu des djellabas noires et des haïks blancs, révèlent les provenances. Les Chaouis, les Abdis et les Doukkalis côtoient les Ouardighis, les Soussis et les Sahraouis. S’échangent, dans un babélisme indescriptible, les langues régionales et les parlures cantonales. L’interculturalité se tisse dans l’instantanéité coopérative. L’appellation même de bidonville aurait été forgée aux Carrières Centrales. A partir de 1937, l’hygiénisme révèle ses desseins eugénistes. Le contrôle des espaces urbains rejette les bidonvilles hors des villes sous prétexte d’une épidémie de typhoïde. Les bidonvilles sont dès lors catégorisés comme menaces politiques majeures.
Me reviennent des images inoubliables. Les minarets en planches de chantier surmontant les mosquées et les écoles coraniques de fortune. Les processions funèbres après les incendies spectaculaires, ponctuées de transes collectives et de pauses méditatives. Le deuil et la fête se partagent. La halqa permanente, école de la vie. Les couturières ambulantes pliées sur leur Singer à pédales. Les marchands d’escargots bouillis et salés à volonté. Les fumeurs de kif philosophant en petits cercles. Les dealers de galettes hachichées. Fatima Lahbila (Fatima La Folle) paradant sur son fiacre de bric et de broc, dialoguant avec des sirènes impalpables. Le conteur Khlifa enguirlandant la foule d’ironie socratique. Le justicier Miloud Laâraj distribuant ses larcins aux pauvres. Les kermesses équipées de montagnes russes et de manèges abandonnés par les français. Le petit drapeau marocain piqué sur avion miniature tricolore. Les casse-cous sur motos narguant les lois de la gravité sur les murs de la mort. Les écrivains publics, stoïques comme des yogis derrière leur écritoire, respectés comme des scribes égyptiens. Les vieux photographes encombrés de leur Brownie sur pieds. Les théâtres de plein air où Tayeb Saddiki repérant ses nouveaux comédiens. La troupe Hilal Dahabi (La lune dorée) initiant les jeunes aux arts vivants. Les meetings populaires où les figures historiques, Mehdi Ben Barka et Abderrahim Bouabid, Abdellah Ibrahim, la fine fleur politique des espérances avortées, exercent leur talent oratoire. Les chanteurs aveugles et les saltimbanques de passage. Les poètes de rue déclamant leurs amphigouriques messages. Les mendiants centenaires et les diablotins mercenaires. Les scènes ubuesques des chabakounis dans leurs uniformes débraillés, perdant leurs bérets verts en courant comme des dératés derrière des larrons filant comme des éclairs sur des vélos détraqués. Les mêmes bérets, ramassées à la hâte par des mains invisibles, se revendent aussitôt sous le manteau. Tout s’achète, tout se vend, tout se marchande, tout se vole, tout se donne en offrande. Une cour des miracle où se trament souterrainement les réseaux de la libération.
De l’autre côté de l’artère principale s’édifie, après l’indépendance, l’imposante mosquée Mohammed V, au milieu des ensembles d’habitations sociales de l’époque coloniale. Les Carrières centrales, rebaptisées Hay Mohammadi, deviennent le symbole de la révolution du peuple et du roi. Plus bas, le dispensaire communal où s’agglutinent, dès l’aube, des femmes et des marmots pour recevoir, en fin de journée, deux gouttes de collyre ou un comprimé d’aspirine. Le cinéma Saâda, inauguré en 1953, où les spectateurs mécontents jettent allégrement leurs chaussures contre l’écran. Dar Chouhada (la Maison des Martyrs) abritant dans la discrétion monastique les orphelins des combattants tombés pour l’indépendance. Des édifices de la terreur survivent à l’usure du temps. Les casernes coloniales et les geôles de la torture de sinistre mémoire.
Dar Chabab, (la Maison des Jeunes), complexe culturel conçu et réalisé au début des années cinquante par l’historien Guy Martinet, pépinière de tant de dramaturges, de cinéastes, d’écrivains, de musiciens, d’artistes dispersés aux quatre coins de la planète. Le financement de cette maison avant-gardiste de la culture est assuré par Jacques Lemaigre-Dubreuil, patron des Huiles Lesieur, un personnage étrange, passé de l’extrême droite au libéralisme anticolonial, mort à Casablanca en 1955, à l’âge de soixante ans, assassiné par l’horrible Main Rouge des Services secrets français. Guy Martinet se retrouve notre professeur, dans les années soixante, au lycée Moulay Abdellah. Nous l’attendons devant la porte de l’établissement pour décharger deux ou trois valises de livres de sa Citroën Traction Avant et les transporter jusqu’à sa classe, une spacieuse salle carrelée blanche de chimie. L’histoire se transmute en alchimie. Il nous distille la Révolution française minute par minute, dans la capitale et les provinces. Il nous transmet sa passion pour Jules Michelet. Les cours débordent doublement, triplement, la durée programmée.
Aux lendemains du protectorat, Casablanca s’industrialise à grande vitesse. S’installe, sur la route de Rabat, la zone industrielle, aussitôt embrumée de fumées toxiques et d’odeurs goudronneuses. Les grandes usines françaises de métallurgie, de sidérurgie, d’agroalimentaire, Les Ateliers du Chemin de Fer, La Compagnie sucrière marocaine de raffinage (Cosumar), La Centrale Laitière, Les Cimenteries Lafarge, se disputent le meilleurs emplacements. Les paysans marocains paupérisés, dépossédés de leurs terres par les colons, s‘expatrient vers la capitale, forment les premiers noyaux de la classe ouvrière qui conduira, trois décennies plus tard, la lutte pour l’indépendance. « Le prolétariat, et plus encore le sous-prolétariat, se constitue en campement autour de la ville. Il augmente la ville en même temps qu’il la défie » (Jacques Berque). Des cités ouvrières, à l’instar de Socica à Derb Chérif pour les travailleurs de Cosumar, sont construites pour fixer la main-d’œuvre. (Robert Montagne : Naissance du prolétariat marocain. Enquête collective entre 1948 et 1950. Editions Peyronnet, 1952).
La scolarisation s’impose comme unique voie pour sortir de la misère. La première école publique et laïque (Ecole Musulmane des Carrières Centrales de Derb Chérif) est ouverte en 1946. Idéologie hygiéniste oblige, les élèves reçoivent une douche hebdomadaire et des repas quotidiens gratuits. Le colonialisme s’est toujours prévalu d’une mission civilisatrice. Le parti de l’Istiqlal réplique par la création de la fameuse école privée Al Ittihad. La direction est confiée à Abderrahman Youssoufi. Le parti bourgeois de Fès, désirant devenir une organisation de masse, s’intéresse pour la première fois aux classes populaires, à la jeunesse prioritairement qu’il encadre dans les activités scolaires et sportives. Des sections de femmes voient le jour. Ces ruches éducatives seront les viviers du mouvement national.
Décembre 1952. Les Carrières Centrales déclenchent les premières manifestations contre l’assassinat du syndicaliste tunisien Farhat Hachad. La protestation pacifique est écrasée dans le sang. Trente-quatre manifestants sont tués. L’affaire fait grand bruit dans le monde. Les Carrières Centrales s’internationalisent. « Le Général Commandant Supérieur ordonne que les avions transportant la troupe d’Agadir survolent les Quartiers indigènes et que les Légionnaires se rendant à leurs Cantonnements défilent en ville, képi blanc bien apparent ». Les mitrailleuses et les chars légers ceinturent les bidonvilles. Les balles transpercent aveuglément les tôles ondulées. Les commerçants baissent leurs rideaux. Le pacha les somme de rouvrir leurs boutiques. Les choppes demeurés fermées sont démolies. Le 16 décembre 1952, terrible opération de ratissages, de perquisitions, d’arrestations. Les blessés sont traqués. Les hommes sans distinction sont embraqués. Les femmes sont violées. Les bijoux sont pillés. Les vieillards et les enfants sont piétinés. La violence punitive se double de répression judiciaire. La diagonale coercitive passe par les commissariats, les tribunaux et les prisons. Les tortures et les sévices physiques sont si fréquents qu’ils se signalent, sans suite, dans les rapports d’enquête. L’impunité des tirailleurs, des légionnaires, des commandos de marine est totale. Les dirigeants syndicalistes emprisonnés, Mahjoub ben Seddik et Mbarek ben Omar notamment, témoignent des graves agressions subies pendant leur arrestation et leur détention. Les partis et leurs publications sont interdits. Les leaders arrêtés sont accusés par les tribunaux militaires de complot et d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Le général et résident général Augustin Guillaume écrit au ministre des affaires étrangères : « Il s’agit bien d’une tentative d’insurrection, d’un mouvement prémédité et soigneusement préparé qui, s’il tend dans l’immédiat au massacre des chrétiens, a pour objectif l’abrogation du Protectorat ». La crise coloniale est marquée par l’émergence des français libéraux, soutenus en métropole par des chrétiens de gauche comme Louis Massignon et François Mauriac, qui dénoncent, sans ambages, les violences répressives et prennent ouvertement parti pour l’indépendance. Les Carrières Centrales reprennent clandestinement la lutte avec une génération plus jeune, prête à la résistance armée.
Le colonialisme est pris au piège de sa propre stratégie d’occupation et d’exploitation, la nécessaire croissance démographique des villes pour asseoir son emprise économique et l’impossibilité de contrôler les populations urbanisées et leur socialisation nationaliste. Les néo-citadins déjouent les définitions et les identifications des études coloniales, qui les caractérisent comme des êtres frustes, qui ne comprennent que le langage de la force. Le pouvoir colonial, engoncé dans son « paternalisme autoritaire au mépris de la légalité » (Charles-André Julien), s’enferme dans la logique répression-radicalisation. Se préconise dans une note de décembre 1950 du 3ème bureau de l’état-major « un défilé des bataillons sénégalais sur des itinéraires choisis en fonction de la démonstration que l’on désire faire ». Le massacre d’une centaine de marocains désarmés dans le quartier casablancais de Ben M’Sik, perpétré le 8 avril 1947 par des tirailleurs sénégalais en permission, est gravé dans la mémoire collective comme un traumatisme indélébile. L’amalgame entre nationalisme et criminalité décline son indigence argumentaire. « L’influence du parti de l’Istiqlal tient moins au nombre de ses adhérents, proportionnellement faible, qu’à la détermination de ses troupes de choc composées, soit de voyous des différents quartiers et en particulier des Carrières centrales, soit de jeunes garçons fanatisés dans les écoles, qu’à la discipline de ces troupes, et surtout à la crainte qu’elles inspirent » (Rapport du capitaine de la Porte des Vaux : « Le Parti de l’Istiqlal à Casablanca », juillet 1953).
Les origines du TAS (Tihad Athlétic Sport) s’inscrivent dans cette histoire libératoire. Le club est créé en 1947 par le militant M’Hamed EL Abdi comme véhicule de lutte contre le colonialisme. M’Hamed El Abdi et Abdessalam Bennani bravent l’administration coloniale et sa Ligue sportive de football aux pratiques ségrégationnistes, instituent la Ligue libre rassemblant les équipes des quartiers populaires. Une expérience prodromique de la transversalité. L’équipe s’identifie après l’indépendance à la personnalité de Larbi Zaouli, irréfutable autorité morale, incontournable stéthoscope du pouls social. Les joueurs de légende les années soixante, Noumir, bouassa, Ferhat, Khalifa, Lachgar, Bouchaïb, Meskini, Bahssine, sont de figures de proue du militantisme local. La dream team de la banlieue casablancaise draine une réputation d’obstacle infranchissable, une mythologie d’indomptable périphérie. La victoire footballistique des tassis, au moment où le monde bascule dans une nouvelle ère, sonne comme un signal d’une nouvelle résistance, un présage d’émancipation civile, pour reconstruire une commune exemplaire, digne de son histoire.
Mustapha Saha
Sociologue, écrivain, artiste peintre