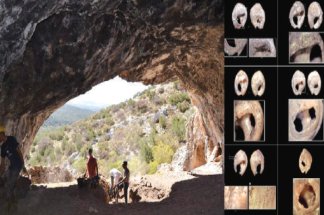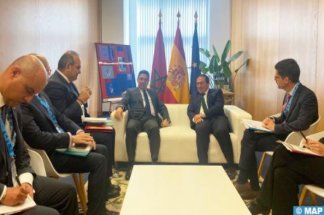Actu
Au Caire, les enfants des rues victimes collatérales de la pandémie

Mère adolescente et vendeuse de mouchoirs sur un coin de trottoir cairote, Zeinab est partagée quant aux effets de la pandémie de coronavirus sur sa situation et celle des milliers d'autres enfants des rues.
"Les gens nous agressent moins parce qu'ils ont peur (d'être contaminés), mais on a moins de travail et moins d'argent", résume la jeune femme, rencontrée dans un véhicule refuge pour les démunis à Abbassiya (est du Caire), tout en surveillant du coin de l'oeil son bambin d'un an.
En Egypte, pays de 100 millions d'habitants où près d'un tiers de la population vit officiellement sous le seuil de pauvreté, les enfants des rues occupent le bas de l'échelle sociale et sont exposés à des violences verbales, physiques et sexuelles.
La maladie progresse dans le pays avec quelque 900 nouvelles infections quotidiennes. Au total, le bilan sanitaire s'élève à près de 84.000 infections dont plus de 4.000 décès.
Stigmatisés et isolés
Jour et nuit, ces enfants ramassent les ordures, travaillent dans des parkings ou mendient quelques pièces en échange de mouchoirs en papier.
Certains vivent sous un toit familial dans les quartiers défavorisés de la capitale, d'autres sont sans-abris, en rupture avec leurs proches. En revanche, beaucoup sont scolarisés, selon la chercheuse Mariam Hichem.
Stigmatisés, "ils sont isolés, la population les évite (...) et leurs revenus ont diminué", affirme Youssef Bastawrous, un responsable de l'ONG Samusocial International.
En 2014, les autorités les évaluaient à environ 16.000 dans le pays, une "sous-estimation" de leur nombre réel, selon Jonathan Crickx, responsable de la communication au bureau local du Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef).
Souvent issus de plusieurs générations d'enfants des rues, la plupart d'entre eux sont absents des registres de l'état civil, ce qui rend les statistiques parcellaires.
Doté de 17 unités mobiles qui vont à leur rencontre, le programme national "Atfal bala ma'wa" ("Enfants sans abri"), lancé en 2016, vise à les "intégrer" et à "leur faire abandonner les comportements de la rue", explique Mohamed Chaker, responsable au ministère de la Solidarité sociale.
Venu se changer les idées et prendre une collation, Karim, qui affirme avoir 12 ans, est un habitué du véhicule refuge d'Abbassiya.
"Je viens ici pour jouer. (...) L'école me manque. Depuis qu'elle a fermé, j'ai tout oublié. Avant, j'apprenais à lire et à compter", regrette le petit garçon chétif, qui dort dans un parc du quartier et gagne son pain en nettoyant des pare-brises de voitures.
Fin mars, les établissements scolaires égyptiens ont fermé, pour lutter contre le virus.
Par ailleurs, la pandémie a affecté l'aide humanitaire proposée à ces enfants. Et la récession économique a engendré une "baisse du financement" des associations, selon l'Unicef.
Contraints de limiter leurs activités nocturnes notamment durant le couvre-feu en vigueur entre mars et juin, les ONG et le ministère ont mis l'accent sur leurs services médicaux.
Quotidien bouleversé
"Nous les sensibilisons aux enjeux sanitaires, nous distribuons des masques et leur expliquons comment se laver les mains", a ajouté M. Bestawrous.
Fin juin, les autorités ont décidé de rouvrir partiellement les mosquées, les cafés et les restaurants, les lieux culturels, et d'annuler le couvre-feu.
Si ces mesures ont pu profiter aux enfants, la fermeture des mosquées en dehors des horaires de prières a bouleversé leur quotidien, estiment MM. Bestawrous et Chaker.
Grâce à leurs salles d'eau accessibles à tous, ces lieux constituent des points névralgiques pour les enfants, car ils leur procurent un minimum d'hygiène quotidienne.
En cette période incertaine, ils sont vulnérables à la maladie et souvent ciblés par les tracasseries des autorités, estime Mme Hichem.
Jugeant l'initiative "Atfal bala ma'wa" limitée, elle considère que l'Etat, qui s'emploie surtout à "éradiquer le phénomène", n'aide pas vraiment les enfants.
Plutôt floue, la législation antimendicité rend déjà leur présence dans la rue illégale et de futures mesures sanitaires pourraient aggraver le risque d'arrestation, avertit la chercheuse.
"Les policiers les traitent déjà comme des déchets", déplore-t-elle.