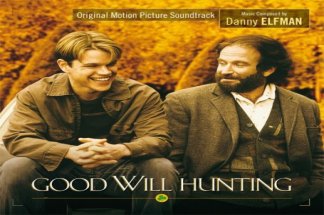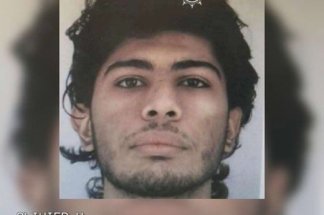chroniques
L’exil comme royaume, la littérature comme refuge : entre errance et création – Par Abdejlil Lahjomri

’’L’exil. Un mot simple en apparence, mais chargé de significations profondes. Il évoque la séparation, le déracinement, la nostalgie, mais aussi l’adaptation, la transformation et l’obligation de se déplacer, quand une hostilité imprévue, se manifeste’’ (Abdeljlil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume)
À l’heure où les frontières se durcissent et où l’accueil se fait rare, un colloque de l’Académie du Royaume sur la littérature diasporique ravive les réflexions sur l’exil. Entre mémoire, douleur, créativité et renaissance, les voix de la diaspora réécrivent le monde en quête d’ancrage. L’hommage à Zaghloul Morsy, auteur d’Ishmaël ou l’exil, offre une résonance poignante à cette traversée des mots et des mondes. Le discours d’ouverture de Abdeljlil Lahjomri, d’une grande richesse intellectuelle, émotionnelle et littéraire, dans un style à la fois lyrique, méditatif, érudit et engagé, permet au Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume d’interroger notre rapport à l’identité, à la mémoire, à la littérature et à la justice.
Un colloque pour penser l’exil dans un monde en mutation
Le colloque sur « L’exil n’est pas notre royaume : réflexions sur la littérature diasporique », conforme à la mission assignée à notre institution royale et académique, invite à réfléchir aux questions de notre temps. Notre époque est bouleversée. Même le soleil d’Afrique, pourtant si ardent et lumineux, paraît voilé, enveloppé par les nuages du doute qui s’étendent de toutes parts. L’horizon, au lieu d’annoncer des rencontres bienveillantes et protectrices, devient un espace où le voyageur espère, au-delà des montagnes, percevoir l’écho d’un frère ou d’une sœur en humanité. La tension s’accroît. Les barricades s’élèvent, la joie d’accueillir s’affaisse. Mais ce n’est pas la règle ici, dans cette institution où l’accueil se veut enrichissant, joyeux et prometteur d’aspirations fécondes.
Ce colloque consacré à la littérature diasporique et aux représentations de l’exil tombe à point. Il évoque « Roots » la poignante fresque de Kunta Kinté, décrivant une famille noire américaine au temps de l’esclavage, publiée en 1976 par Alex Haley - ce brillant écrivain qui fut membre de notre Académie aborde une échappatoire à l’exil.
Il est d’actualité pour plusieurs raisons.
La première est une méditation sur le temps long, sur les fractures qui ont ouvert dans l’Histoire, dans nos cœurs africains, une immense désespérance, à cause du départ forcé, involontaire, subi par des millions d’hommes et de femmes arrachés à la douce cadence de leurs terroirs pour des terres d’errance et de tremblements. Ensuite, nous qui réfléchissons sur le devenir et les perspectives océaniques, comment ne pas repenser, douloureusement, à ceux qui ont péri au fond des mers quand les tempêtes ou le désespoir interrompaient leur tragique voyage ? Troisièmement, ce colloque est une prière de refus de la déportation. L’argument mercantile l'utilisa pour modifier les trajectoires comme les destins. "Toute vie est une vie", proclame la Charte du Mandé.
Je tiens à saluer avec toute l’intensité de la fraternité en acte, Le Président, et surtout le frère de retour, Dr Mark Brown, sur le sol africain, en cette partie du nord, qu’il découvre, lui et son épouse, au cœur d’une délégation venue de l'Alabama. Je tiens à saluer et à remercier, profondément, chaleureusement, tous les chercheurs, écrivains et penseurs réunis ici pour réfléchir à un sujet universel et intemporel : « L’exil ».
L’exil. Un mot simple en apparence, mais chargé de significations profondes. Il évoque la séparation, le déracinement, la nostalgie, mais aussi l’adaptation, la transformation et l’obligation de se déplacer, quand une hostilité imprévue, se manifeste. Parfois même, ce mot, exil, peut signifier le repli sur soi : la liberté. Il constitue aussi, chez certains, une épreuve, voire une nécessité d’aller pour parler à ceux que l’on ne voit pas et qui jettent sur les routes, les mers, les airs, un envoyé, un missionné, un diplomate. Ce dernier a pour rôle de maintenir un lien, de tendre la main et de coopérer.
L’exil : douleur, rupture, mais aussi renaissance
Nous le voyons, l’exil est une expérience douloureuse pour certains, une opportunité de renouveau pour d’autres. Dans tous les cas, il renvoie à une rupture qui redéfinit le rapport au monde, aux autres et à soi-même.
Dans l’histoire africaine comme ailleurs, l’exil a ses causes : guerres, crises politiques, colonisation, effacement de ce que l’Histoire et la géographie ont établi et que la géopolitique vient bouleverser. Mais l’exil, quand il n’est pas un bannissement, quand il apparaît comme une exploration destinée à rendre compte de la grandeur de la création, ou comme une initiation à la féérie du monde, peut aussi être un choix, celui de partir à la rencontre d’autres horizons, pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives. Quelle qu’en soit la raison, il transforme irrémédiablement les individus, interrogeant le sens de l’appartenance et la notion même de « chez soi ».
Depuis toujours, la littérature est un espace où s’écrit l’exil. Des traditions orales africaines aux œuvres contemporaines, l’exil est une source inépuisable d’inspiration. Les écrivains en exil y trouvent un moyen de transcender la douleur du départ, de donner une voix à leur errance et de recréer, à travers les mots, un lieu d’ancrage.
Les auteurs de la diaspora, en particulier, portent cette double mémoire : celle de leur terre d’origine et celle du lieu d’accueil. À travers leurs récits, ils tissent des ponts entre les cultures, réconcilient les langues et transforment la perte en espace de création. Loin d’être un enfermement, leur écriture de l’exil devient une nouvelle manière d’habiter le monde, d’interroger les identités et de sillonner des territoires inédits de la pensée et de l’écriture.
Si l’exil est souvent perçu comme une fracture, il est aussi une force de renouvellement. Il pousse l’écrivain à interroger son rapport à la langue, à inventer de nouvelles formes littéraires, à faire dialoguer ses racines et son présent. Certains jonglent entre plusieurs langues, d’autres réinventent le rythme et la structure du récit, et tous explorent de nouvelles façons de dire l’entre-deux, la distance, l’éloignement, mais aussi la passerelle, le lien, les épreuves, et les possibilités de les transcender.
Ce colloque nous invite à explorer ces multiples dimensions de l’exil à travers l’exercice du récit. Nous interrogerons la manière dont il façonne l’écriture, comment il se vit dans les œuvres et comment il éclaire les dynamiques contemporaines de la migration et de l’identité. En mettant en regard différentes expériences et sensibilités, nous tenterons de mieux comprendre la richesse et la complexité de ces écritures en mouvement, en mutation, en transformation, en synergie, en survie.
Zaghloul Morsy : l’exil à l’œuvre, l’œuvre en exil
Mais au-delà d’une réflexion académique, cette rencontre est aussi un espace de dialogue. Car si l’exil est une séparation, il sollicite aussi la rencontre. Il nous rappelle que les identités ne sont pas figées, qu’elles se nourrissent du voyage, de l’échange et de la découverte de l’autre. La littérature diasporique est le témoin de cette ouverture, de cette capacité à dépasser les frontières et à créer des espaces de transmission et de partage.
J’ai commencé ce propos par vous faire part de l’émotion toute particulière que je ressens en vous souhaitant la bienvenue. Mais c’est avec une gravité toute particulière que je conclus mon intervention, et je prends la liberté de profiter de cette opportunité pour réparer ce qu’une mémoire oublieuse, a opéré, en fermant de la prospérité, en les verrouillant, en exilant le roman global magistral de mon maître (de nôtre maître) Zaghloul Morsy qui s’intitulent justement : « Ishmaël ou l’exil ».
Offrez-moi quelques minutes pour rendre hommage à mon maître, et surtout pour ouvrir une porte et évoquer cette œuvre qui porte le titre de notre colloque.
Dans l’intéressante présentation que Salim Jay fait du roman de l’auteur doublement exilé Zaghloul Morsy « Ishmael ou l’exil » dans son « dictionnaire des écrivains marocains », cet analyste emploie à juste titre l’expression de « fiction totale » je dirai, « roman global ». Ce récit qu’il nous convie à considérer comme un événement d’importance est malheureusement resté méconnu par la critique et le grand public. Au Maroc aussi bien qu’en France. Destiné, comme certains l’ont cru, à devenir un best-seller, ce roman ne le fut pas.
La postérité a de ces tours et détours bien impénétrables. Je suis de ceux que Salim Jay dit qu’ils attendent « qu’un roman embrassât le spectre des couleurs, des humeurs, des songes et des réalités de ce pays ». « Ishmael ou l’exil » est-ce roman-là. Il ressuscite les années soixante, décrit avec une nostalgie amère l’affaissement et le découragement d’une société, ses utopies et surtout ses désillusions, ses doutes, ses effrois, dans une tentative désespérée de reconstitution de soi, par une introspection douloureuse, pathétique.
A partir d’une passion amoureuse d’un couple impossible et clandestin entre un arabe et une juive dans ce Maroc des émeutes du lendemain de l’indépendance, Maroc des turbulences, des affrontements idéologiques, des angoisses individuelles et collectives, des errements de l’identité, des enjeux du sacré et du non sacré, du conflit des langues, de la guerre des signes et des symboles, Zaghloul Morsy construit un roman polyphonique qui peut décourager le lecteur par l’usage fréquent de mots et d’images rares. Mais pour le lecteur patient, c’est un feu d’artifice poétique et enivrant.
Une langue entre silence, vertige et expulsion
L’ouvrage est resté méconnu à cause probablement de cette effervescence linguistique, de cette surprenante ivresse des mots, qui n’étonneront pas quiconque connait Zaghloul Morsy. Sommes-nous toujours en présence du poète Morsy : auteur de « Soleil réticent » et du « Gués du temps », qui n’a pas su se débarrasser ni se libérer de l’emballement et de l’engouement poétiques pour maitriser la construction romanesque ? Peut-être. Mais la réussite créatrice est là que n’ont perçue ni les critiques pressés ni les jurys sous influence.
Pour l’apprécier, il faudra prendre le temps d’en extraire le substantifique élixir. Ce temps-là manque, dont pourraient bénéficier les doctorants des départements littéraires si ces départements enseignaient encore les subtilités du discours « littéraire ». Autrement ce roman, un des rares à mériter figurer dans les programmes d’études universitaires, finira exiler dans « l’enfer » des bibliothèques. L’exil à la fin du roman ne sauvera pas cette passion tumultueuse des fins tragiques qui guettent tout amour impossible. Depuis la publication en 2003 de son roman, Zaghloul Morsy s’est muré lui aussi dans le silence assourdissant de son incompréhensible exil. Il est décédé, il y a quelques années trois fois exilé, puisque reste dans sa mort, oublié au Maroc, oublié en France.
Les rares critiques qui ont étudié ce récit n’ont accordé que peu d’intérêt à l’énigme du titre. Le nom d’Ishmael figure peu dans le cours du roman. Le personnage principal s’appelle d’ailleurs Husseyn. Et la référence à l’Ishmael des légendes prophétiques répond à l’appel de Zaghloul Morsy qui exhortait tout écrivain maghrébin de langue française à ne s’aventurer dans l’écriture que quand elle pouvait prendre en charge l’héritage historique de son être, de sa nation, tous entiers. C’est le sens du titre. Ishmael est l’enfant de l’exil, né pour s’expatrier, vivre dans l’exil. « L’expulsion commence par la question du nom », écrit Houria Abdelouahed, dans « Figures du féminin en Islam ».
Le nom d’Ishmael est donc synonyme d’expulsion, d’exil, d’expatriation. Obéissant à l’injonction d’Abraham, c’est ce que fera le fils avec sa mère Hajar. Obéissant à l’injonction de la langue de l’autre, de l’école de l’Autre, celle qui a « submergé son âme », et « triomphé de lui », c’est ce que fera le personnage principal de ce roman troublant « marchant au nord » et « pliant à ce qu’il doit bien à la fin accepter, l’exil ».
La langue de l’Autre qui est langue d’expulsion, Zaghloul Morsy l’a voulue dans son exil semblable malgré tout à sa langue d’avant l’exil. Paradoxe insoutenable.
« Par l’Alif et par l’Y brisé ici prend fin et se perd le chemin partagé à la frontière des deux mondes », écrit-il dans les dernières pages. Accent déroutant de la langue d’origine dans la langue de l’Autre. Ce roman est aussi le roman des finitudes parce qu’il est le récit de la fin d’un monde, d’une écriture. Autour de nous la langue qui décrira le monde nouveau n’a pas encore été inventée. Zaghloul Morsy nous le démontre avec « Ishmael ou l’exil ». La littérature maghrébine de langue française demeure une déambulation vertigineuse entre deux mondes, deux langues, deux exils.
Que dit-il à la fin ?
« Je serai ce poète qu’ils méprisent et redoutent avec ce dont ils ne m’ont pas dépossédé, l’œil et la main licière, l’œil qui écoute et survole, la main qui tisse et suscite sur le même canevas vierge l’exact et double dessein magnétique, immobile, et mouvant, siamois, et exclusif, celui de l’arachnide androgyne, architecte et stratège du silence ».
Il s’est tu, a choisi l’exil comme royaume et le silence comme épitaphe.