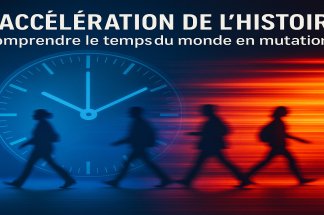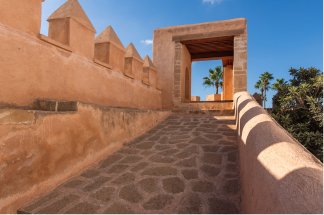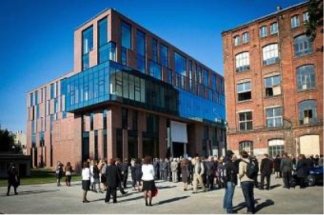Culture
Mohamed Choukri, la liberté de l’âme plutôt que le poids du mariage – Par Hatim Betioui

Sa relation fusionnelle, Mohamed Choukri l’avait avec sa ville, Tanger
Dans un entretien publié le 30 mars 1990 dans le magazine Asharq Al-Awsat, l’écrivain marocain Mohamed Choukri, disparu en 2003, revenait sur son choix de rester célibataire. D’une lucidité désarmante, il confiait à Hatim Betioui avoir pensé au mariage, mais en avoir toujours fui les implications sociales et affectives. À travers son parcours, écrit Hatim Betioui, il rejoignait la longue lignée des écrivains et penseurs qui ont fait de la solitude une philosophie de vie.

« Je ne cherchais pas une épouse, mais une infirmière »
Lors de cet entretien, Mohamed Choukri confiait avoir envisagé le mariage à plusieurs reprises, principalement pour combler une solitude qu’il n’avait jamais vraiment apprivoisée. À l’origine de cette envie : la maladie, et le besoin d’avoir quelqu’un à ses côtés pour s’occuper de lui et gérer les tâches du quotidien. Mais très vite, il prit conscience que ce type de motivation relevait plus de la recherche d’une infirmière que d’une épouse. Une erreur de perspective qui le fit renoncer à l’idée.
À chaque tentative d’engagement, Choukri racontait s’être heurté à des situations désillusionnantes. Une fois, il réalisa qu’un mariage avec une femme salariée revenait à une union entre deux fiches de paie… mais aussi avec une ribambelle de proches qu’elle « traînait derrière elle comme une locomotive ». Une autre fois, c’est une serveuse de bar qu’il envisagea d’épouser, jusqu’à ce qu’elle lui explique qu’elle avait besoin de cinquante dirhams par jour pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères — une somme qu’il ne pouvait se permettre.
Au-delà des aspects matériels, Choukri évoquait la jalousie qu’il observait dans les couples mariés autour de lui. Il parlait de ses amis écrivains, brillants avant leur mariage, devenus inactifs ou malheureux après. Il craignait que le mariage n’éteigne en lui cette flamme créative qu’il considérait vitale. « Si j’avais épousé une femme capable de me porter malheur à ce point, tu aurais trouvé un nid de rides sur mon visage », ironisait-il.
Entre solitude choisie et paternité refusée
Interrogé sur la question de la paternité, Choukri répondait avec détachement : « Je ne ressens aucun manque, ni du côté du mariage, ni de celui de la paternité. Les enfants des autres sont aussi un peu les miens. » Pour lui, le lien familial n’était pas un idéal à atteindre, mais un poids dont il se méfiait, nourri par les conflits familiaux douloureux vécus dans son enfance.
En revanche, Choukri affirmait s’être marié — mais pas à une femme. Son union, disait-il, était avec la ville de Tanger, qu’il qualifiait de « mariage catholique » : sans divorce possible, même en cas de séparation. Il décrivait une relation fusionnelle avec la ville : ses ruelles, ses cafés, ses bars et ses habitants, tous constituaient pour lui une toile vivante de sens et d’attachement.
Une tradition de grands solitaires
Choukri n’est ni le premier ni le dernier intellectuel à avoir choisi la voie de la solitude consciente. Il citait volontiers Socrate et sa célèbre maxime : « Mariez-vous : si vous avez une bonne épouse, vous serez heureux ; si elle est acariâtre, vous deviendrez philosophe. » D’autres, comme le poète Abou Al-Alaa Al-Maari, refusaient le mariage par conviction philosophique, dénonçant l’injustice de faire naître un enfant dans un monde de souffrance.
Emmanuel Kant, le rigoureux philosophe allemand, rejetait le mariage pour préserver son rythme intellectuel. Arthur Schopenhauer, farouchement misogyne, considérait l’union conjugale comme une aventure vouée à l’échec. Quant à Friedrich Nietzsche, son célibat fut surtout dicté par ses tourments psychiques et les refus qu’il essuya auprès des femmes. Franz Kafka, malgré plusieurs fiançailles, résuma sa position d’un trait : « Je ne suis pas fait pour le mariage. Tout ce que je veux, c’est être seul. »
Dans leurs pas, Mohamed Choukri revendiquait sa solitude comme un choix d’indépendance, un refus du compromis affectif et social, et un acte de fidélité à sa nature profonde. Comme un cri commun des âmes libres : unité, liberté, célibat.