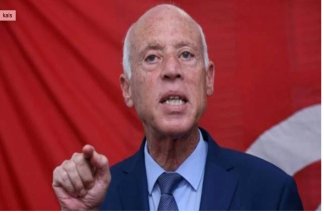chroniques
Inde-Pakistan : Un conflit qui perdure sur fond d’héritage colonial - Par Samir Belahsen

Des policiers indiens montent la garde alors qu'une femme marche dans une rue de Srinagar le 9 mai 2025. Les affrontements meurtriers entre les deux pays dotés de l'arme nucléaire ont suscité des appels au calme à l'échelle mondiale (Photo Sajjad HUSSAIN / AFP).
Une nouvelle flambée de violence ravive le conflit indo-pakistanais après un attentat meurtrier au Cachemire. Alors que les deux puissances nucléaires échangent tirs et accusations, la communauté internationale appelle à la désescalade. Derrière cette crise, explique Samir Benlahsen, se profilent les cicatrices encore vives de la Partition de 1947, dont les drames humains et géopolitiques continuent d’alimenter les tensions. De la guerre de 1947 aux œuvres littéraires poignantes qui en témoignent, l’histoire reste au cœur du brasier cachemiri.

« Elle (l’histoire) consiste à méditer, à s'efforcer d'accéder à la vérité, à expliquer avec finesse les causes et les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le comment des événements. L'histoire prend donc racine dans la philosophie, dont elle doit être comptée comme une de ses branches. »
Ibn Khaldoun
« Ce qui est vérité pour l’un peut être erreur pour l’autre. »
Gandhi
Le conflit entre l'Inde et le Pakistan revient à l’ordre du jour après l’attaque du 22 avril contre des touristes… L’attentat au Cachemire indien a eu pour conséquence une escalade militaire avec des frappes mutuelles et des tirs d'artillerie.
La communauté internationale, s’inquiète et appelle à la désescalade et à la retenue. Les compagnies aériennes suspendent le survol du Pakistan.
Si l'Inde affirme avoir, seulement, frappé des camps terroristes au Pakistan, le Pakistan l’accuse d'avoir endommagé un barrage hydroélectrique au Cachemire.
A la source, il y a bien entendu, l'attentat mais aussi la suspension du traité de partage des eaux de l'Indus.
La Chine et la Russie se disent prêtes à jouer un rôle constructif dans l'apaisement, Berlin, Paris, Londres…et Téhéran appellent à la désescalade.
L’Histoire
Quand l’empire colonial britannique de l’Inde accède à l’indépendance en 1947, il est scindé en deux : le Pakistan destiné à regrouper la population musulmane (avec un territoire scindé lui-même en deux parties l’ouest, et l’est) ; et l’Inde, à majorité hindoue.
Malgré les grands déplacements de population qui l’ont précédée (on cite le chiffre15 millions de personnes déplacées), cette « partition » a laissé d’importantes minorités religieuses « mal situées », une forte minorité hindoue au Pakistan, et une forte minorité musulmane en Inde.
Le Cachemire et la guerre de 1947
La bombe à retardement héritée de la partition était l’Etat princier du Cachemire, situé au nord de l’Inde et à forte majorité musulmane. Au moment de l’indépendance il était dirigé par un prince hindou. Dès les premiers troubles le prince demande l’aide de l’Inde qui la lui accorde, puis intègre le royaume à l’Union indienne. Le Pakistan ne le tolère pas et intervient. C’est ce que l’on a appelé la première guerre indo-pakistanaise de 1947-1949.
Le cessez-le-feu est imposé par les Nations unies et le Cachemire historique est scindé entre d’une part, à l’ouest et au nord, une partie pakistanaise ; et d’autre part, au Sud, une partie indienne.
Une deuxième guerre indo-pakistanaise éclate en 1965 avec le Cachemire pour enjeu. Le nouveau cessez-le-feu imposé par la communauté internationale implique un retour aux frontières précédentes.
Le Bangladesh et la guerre de 1971
La troisième guerre indo-pakistanaise a éclaté en 1971. L’est du Pakistan s’était soulevé contre le pouvoir « central » pakistanais, ce qui finira par l’indépendance du Bangladesh. L’Inde soutient ce mouvement indépendantiste.
À partir de 1998, les deux pays disposent de l’arme nucléaire. Dès lors les tensions autour du Cachemire, font craindre le pire.
Depuis le début du siècle, l’implication de groupes islamistes, plus ou moins soutenus par le Pakistan, plus ou moins contrôlés par les services Pakistanais complique d’avantage la situation.
En même temps, du côté indien, la montée du parti BJP, parti religieux qui revendique la nature hindoue de l’Inde, ravive les tensions entre les hindous et les musulmans.
La dimension religieuse du conflit entre l’Inde et le Pakistan devient plus réelle.
Aucun des deux pays n’a réellement intérêt à un conflit majeur, notamment du fait du risque nucléaire. Les deux pays ont des raisons de rechercher une solution pacifique, les grandes puissances s’y mettent mais trouver l’équilibre entre deux puissances d’un tel calibre semble relever de la gageure.
Et la littérature !
Plusieurs œuvres romanesques évoquent la Partition de l’Inde de 1947.
La plus connue, peut - être est « Pinjar » d’Amrita Pritam (1950) traduit en français sous le titre « Pinjar le squelette » par Denis Matringe et publié uniquement en 2003 est un roman historique en langue pendjabi se déroulant au Pendjab et s'achevant en 1947, à l'époque de la Partition. À travers le drame d'une jeune fille hindoue enlevée par un musulman, ce roman tentait d’illustrer les tensions communautaires, les violences et les traumatismes de cette période.
Le roman a été adapté au cinéma en 2003 dans un film hindi intitulé Pinjar, réalisé par Chandraprakash Dwivedi.
Côté Pakistanais, on peut citer le roman « La fiancée pakistanaise » de Bapsi Sidhwa, auteure pakistanaise écrivant en anglais qui a été traduit en français par Christine le Bœuf. Il aborde les conséquences de la Partition et les tensions communautaires.
Une petite orpheline victime de la partition, originaire du Panjab, est adoptée par Qasim, un montagnard qui a lui-même perdu femme et enfants. Des années après les événements, il la donne en mariage à un homme de sa tribu. Ils remontent ensemble le temps refont alors le chemin vers la haute vallée de l'Indus. Quand ils arrivent, les noces tournent à la tragédie...L’impossible réconciliation !
Plus complet et plus objectif « Les Voix de la Partition Inde/Pakistan » d’Urvashi Butalia, traduit par Françoise Bouillot, il rassemble des témoignages bouleversants des deux côtés de la frontière. Une longue enquête a permis à Urvashi Butalia de reconstituer le vécu et les conséquences dramatiques, à l’échelle individuelle, de ce gigantesque traumatisme collectif. Il a réussi à briser le silence et à rendre leur voix aux petites gens, marginaux et membres de castes opprimées et oubliés par les comptes rendus historiques.
Les témoignages rapportés sont justes, vraies, simples et pudiques, ils remettent en cause, du moins pour moi, « la sacralité » supposée des ingénieurs de la partition…
La partition de l’Inde aura provoqué l’une des plus grandes convulsions de l’histoire : Entre douze et quinze millions de personnes ont été déplacées, plus d’un million de morts, des milliers de femmes violées, des familles séparées et des foyers de tensions qui perdurent…