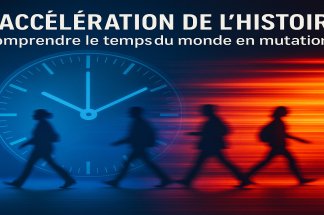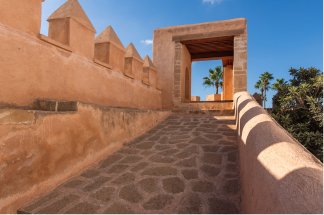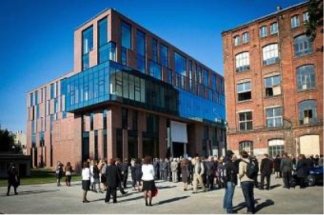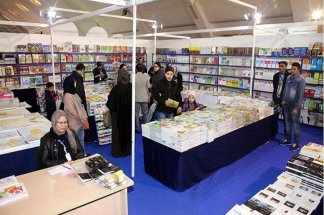Culture
Corruption, entre science et fiction : une plongée sociologique et littéraire avec Françoise Dreyfus - Par Samir Belahsen

La corruption implique toujours « invariablement » un système d'échange, un abus de pouvoir et une action engageant deux parties
Dans La sociologie de la corruption, Françoise Dreyfus explore la corruption comme un phénomène social global, aux dimensions politiques, économiques et culturelles. Samir Belahsen nous invite à réfléchir à travers cet ouvrage rigoureux, tout en revenant sur son écho dans la littérature, de Molière à Dostoïevski. Une analyse riche qui dévoile les mécanismes, les perceptions et les représentations multiples d’un fléau enraciné.

« Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude, il leur faut de rudes leçons avant de reconnaitre l'étendue de la corruption humaine. »
Honoré de Balzac
« Face à un pouvoir corrompu, toute opposition devient crédible, y compris le fascisme. »
Mazouz Hacène
Le livre
Françoise Dreyfus, professeur émérite de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, analyse dans ce livre la corruption comme une pratique sociale complexe et répandue, suscitant l'intérêt de diverses disciplines.
Dans cette étude elle aborde les impacts positifs et négatifs de la corruption, examine ses causes socioculturelles et institutionnelles, recherche les motivations des acteurs impliqués, tente de comprendre la réaction du public face à sa médiatisation et les efforts internationaux pour la combattre.
La corruption, dans son sens large, englobe diverses pratiques telles que le clientélisme, le favoritisme, les conflits d'intérêts et le lobbying.
L'intérêt pour l'étude sociologique de la corruption s'est accru depuis les années 60 du siècle dernier, notamment en raison de la corruption endémique et apparente dans les nouveaux États indépendants.
La lutte contre la corruption est devenue un impératif étatique, conformément aux conventions internationales (OCDE, 1997 ; Conseil de l’Europe,1999 ; Nations unies, 2003).
L'ouvrage traite de la définition « variable » de la corruption selon les époques et les contextes économiques et socioculturels. Il souligne les difficultés de sa définition juridique et la nécessité de considérer la corruption comme une construction sociale.
La corruption implique toujours « invariablement » un système d'échange, un abus de pouvoir et une action engageant deux parties.
Alors que Transparency International, donne une définition particulièrement cursive de la corruption, se limitant à l’« abus d’un pouvoir conféré en vue d’un gain privé ».
L’auteure adopte une définition plus large et plus précise : « Il s’agit d’une action qui engage deux parties, l’une qui donne moyennant rétribution, l’autre qui reçoit ; celle qui donne utilise le pouvoir lié à sa fonction pour agir ou au contraire s’en abstenir, en s’affranchissant d’une règle formelle ou informelle relative aux obligations de sa fonction, afin que son protagoniste ou une tierce partie puisse bénéficier d’un travail, d’un marché, d’une décoration, d’un honneur ou de toute autre faveur ayant de la valeur matérielle ou symbolique ; ce type de pratiques s’effectue habituellement en secret. »
Elle précise : « Le fait que l’un des partenaires abuse des attributions de sa fonction en les utilisant dans un but non conforme à l’intérêt collectif qu’est censé poursuivre le service public ou l’entreprise privée qu’il sert, mais à d’autres fins (son profit personnel, celui d’un parti politique, d’une organisation criminelle), est une caractéristique essentielle de la corruption. »
Françoise Dreyfus aborde également l'intérêt des sciences sociales pour la corruption, notamment la sociologie américaine, qui s'intéresse à ses effets et à ses fonctions potentielles pour le développement.
Elle examine les approches fonctionnalistes, socioculturelles et institutionnelles. Elle distingue la corruption administrative, politique et celle servant les intérêts du secteur privé ainsi que les stratégies utilisées par les acteurs privés pour influencer les politiques publiques.
L'ouvrage s’intéresse à l'opinion publique et à sa tolérance envers la corruption. Elle en analyse la médiatisation des scandales et les réactions des élus et des électeurs, ainsi que les perceptions du public et recherche les facteurs influençant son attitude. Elle examine les dispositifs juridiques mis en place et les mesures prises pour prévenir et sanctionner la corruption aux niveaux international et national.
Retour à la littérature : la corruption littéraire !
La corruption littéraire est un phénomène riche et multidimensionnel. Quand Honoré de Balzac, Georges Simenon et Amin Maalouf traitent de la corruption, on est dans une exploration nuancée des dynamiques de pouvoir et des structures sociales influençant l'écrit.
C’est en fait une critique des idéologies dominantes affectant la créativité littéraire et déformant les intentions artistiques. Ils interrogent les ramifications de la corruption, le reflet des mœurs de leurs époques et des dilemmes intérieurs des personnages face à la perte de valeurs.
La corruption littéraire, c’est quand le discours littéraire devient vecteur de transformation, où les mots servent à manipuler la vérité. La censure est subtile, elle n’est qu’influence !
La corruption dans la littérature :
Molière dans "Tartuffe", au XVIIe siècle expose les abus de pouvoir liant manipulation et hypocrisie.
Au XIXe siècle, avec Balzac et Zola, la corruption est approchée dans le cadre socio-économique de l’industrialisation.
La corruption est alors un caractère structurel de nos sociétés, le capitalisme engendre systématiquement des comportements déviants.
Dans son œuvre emblématique « Germinal », Zola dépeint une société inégalitaire où la corruption s’insinue dans les structures de pouvoir. Dans « La Bête humaine », il dévoile la cupidité et la corruption institutionnelle.
Dans son dernier roman, « Les Frères Karamazov », Dostoïevski illustre la corruption morale à travers le personnage de Fiodor Pavlovic, le propriétaire terrien dépravé, malhonnête et manipulateur, incarnant la décadence morale et la corruption matérielle.
Comme moteur narratif, la corruption offre à tous ces auteurs l’entrée à une réflexion critique sur les enjeux moraux de leurs époques. On y décèle les nuances de moralité et les implications sociopolitiques de la corruption. On y découvre comment les systèmes oligarchiques influencent les choix entre ambitions et déviations morales.
Les personnages corrompus deviennent souvent les témoins tragiques des conséquences d'une société valorisant le succès matériel au détriment de l'éthique.