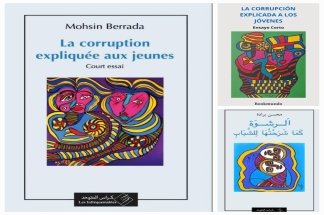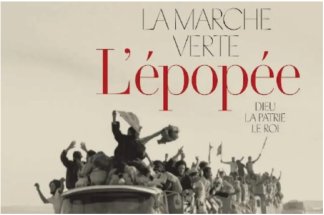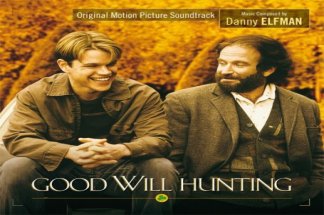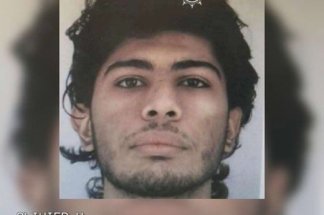chroniques
Sortir du paradoxe : Aligner finance et capacités productives en Afrique – Par Adnan Debbarh

Le dialogue ponctuel, informel, fragmentaire ne suffit plus. Ce qu’il faut, c’est une instance de pilotage dotée d’une vision de moyen terme, capable d’identifier les filières prioritaires, de croiser les ambitions publiques et les logiques privées, de catalyser les initiatives
La présence des banques marocaines en Afrique est indéniable, mais reste sous-exploitée au service de l’économie réelle. Cette chronique propose une vision structurée pour faire de cette puissance financière un levier stratégique de codéveloppement, au service des PME marocaines. Pour Adnan Debbarh, il est temps de passer des bilans flatteurs aux actes transformateurs. L’Afrique attend plus qu’une rentabilité, elle attend un projet

Les chiffres sont là, puissants et rassurants. Plus de 1 200 agences sur le continent, près de 40 % des résultats consolidés des groupes bancaires marocains issus d’Afrique subsaharienne, une présence reconnue, respectée, parfois enviée.
Le succès est indiscutable.
Mais derrière les bilans et les classements, une interrogation demeure : à quoi sert cette présence bancaire si elle ne contribue pas à la projection de notre économie réelle sur le continent ?
Dans une première chronique, nous avons posé la question sans détour : pourquoi les PME marocaines peinent-elles à suivre le rythme de nos banques en Afrique ? Pourquoi cette puissance financière reste-t-elle si peu articulée à la stratégie de codéveloppement que le Maroc promeut avec constance depuis deux décennies ?
Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin. Non pour distribuer des injonctions ou dresser des catalogues, mais pour ouvrir des voies de transformation, réalistes et stimulantes. Car sans cap, même les meilleures volontés se dispersent.
Le vrai sujet n’est pas de critiquer, mais d’accepter que le succès de nos banques peut devenir une force d’entraînement, un levier de projection, un instrument de souveraineté économique, si – et seulement si – nous savons l’inscrire dans une vision concertée. Cette vision existe en germe. Elle appelle désormais des outils adaptés, une volonté partagée et un changement délibéré de culture.
La première évolution est institutionnelle. Le dialogue ponctuel, informel, fragmentaire ne suffit plus. Ce qu’il faut, c’est une instance de pilotage dotée d’une vision de moyen terme, capable d’identifier les filières prioritaires, de croiser les ambitions publiques et les logiques privées, de catalyser les initiatives.
Un Conseil stratégique Afrique, présidé par un expert indépendant, associant banques, patronat, diplomatie économique et tiers qualifiés, permettrait d’articuler ce qui aujourd’hui fonctionne en silo.
La deuxième transformation concerne les instruments. Pour que les banques puissent accompagner les PME marocaines sur les marchés africains, elles doivent disposer de relais de confiance, de garanties adaptées, de dispositifs de partage de risques.
Des dispositifs innovants existent ailleurs. Nous pouvons les adapter. Des garanties partielles de l’État, des fonds de co-investissement public-privé, des mécanismes de couverture de change peuvent rendre les projets des PME plus finçables, plus sûrs, plus prévisibles.
Il ne s’agit pas de décréter une nouvelle doctrine, mais de poser une ambition mesurable : que dans cinq ans, 10 % des crédits octroyés par nos filiales africaines bénéficient à des entreprises marocaines opérant à l’international. Sans être une obligation légale, un tel objectif incarnerait une volonté collective, un seuil de cohérence entre la finance marocaine et l’économie productive qu’elle prétend accompagner.
Pourquoi pas, les banques atteignant les 10 % de crédits aux PME pourraient bénéficier d’un accès prioritaire aux fonds souverains marocains pour leurs projets africains.
Encore faut-il que les entreprises productives soient préparées. Il n’y aura pas d’offre bancaire africaine crédible pour les PME marocaines sans une montée en compétence, une acculturation aux marchés visés, une certification des capacités. D’où l’intérêt d’un dispositif de labellisation – type "Passport PME Afrique" – garantissant aux banques que les entreprises présentées répondent à un standard opérationnel, financier et logistique. Ce n’est pas un sésame, mais un premier filtre de crédibilité.
Il ne s’agit pas ici de créer des usines à gaz. Au contraire, le succès dépendra de la simplicité des dispositifs. Un guichet unique pour les garanties, des cellules dédiées à l’accompagnement des PME au sein des filiales africaines des banques marocaines, une interface opérationnelle entre diplomatie économique et institutions financières : ces outils ne relèvent pas de l’utopie. Ils existent ailleurs. Ils peuvent être pensés ici.
Mais l’enjeu n’est pas seulement opérationnel. Il est aussi culturel. Il suppose que les banques sortent d’une logique centrée sur les grands comptes et acceptent d’investir sur la durée dans une nouvelle clientèle. Il suppose que les entreprises comprennent que l’Afrique n’est pas un eldorado mais un terrain de construction patiente. Il suppose enfin que l’État, stratège et facilitateur, accepte de jouer un rôle de réassurance, sans se substituer aux acteurs.
L’État, sans adopter une posture autoritaire, ne peut non plus rester indifférent à ce décalage. Il lui appartient de créer les incitations appropriées – fiscales, prudentielles, opérationnelles – pour encourager l’alignement progressif des objectifs bancaires et des priorités nationales. À défaut, certains avantages dont bénéficient les groupes bancaires marocains à l’international pourraient être réexaminés sous l’angle de leur contribution réelle au projet de développement partagé.
Cette nouvelle approche ne peut reposer sur les seuls leviers financiers. Elle exige une diplomatie économique offensive, transformant nos ambassades et agences de promotion en véritables bureaux d’études au service des PME marocaines. Pour systématiser cette approche, une task force Afrique opérationnelle – associant diplomates, banquiers et experts – pourrait être instituée, à l’image de la « Africa Desk » développée par la Turquie. Cette mobilisation, pour être crédible, doit s’inscrire dans une logique de résultat : appels d’offres remportés, barrières réglementaires levées, joint-ventures facilitées.
Ce sont ces indicateurs qui donneront sens et légitimité à l’action engagée.
Et si l’on veut embarquer les acteurs, encore faut-il leur parler. D’où l’intérêt d’une campagne nationale – sobre mais résolue – mettant en valeur les pionniers, les réussites, les coopérations fructueuses. Montrer que c’est possible, que c’est utile, que c’est rentable. Et que c’est aussi un engagement de long terme au service d’un projet marocain en Afrique.
Les banques ont, elles aussi, une décision à prendre. Rester de simples gestionnaires de rentabilité, ou devenir les moteurs assumés d’un projet marocain pour l’Afrique. L’Histoire jugera moins les bilans que les choix. Et elle se souvient des institutions qui, au moment décisif, ont su penser au-delà de leur confort immédiat.
Et si nos banques devenaient, non pas les simples relais d’une ambition financière, mais les vaisseaux d’un projet marocain pour l’Afrique ?
Ce virage exige plus que des discours. Il demande des actes.
Les banques marocaines ont une occasion unique : écrire l’histoire économique de l’Afrique… ou se contenter d’en comptabiliser les profits."