société
De la métamorphose de l’être en spectre urbain

Le monde se rétrécit à la ville, qui se cybernétise, se transforme à vitesse d’éclair sans se penser et sans se comprendre.
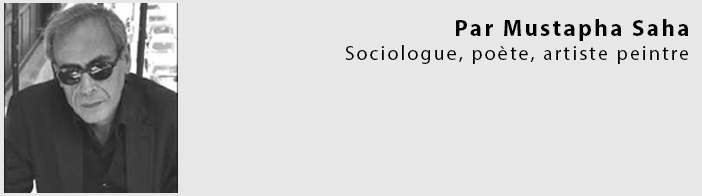
De l'évanescence spatio-temporelle du droit à la ville
La fossilisation de la cité historique articulée autour d’un centre spirituel et culturel, la désagrégation de la ville industrielle en périphéries éloignées, isolées, ghettoïsées d'une part, en épicentres décisionnaires encellulés, barricadés, surprotégés d'autre part, dans une répartition ségrégationniste des frustrations et des jouissances, ouvre la voie à l’urbain diffus, confus, métallique, sans essence et sans substance. L’atomisation sociale se propage et s’amplifie au détriment du droit à la ville. L’espace émietté par la spéculation immobilière et l’absurdité technocratique perd sa grammaire, sa syntaxe et sa morphologie stylistique. Sa pauvre sémantique s’enferme dans des codifications illisibles. Sa circulation se cloisonne dans la signalétique en circuits fermés. Sa sémiologie désintégrée, dépouillée de sens sociologique, déboulonne l’esthétique, désoriente le questionnement philosophique, paralyse la pensée des possibles, affecte d’agnosie l’observateur lucide. Le monde se rétrécit à la ville, qui se cybernétise, se transforme à vitesse d’éclair sans se penser et sans se comprendre. Les concepts mercatisés, dévitalisés, ne sont plus que des idées-latex porteuses de projets financiers, de données d'ordinateur, sans intuition, sans inspiration, sans imagination, sans étincelle utopique, sans éclair poétique, sans lueur onirique, sans d'autre raison que le retour sur investissement.
L'interventionnisme étatique pendant les Trente glorieuses, l'aménagement bureaucratique du territoire, la planification technocratique de l'espace, l'industrialisation monopolistique du bâtiment, l'irruption brutale des villes nouvelles, des grands ensembles concentrationnaires, la sanctuarisation des quartiers vitrines, la sacralisation de la culture élitaire, laissent aujourd'hui des verrues géantes, des cicatrices béantes, des déchirures monstrueuses dans le paysage urbain. La campagne elle-même se technocratise, s'urbanise, se numérise. La société entière se bétonne, se conditionne, se moutonne. Henri Lefebvre constate ce séisme urbanistique dès les années soixante dans la dissociation de la morphologie matérielle, architecturale et pratico-sensible, et de la morphologie sociale désagrégée de la ville. L'uniformisation architecturale conditionne, par avance, le mode de vie monotone, soporifique, mortifère. La réclusion spatiale condamne au bannissement social. Henri Lefebvre, avec une préscience prémonitoire, élabore le concept de droit à la ville, qui ne peut se réduire à un retour aux villes traditionnelles, mais se définit comme un droit à la qualité de la vie urbaine dans des quartiers reliés transversalement en réseaux d'intérêt commun, animés par leurs résidents, reconnus comme entités contributives au bien-être commun. Cette pensée prodromique, largement récupérée dans un but réformiste par les instances nationales et internationales, s'inscrit encore dans une organisation pyramidale de la société considérée comme inéluctable, où l'autonomisation par rapport au pouvoir central est inconcevable. Elle n'en reste pas moins prégnante dans la société transversale, qui se profile entre les mailles de la Révolution numérique.
Dans les smart communities shanghaïennes, […] La ville dite intelligente algorithmise chaque existence, enregistre chaque geste, passe au crible le moindre remuement. (Mustapha Saha).
La ville n'est plus un théâtre de la vie quotidienne, façonné par les pratiques et les usages connectifs des citadins. L'urbanisme technocratique la casse et la commue en machine prohibitive, répressive, normative des activités sociales et des conduites individuelles. L'espace est vécu à travers son quadrillage disciplinaire, qui le morcelle et découpe chaque mouvement du citadin en séquence canalisée, pilotée, contrôlée hors de lui. Le piéton, contraint de raser les murs, se déplace dans des passages pré-tracés. La circulation automobile le dévore, le mazoute, le congestionne, le rejette sur les bas-côtés. La ville entière est configurée pour les déplacements mécaniques. Il s'agit bel et bien d'une robotisation programmée des comportements. L'idéologie spatialiste elle-même, terrain des luttes d'influence, galvanomètre des rapports de force sociaux, s'épuise dans l'informatisation générale. L'urbain golémique secrète sa propre logique, court-circuite ses programmations, télématise en retour ses ordonnateurs et ses usagers. Dans l'espace segmenté, morcelé, disloqué, les hauts-lieux du pouvoir ont beau rivaliser d'ostentation pour imposer leurs signes extérieurs de présence, ils perdent irrémédiablement leur symbolique de puissance. Les monuments historiques eux-mêmes, jadis vénérés pour leur sacralité, reconvertis en cimetières de l'art, ne sont plus que des attractions touristiques, appréhendés du dehors comme des décors de péplums. L'idéologie spatialiste, moderniste, techniciste, fonctionnaliste, génératrice d'ennuyeuse stabilité, se dissout dans la réalité flottante. Les sociabilités microcosmiques, affinitaires, évolutives, estompent les hiérarchies sociales. La mystification urbaine s'effiloche dans sa propre rationalité. Les performances architecturales des écoles abstractives, faute de s'inscrire dans les pratiques sociales, de traduire leurs aspirations au lieu de les formater dans des modélisations, d'accompagner les mutations culturelles au lieu de s'affirmer comme thérapies urbaines, sont partout menacées de rapide désuétude. Les opinions changeantes, au gré des tempêtes médiatiques qui les portent et les déportent, n'ont plus d'ancrage urbain pour pérenniser leur impact social, cristalliser leurs messages, perpétuer leur prépondérance morale. Le web se substitue à l'espace matériel, évince l'urbain comme matrice événementielle, impose son invraisemblable plate-forme, sa primauté discursive à l'échelle planétaire, son information protéiforme, sa dramaturgie multiforme, monopolise à chaud les exclusivités, les références, les répercussions, capte les attentions, aiguillonne les émotions. Les scandales, les rumeurs, les drames et les mélodrames naissent et meurent sur la toile. L'urbain comme régulateur social se transcende et se dépasse dans la sur-spatialité de l'écran, où se déplace la potentialisation des égos en quête d'existence publique, où les voyages fantasmatiques s'impriment en images instantanées, où les rêves d'un devenir meilleur et trouvent un écho consolatoire en temps réel.
L'urbanisme technocratique s'impose, depuis les dévastations de la Seconde guerre mondiale, les reconstructions massives et les standardisations architecturales, comme thérapie spatialiste des pathologies sociales, comme idéologie phagocytaire, digérant tous les secteurs socio-économiques et socioculturels, secrétant sa propre rationalité sélective, répartitive, ségrégative, substituant le dirigisme modélisateur à la production sociétale. Il infiltre ses dissonances dans le cours régulier des choses, neutralise la prospection d'autres possibles, génère les inadaptabilités qu'il prétend guérir, soigne le mal par un mal toujours plus pernicieux et embroussaille la psychopathologie urbaine de nouvelles maladies psychiques que la médecine académique peine à diagnostiquer. Les territoires urbains tracés, découpés, emboîtés, sous lumière artificielle, par des concepteurs déconnectés des réalités sociales, ignorent cyniquement les histoires humaines qu'ils démantèlent. Les citadins n'y sont plus que des figurines inertes, des santons minuscules, des lilliputiens indiscernables dans des décors cyclopéens. Le citadin s'engloutit corps et âme dans les cartes à puce, les circuits intégrés, les hologrammes de sécurité. Le spectre urbain n'est plus qu'un complexe de réflexes conditionné. L'esprit utopien, fécondateur du devenir, se dessèche sur papier quadrillé. Le sur-rationalisme schizophrénique, utilitariste, morbide, de la technocratie gouvernante, produit, en régime ultralibérale, un univers plus concentrationnaire que les systèmes totalitaires. La géométrisation systématique de la vie, négationniste de l'historicité et de la spatialité sociale, n'engendre qu'espaces psychiatriques à ciel ouvert, résignations inclusives à l'accompli, renonciations définitives aux projets régénérateurs. Le pouvoir urbanistique, mécanique broyeuse de toutes les résistances, s'exerce par lui-même, pour lui-même, au-delà des volontés conceptrices, des consciences correctrices, des projections libératrices. La Révolution urbaine, qui se réclame d'une science programmatique sans d'autres appareillage réfutatoire que ses prouesses technologiques, surimpose partout sa production architecturale stérilisatrice, s'objective en dehors de l'action humaine, contre elle, dans l'aveuglement classificatoire, l'algorithmique abrogatoire, la fuite en avant aléatoire.
Les grandes artères, les quartiers d’affaires, les centres commerciaux, les mégastores, les multiplexes, des mégalopoles mondiales se concurrencent et se ressemblent dans leur architecture sublimatoire, leurs vitrines ostentatoires, leur sur-visibilité hallucinatoire. Les bâtiments, sémaphores translucides noyés dans la brume artificielle, profilent leurs entrelacs de lignes insaisissables. La smart-métropole, exponentielle dans son espace réduit, connectée par fibre optique, truffée de capteurs, phagocytaire de toutes les énergies vitales, décolle de terre, dans le vertige mercatique et l’engrenage télématique, sans savoir où alunir. Cette ville transparente, négation technologique du droit à la ville, du libre arbitre citoyen, où le vivre-ensemble est mathématiquement résolu comme une combinatoire, n’est plus qu’une équation complexe soumise aux solutions abstraites de big data et d’open data pour une optimisation totale, un contrôle infaillible des cercles relationnels, une gestion préventive des dissensions sociales, une sécurisation intégrale. Elle se démultiplie en milliers de paysages mouvants, interchangeables, rechargeables au gré des cibles visées. Le marcheur s’engouffre, dès qu’il y pénètre, dans une spirale giratoire qui le mène nulle part. Ainsi se dessine la ville du futur où le citadin, sous surveillance permanente, anonyme et indiscernable, hologramme dans l’infinie superposition d’images, téléguidé dans ses moindres mouvements, n’est plus qu’un spectre urbain. L’architecture se conforme désormais aux diktats de la domotique, actionné par l’interopérabilité de électronique, de l’informatique et de la télécommunication. Rien n’échappe à leurs fonctions sur les interphones, les digicodes, les alarmes, les détecteurs de mouvement, le chauffage, la régulation thermique, l’éclairage, les écoulements d’eau, la programmation des appareils ménagers, la sonification, l’acoustique, les multimédias. Les occupations journalières, les études, les loisirs, sont régis indépendamment des perplexités, des indécisions, des tâtonnements, dans une routine monotone et lancinante. Dans l’espace gouverné par les télécommandes, les murs ne s’expriment plus. L’usager béquillé de prothèses technologiques, d’activateurs automatiques, de gadgets télématiques, perd le contact charnel avec les objets, le plaisir tactile avec les matières naturelles, l’émotion sensuel des odeurs et des saveurs.
Du faux usage urbanistique des théories philosophiques
Le déconstructivisme, se réclamant des théories philosophiques de Jacques Derida, ignore superbement les enjeux socio-urbains. Ses conceptions fragmentaires, ses formes chaotiques, ses plans paradoxaux, ses détournements des techniques classiques, n’ont d’autres visées que le dérangement des formes, la confusion des contenants, l’opposition des modules complémentaires, la juxtaposition d’éléments hétéroclites sans souci de cohérence. Cette architecture ironique se réalise en projections fantasmagoriques, dans la révocation de l’historicité spatio-temporelle, en retournant son ambivalence énigmatique contre l'imaginaire collectif, stérilisé par l’inculture médiatique, en perte de sens et de sapience, incapable de se reconnaître et de se subsumer. Le post-modernisme est une récupération au second degré de la récupération mercatique dans une constante posture de distanciation, qui s’applique tout autant à l’usage social de ses créations. Les architectes déconstructivistes, hantés par l’esthétique du double, indifférents à leur apport social, se posent en interrogation sur leur propre raison sans souci de leur impact urbain.
L'architecture déconstructiviste, gangrénée par les attracteurs financiers chaotiques, imbue de ses complexifications artificielles, enregistre et reproduit les fluctuations aléatoires des dérives économiques. Les synthèses d'images complexes, instrumentalisés en rescousse, se traduisent par des bâtiments dont les fonctionnalités parasitaires échappent à leurs propres concepteurs. Les variations imprédictibles des commanditaires, publics et privés, marque l'urbanisme, dans son entier, de son instabilité récurrente, dérègle en permanence les processus complexes d'auto-organisation et d'autorégulation de la société en l'estropiant de l'espace et du temps d'auto-régénération, en la dépouillant de sa propre horlogerie connective.
A l'opposé de l'architecture déconstructiviste, l'architecture africaine, dans des agglomérations où l'interpénétration des rôles et des compétences est une nécessité vitale, multiplie les expériences novatrices de constructions organiquement liées à leur matrice ancestrale. Le village itératif se démultiplie en anneaux entrelacés, autant de maisons familiales enchâssées dans des dimensions variables selon la répartition sociale des fonctions. Les relations interhumaines sont dynamiquement inscrites dans l'organisation spatiale. La maison marocaine traditionnelle, morphogénétique, connective, structurée selon des règles naturelles, disposée en spirales autour du patio central, soutenue par des colonnes hélicoïdales, faïencée de figures florales, parsemée de niches, d'alcôves, de voûtes, de courbures, d'arcures, est dotée d'ouvertures lumineuses propices à la méditation philosophique, à l'inspiration poétique, à la paix intérieure. Elle est ossature protectrice, membrane régulatrice de fraîcheur et de chaleur, combinatoire orchestratrice d'osmose spatio-temporelle. Ici, la synchronicité multipolaire se distingue du hasard capricieux des logiciels.
La logique abstractive de la société technocratique absorbe et digère l’être social dans sa totalité, le transforme en code anonyme, en monade aléatoire dans les simulations projectives. La modélisation fictive se décrète impératif catégorique. L’être réel, sommé d’adopter, en toute circonstance, le comportement standard, s’atomise jusqu’à l’auto-négation. Il se désingularise. Il se désintériorise. Il se désolidarise de lui-même pour devenir un lémure uniquement réatif aux stimulis extérieurs.
La blobarchitecture consacre l’introduction de l’informatique dans la conception de bâtiments étranges, avec des formes incurvés évoquant des amibes surdimensionnés, des excroissances bulbiques évoquant parfois des éruptions gigantesques d’acné, des tumeurs géantes métallisées, des symboles de nidification d’androïdes. « Blob » signifie en langue anglaise « goutte », « grosse tache », « surface floue ». Mollesses rigidifiées, liquéfactions pétrifiées, coulées lapidifiées. Difformités charnelles fossilisées. Cette architecture modulaire, granulaire, crépusculaire, métaphore d’une société gangréneuse, déroule ses moulures tortueuses, ses boules scrofuleuses, , ses coulées couleuvrines, comme des anachronismes provocateurs.
Le spectre urbain, cobaye des mutations génétiques, imperceptiblement injectés en doses indolores, par les avancées scientifiques, s'esclavagise en pensant conquérir de nouveaux espaces de liberté. Peter Eisenman, considérant que l'humain, devenu un être incertain et fragmentaire, une absence à lui-même et au monde de l'ère post-nucléaire, autogéré et définitivement débarrassé de la métaphysique de la présence, le déloge du processus urbain. Ce postulat posé, Il pousse l'abstraction biologique de l'architecture, sur la base de la géométrie fractale, jusqu'à l'identifier à un système génétique, évacuant au passage la question esthétique. L'expression architecturale décomposée, langage codé producteur de son propre sens, liquide la géométrie platonicienne de polyèdres réguliers, renvoie l'harmonie aux poubelles de l'histoire, défait tous ses rapports avec la mémoire et l'utilité sociale, y compris son ultime relation d'intimité, s'affranchit de toute préoccupation anthropologique, rejette la prééminence du signifié sur le signifiant et du sujet pensant sur l'objet, génère son propre langage formel, installe le non-savoir comme un paradigme, tout en se donnant un statut de contestation politique radicale. Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, utilisés comme arcs-boutants théoriques, s'en retrouvent plongés post-mortem dans le nihilisme caverneux. C'est à l'université Johann Wolfgang von Goethe de Francfort que Peter Eisenman réalise son Biocentrum, basé sur des extensions potentielles imitant le mécanisme génétique de la synthèse protéique et sur l'interactivité fonctionnelle. Cette architecture bio-numérique, métabolique, se retrouve dans d'autres réalisations spectaculaires, ruches inhumaines où le spectre urbain, mu par la magie des algorithmes, légitime sa raison d'être. La Capsule Tower de Khisho Kurokawa, composée de capsules préfabriqués en métal et béton, modules interchangeables, déplaçables, remplaçables, est soumise au hasard et à l'irrégularité imprévisible de ses recompositions successives. Les sphères déployables de Chuck Hoberman, adaptatives et réactives, polyèdres capables de se déplier et de se rétracter, annihilent d'avance tout amarrage de l'habitus. La fonctionnalité pure fantomatise inéluctablement qui la hante, volatilise inexorablement qui la traverse, efface implacablement ce qui la précède, anéantit fatalement ce qui lui succède. Les logarithmes s'auto-créent, se génétisent, développent leurs morphologies inédites dans l'indétermination totale. Il n'est point besoin de concevoir le spectre urbain dans des éprouvettes, de le manipuler génétiquement, de le conditionner par des drogues euphorisantes, il suffit de faire vivre l'humain dans un cadre extincteur de ses émotions de sorte qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. L'automobiliste faisant corps avec sa voiture, pris dans la tourmente des embouteillages, n'est qu'une machine à jurons. L'internaute dissout dans son mental binaire n'est qu'un logarithme mouvant. L'androïdisation commence par l'identification à l'objet captateur. L'architecture bio-numérique formate le cybernanthrope comme la fonction façonne l'organe. L'urbanisme technocratique étend sa chape sécuritaire aux déplacements anodins, aux usages ordinaires, aux moindres mouvements dans la ville. Le comportement citadin, perpétuellement empêtré dans les contrôles, s'automatise inconsciemment. La signalétique l'enferme dans les passages obligés, les clignotants l'alarment. Le premier paramètre de l'architecture est désormais la sécurité. Le code régit l'usage et l'accès. Le flâneur sans souci s'observe comme un étrange revenant.
De l’interversion du visible et de l’invisible
De tous temps, l’invisible relève de l’ésotérique, de l’occulte, du mystère, du royaume des esprits, de l’univers des âmes. Le visible se matérialise dans le corps, la chair, la substance palpable des êtres et des choses. Depuis la haute antiquité, l’architecture sacrée, monumentale, intimidante, se présente comme un écrin, à sa mesure, de la puissance déique, cosmique, ineffable. Les temples, les acropoles, les cathédrales, imposent l’autorité sacrale, la soumission inconditionnelle, le silence révérencieux, exigent l'humilité pieuse, la subordination respectueuse, la servitude dévotieuse, renvoient la récompense paradisiaque aux temps éternels. Les palais, les châteaux, les citadelles, légitiment leur pouvoir de droit divin comme doubles terrestres de la prépotence céleste. La pensée humaine s’est structurée dans cette dualité fondatrice du physique et du métaphysique, du matériel et du spirituel, de l’essentiel et du substantiel. L’esthétique assure la médiation entre les deux pôles extrêmes. L’art ne reflète ni le réel ni le naturel. « L’art ne reproduit pas le visible. Il rend visible » l’invisible, selon la formule de Paul Klee. La magie immanente de l’architecture, par déduction proprement existentiel, réside dans sa dimension esthétique, qui préserve sa part divine dans l’humain et sa part humaine dans le divin.
Tel n’est pas le cas dans les architectures technocratiques qui transforment le vivant en spectre urbain. Le pouvoir, jadis incarné dans un binôme sensible, se désincarne dans d’obscures identités morales. Ne sont visibles, du sommet au bas de la pyramide bureaucratique, que les micro-pouvoirs. L’humain est définitivement exclu des modélisations technicistes, qui se décrètent et s’appliquent arbitrairement comme émanations des circuits financiers qui les prédéterminent. Les villes ne sont plus des organismes en évolution historique, agglomérats de quartiers pittoresques et de villages insolites, qui se complètent et se différencient par leur spécificité constitutive. Les villes nouvelles et les quartiers postmodernes surgissent désormais du néant, usines froides strictement articulées par leur raison mercatique, n’obéissant qu’à leurs propres ressorts automatiques, machines anthropophages où le vivant, déraciné, frustré de son ouverture aux possibles, interdit d’expérience et d’aventure, délesté de sa sensation d’être, n’est qu’un réceptacle de l’appareillage électronique qui l’enserre et le broie. Au lieu de servir l’humain, l’urbanisme l’asservit aux prophylaxies uniformisatrices, aux criblages purificateurs, aux filtrages liberticides. Les patronymes disparaissent dans les matricules. Les banques de données digitalisent et canalisent les marqueurs individuels et collectifs. Le vivant dans cette configuration n’est qu’un éclat insignifiant de l’espace prédateur. Les micro-pouvoirs normalisateurs des comportements se disséminent dans l’implacable et omniprésente signalétique, inspiratrice non point de peur négociable, mais de réflexes conditionnés. La relation de l’usager à l’espace n’est plus un rapport de forces domesticateur, pacificateur, superviseur des actes de chacun, qui laisse malgré tout des brèches à l’insoumission, à la subversion, à la transgression, des marges aux contre-pouvoirs, au sens où Michel Foucault en fait sa magistrale analyse. La régulation électronique des pensées et des conduites, publiques et privées, ne s’embarrasse ni de séduction pédagogique, ni d’endoctrinement andragogique, ni de persuasion disciplinaire, elle sévit instantanément, sélectionne et lamine.
Avec la Révolution numérique, l’invisible devient partout visible, l’immatériel s’incarne en temps réel dans la déferlante incessante d’images, obnubilantes, lancinantes, vampiriques dans leur insaisissable ubiquité. L’internaute balaie inépuisablement les lames informatives, tamise leur écume pour finalement ne rien retenir. L’écriture elle-même rétrécit son champ d’expression aux brèves légendes et aux commentaires lapidaires. La vie de l'internaute se saccade en sursauts émotifs. Le spectre urbain s’incarne et se volatilise au rythme de ses navigations virtuelles, ectoplasme dilué dans son écran, fantôme dissipé dans son miroir. Les signes du visible et de l’invisible se fondent et se confondent. Le corps et sa perception, la substance et sa représentation, l’objet et son imprégnation se brassent et s’amalgament. Le visible se couvre d’ombres mouvantes, se voile et se dévoile, s’éclaire et s’obscurcit au gré des flux informatifs. L’esprit, amputé de son imaginaire, musardé entre simulations effrayantes et transfigurations déroutantes, se réfugie dans les projections trompeuses et finalement se résigne à sa condition irréelle.
L’architecture, dans sa visibilité monumentale et son invisibilité microcosmique, consacre cette organisation séparative. L’ordre réflexif construit son pouvoir en dénaturant la nature, en déconstruisant le monde, en pervertissant le visible dans ses interprétations spéculatives, en matérialisant ses projections fictives dans la fragmentation spatiale et l’atomisation sociale, en imposant partout sa signalétique réglementaire. Le sur-pouvoir urbanistique, dans son abstraction omnipuissante, règne comme double invisible de toute chose visible, de toute chose existante. Le vivant n’a d'autre raison d'être que son image sociale, sa dissociation de sa propre nature d’être en soi et par soi, d’autre échappatoire hors circuits balisés où son parcours existentiel se téléguide de la naissance à la mort. La vision close champignonne dans l’architecture verticale, sature l’espace vital, transforme la ville en fourmilière. Le visible, uniquement perceptible à travers l’engrillagement quotidien, se découpe en lanières. Les vivants ne sont plus que des particules manipulables, logeables et délogeables dans des agglomérats d’alvéoles indistinctes. L’urbain ingurgite tout ce qui bouge et le dégorge dans l’embouteillage perpétuel. L’horizon se referme, le visible s’enferme dans le cloisonnement spatio-temporel. Le dédoublement du monde génère la dualité de l’être. Le corps sensible s’extraie de la vision directe des choses pour se conformer à leur image reproduite. Le corps cesse d’être un organe expressif, son double phagocyte son énergie motrice. L’être, entre interdit et non-dit, se désintellectualise. Sa conscience s’extériorise. Son esprit s’hétérogénéise. Son comportement se robotise.
De la métamorphose de l'être en spectre urbain
Le spectre urbain, greffé d’organes électroniques, décroché de sons sol porteur, communique en temps réel aux quatre coins de la planète, navigue sur les ondes, n’évolue plus que dans la quatrième dimension. Il voltige dans une hyper-réalité sans espace et sans temps, sans souvenir et sans mémoire, sans boussole et sans perspective. Le flux perpétuel des messages et des images ballote indéfiniment le consommateur apathique, le spectateur passif, de sensations furtives en émotions fugitives. A force de voguer entre alarmes et alertes, il est sans cesse sur le qui-vive. Il n’est plus qu’un signal de passage, une unité statistique. Le spectre urbain n’est plus aliéné au sens où le système capitaliste et la société bureaucratique de consommation dirigée le concevaient, un être social perméable, après lavage de cerveau, au bourrage de crâne propagandiste, idéologique ou publicitaire. Dans « L’Homme unidimensionnel » Herbert Marcuse démystifiait déjà la société industrielle avancée , où le pseudo-démocratisme s’avère en vérité un totalitarisme travesti, où l’uniformisation des corps et des esprits proscrit l’analyse critique, où la standardisation des pensées et des modes de vie prohibe l’effervescence diversitaire, où la satisfaction des besoins factices tient lieu d’intérêt général, où « le bonheur triste » lyophilisé se protège comme bien commun, où l’exigence d’adaptabilité dépouille le consommateur de son libre arbitre, où la stérilisation de la culture abolit le jugement critique, où le refus du conformisme se traduit par une marginalisation fatale. L’esthétique elle-même, génératrice de représentations inédites du monde, qui, par définition formule l’informulable, explore l’inexplorable, les facettes cachées du visible et les caches inaccessibles de l’invisible, désormais soumise à la banalisation publicitaire, se transmute en arme réificatrice des désirs. La vie quotidienne se marchandise dans les supermarchés, le cadre de vie se propose au plus offrant. La culture vidangée de sa substance créative n’a d’autre finalité, dans société de consommation compulsive, que le divertissement dérisoire et le festivisme illusoire. Le culte de la performance commande la production du savoir et le formatage des connaissances, qui n’ont d’autres critères de validation que leur efficience opérationnelle. Les philosophes, les plus suspects parmi les indésirables, sont traqués comme empêcheurs de tourner en rond. Seul le prêt-à-penser, enrobé d’une sémantique restrictive, s’infuse et se diffuse. Herbert Marcuse était loin d'imaginer que le pire allait se réaliser si vite.
La ville d'aujourd'hui exhibe déjà ses architectures futuristes, formelles et glacées. La stylistique hermétique, la décoration crépusculaire, le design spectaculaire sous lune décroissante, estampillés haute technologie, supplantent insidieusement la poétique urbaine, suscitent la fascination passive au dépens de l'émotion adhésive. La ville technologique s’élabore comme un camp retranché, où les smarts grids, sous prétexte de suivre en discontinu la consommation d’énergie à des fins écologiques, finissent par contrôler l’intimité des familles. La modélisation des déplacements des piétons, sous prétexte de fluidifier le trafic urbain, sonne le glas de la liberté de circulation, met les passants sous filature continuelle. Les itinéraires, les rencontres, les habitudes de chaque individu alimentant des banques de données, des mises en fiches, des listages liberticides. Dans les smart communities shanghaïennes, les activités quotidiennes des citadins, leurs trajets, leurs courses, leurs démarches, sont entièrement numérisés, au profit de la bureaucratie et des entreprises privées. La ville dite intelligente algorithmise chaque existence, enregistre chaque geste, passe au crible le moindre remuement. La science-fiction se concrétise dans l’indifférence éthique. La cybercité, totalement gérée par la robotique et la domotique, dépossède l’humain de son initiative. Les logarithmes d’asservissement font exécuter à des robots de plus en plus performants, objets dynamiques sans âme, monstres mécaniques sans cœur, les consignes reçues dans des temps record, qui prennent de court l’action humaine et annihilent radicalement la liberté d’agir. La robotique sociale s’immisce dans tous les secteurs de la vie collective, l’éducation, la formation, l’assistance aux personnes âgées, générant des promiscuités rocambolesques et des interactions problématiques entre humains et androïdes, provoquant des transferts affectifs sur des machines insensibles, annonçant l’émergence d’une nouvelle espèce, le cybernanthrope, rejeton de la rigueur technique, des stratégies imparables, des solutions irrévocables, dépuré du doute, de l’incertitude, de l’humour, de l’autodérision, du désir, de la passion, de la folie douce des artistes, des élucubrations lumineuses des philosophes, des divagations visionnaires des poètes. L’intelligence artificielle écrase insidieusement l’intellect critique.
© Mustapha Saha





















