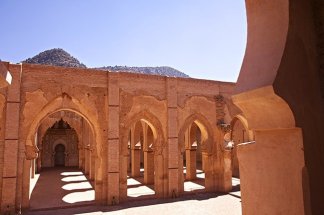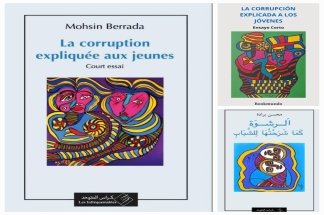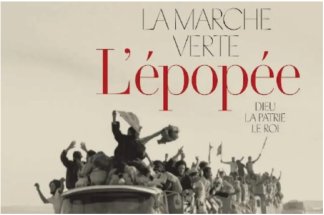chroniques
HARVARD -TRUMP: LIBERTÉ ACADÉMIQUE EN DANGER - Par Mustapha SEHIMI

La présidence impériale ne remonte pas à Trump: tant s'en faut. Elle lui était en effet antérieure. S'est ainsi développé une tendance du pouvoir exécutif - de la présidence donc des États-Unis - à agir de manière unilatérale avec l'aide des Exécutive Orders. Trump s'est engouffré dans cette brèche (Photo AFP)
C'est une attaque globale et massive de l'administration Trump ne visant pas seulement les Universités mais le monde de la science et de la recherche dans son entier. Une hostilité pour le moins hallucinante. Mais ce constat s’impose : contrairement à une idée IEEE reçue, la liberté académique en tant que telle n'est pas garantie par la Constitution des États-Unis. Mustapha Sehimi explique.
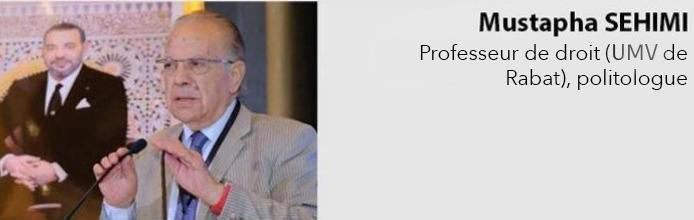
Pour l'instant, il faut relever que les mesures les plus graves regardent les suppressions de crédits fédéraux relatifs à la recherche sur le changement climatique. Cela dit, il faut faire ce constat essentiel: la liberté académique en tant que telle n'est pas garantie par la Constitution des États-Unis, ni d'ailleurs par une quelconque loi fédérale. Tel est le cas également en France et au... Maroc. Les juristes américains et la Cour suprême ont estimé dans certains cas que la liberté académique pouvait être protégée indirectement lorsqu'on pouvait l'interpréter comme liberté d'expression.
Liberté d'expression...
Une telle qualification a permis à la Cour suprême dans certains cas de se fonder sur le 1er Amendement qui protège la liberté de parole (free speech). Une jurisprudence qui n'est pas cependant d'une grande clarté entre un droit du Premier amendement relatif à la liberté académique et un droit du Premier amendement sur la liberté d'expression. Ce plaidoyer en faveur de l'autonomie du concept de liberté académique est sans doute convaincant; il n'en demeure pas moins que limitée au seul domaine de la liberté d'expression, la liberté académique est donc partiellement garantie par le droit constitutionnel américain.
Le plus intéressant dans la jurisprudence de la Cour suprême a trait à la définition qu'elle a proposé du contenu de cette liberté en tant que celle-ci se rapporte à l'institution universitaire: " La liberté de déterminer qui enseigne, ce qui est enseigné, comment cela doit être enseigné et qui peut étudier". Mais cette haute juridiction n'a jamais fait l'effort d'identifier les composantes de la liberté les composantes de la liberté académique en tant qu'elle est une liberté professionnelle attribuée aux universitaires - la liberté académique " individuelle". Au final, la liberté académique n'est donc pas spécialement bien garantie par le droit aux États-Unis -le même constat vaut aussi pour les droits européens. Elle relève essentiellement de la soft law et plus généralement des mœurs universitaires.
En l'espèce, aujourd'hui c'est l'Université d'Harvard qui est en première ligne dans cette offensive de l'administration Trump contre les universités. Un débat de fond. Le 11 avril dernier, par courrier, il était formulé une série d'exigences à la direction de cette université: la suppression des politiques en faveur de la diversité, des modifications de programmes accusés " d'alimenter le harcèlement antisémite", ainsi qu'un "audit" des opinions exprimées par les étudiants et les enseignants. En réponse, le président de Harvard, Alan Garber, a publié une déclaration adressée à la communauté universitaire: « l'établissement n'abdiquera pas son indépendance ni ses droits garantis par la Constitution... aucun gouvernement -quel que soit le parti au pouvoir- ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner, qui elles doivent peuvent admettre ou recruter, ni les domaines dans lesquels elles peuvent mener leurs recherches".
Menaces
En réaction, l'administration Trump dans un communiqué indique que "la Task Force conjointe de lutte contre l'antisémitisme" annonce le gel de 2,6 milliards de dollars de subventions sur plusieurs années", ainsi que la suspension de "contrats pluriannuels d'une valeur de 60 millions de dollars". A la suite de cette annonce, Donald Trump brandit plusieurs menaces: le retrait à l'université de l'exemption fiscale dont elle est bénéficiaire; 1'interdiction d'accueil d'étudiants étrangers si elle refusait un contrôle de ses politiques en matière d'admission, de recrutement et d'orientation idéologique; Dans cette même ligne, les républicains du Congrès annoncent 1'ouverture d'une enquête parlementaire visant à examiner le "manque de conformité de Harvard avec les lois sur les droits civiques". Le bras de fer se poursuit avec d'autres universités (Columbia, Cornell, Northwestern, Princeton, Brown,...) Plus de 200 présidents d'université ont signé une lettre dénonçant une "ingérence gouvernementale sans précédent" dans l'enseignement supérieur. Des procès sont en cours...
Cela dit, le constitutionnaliste est interpellé sur plusieurs points. Le premier porte sur le fait que la présidence impériale ne remonte pas à Trump: tant s'en faut. Elle lui était en effet antérieure. S'est ainsi développé une tendance du pouvoir exécutif - de la présidence donc des États-Unis - à agir de manière unilatérale avec l'aide des Exécutive Orders. Trump s'est engouffré dans cette brèche, pourrait-on dire, en multipliant les décrets présidentiels dans les premiers jours de son second mandat. Il faut préciser au passage qu'il avait déjà commencé son ingérence dans les universités américaines à la fin de son premier mandat. Autre remarque: le décret présidentiel du 29 janvier 2025 (Additional Measures to Combat Anti- Semitism) destiné à lutter contre l'antisémitisme. Ce texte a instauré une "Task Force" interministérielle. Or, c'est précisément cette Agence qui, le 4 avril 2025, a annoncé à l'Université d'Harvard le gel de 2,65 milliards de dollars de subventions fédérales.
Un populisme "anti-science"
Pour contester une telle suspension, le principal argument juridique pouvant être avancé est d'ordre constitutionnel. Ce n'est pas en effet le pouvoir exécutif - la Présidence et ses organes- qui est compétent pour décider de l'attribution ou du retrait des fonds fédéraux. L'on fait volontiers référence ici la notion de "spending power" (ou pouvoir de dépenser) qui désigne la capacité du gouvernement fédéral américain à influencer les politiques des États en conditionnant l'octroi de fonds fédéraux. Un outil constitutionnel et stratégique utilisé depuis longtemps. Des exemples notables historiques notables sont à citer: Reagan en 1984 ( baisse du financement des autoroutes pour les États n'ayant pas relevé l'âge légal pour boire à 21 ans); Bush/ Obama (conditionnement de l'aide éducative à l'adoption de standards nationaux "No Child Left Behind"); Obama (expansion de Medicaid encouragée par financement fédéral). Avec Trump en 2025, ce levier est utilisé de manière plus coercitive et politique. Cet épisode trumpiste est encore plus préoccupant tant les atteintes à la liberté académique semblent ici multiformes avec une ingérence de l'État fédéral dans tous les domaines - du contenu des enseignements à l'orientation de la recherche. Se révèle sans doute le plus grave: un populisme "anti-science" ou " anti-scientifique". De quoi rappeler mutatis mutandis la "chasse aux sorcières" du maccarthysme des années cinquante...