société
Souvenirs en temps de confinement

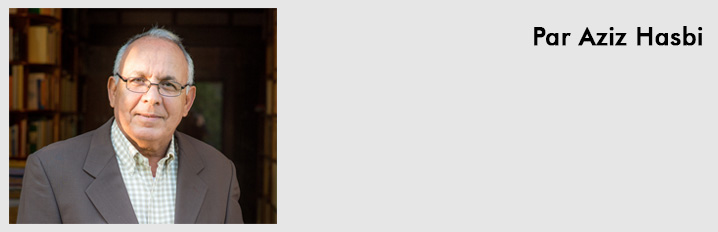
Dans une vie, on accumule beaucoup de dettes, non pas celles que l’on rembourse grâce à des numéraires, mais les autres qui, elles, relèvent de l’immatériel. Parmi ces dernières figure celle que j’ai envers mon quartier qui avait abrité mes années d’enfance et de jeunesse. Je voudrais ici rendre hommage à ce lieu et à cette époque.
Mon quartier n’est pas un lieu-dit parmi tous ceux qui allaient ceinturer progressivement Casablanca, au moment où l‘industrie naissante de celle-ci avait besoin de plus en plus de main-d’œuvre et que l’exode rural allait alimenter à souhait. Il est particulier, du moins pour ses habitants. Il a pendant longtemps porté le nom éponyme de Carrières centrales, renvoyant aux carrières qui alimentaient l’usine des Chaux et Ciments (Lafarge ou chapou comme on avait l’habitude de le désigner en référence aux hautes cheminées de l’usine). Après la fameuse visite de Feu Mohammed V en 1956, il portera le nom de Hay Mohammadi. La première appellation, expurgée à terme de ses sous-entendus péjoratifs, n’avait pas été abandonnée pour autant. Elle fait partie du patrimoine historique du Hay. Feu Mohammed V était lui-même qualifié de « Sultan des Carrières Centrales ».
A la naissance du prolétariat
Cette partie périphérique de Casablanca avait vu naître les premiers foyers de prolétaires et attiré les futurs noyaux de syndicalistes et de militants du Mouvement national, notamment feu si Abderrahmane El Youssoufi. Cette situation créait une dynamique et une vie au sein de cette mosaïque ethnique. Confrontés à la pénibilité du travail à l’usine et à sa nouveauté par rapport aux occupations agraires ou pastorales du village d’origine, exposés aux ordres venant de personnages ne parlant pas la langue du pays et affichant dans leur relation avec les ouvriers un air résolu et sans aménité, les travailleurs perdaient petit à petit leur spontanéité et leur naïveté de ruraux. A la place, ils développaient la volonté de s’en sortir, le rejet de l’indignité et l’attachement aux valeurs sociales de base telles que le respect de la parole donnée et la solidarité. Il me semble que ce sont ces pistes de sociabilité que ce microcosme en formation avait essayé de transmettre à la génération de la veille de l’indépendance à laquelle j’appartiens.
Mon quartier est donc, d’abord, un certain nombre de principes qui n’ont jamais figuré dans un corpus formalisé, mais que nos familles, nos voisins, nos rues, nos écoles nous ont inculqués sur le tas. Il est vrai que tous les jeunes n’ont pas assimilé ces enseignements de manière identique.
Mon quartier, c’est aussi la famille qui luttait pour nourrir sa progéniture souvent prolifique. Gens du peuple, ils mettaient un orgueil excessif à mettre à l’abri leur maisonnée. Cette ferveur face au devoir suscitait le respect de l’épicier qui faisait crédit : le petit carnet à spirale, aux pages couvertes de chiffres d’une valeur aussi modeste que le budget de ceux qui y avaient recours, était légion. Les besoins de dernière minute étaient satisfaits par des emprunts à la voisine : les enfants faisaient le facteur et répétaient toujours et sur un ton mi-effronté mi-doucereux le même refrain : « ma mère te demande un peu de… ». Tout entrait dans cette sollicitation : un peu de sel, de levure… et même parfois un verre d’huile. La famille nous montrait ainsi le chemin de la solidarité et de l’empathie. Les uns et les autres retrouveront en temps opportun cet élan vers l’Autre. Ils solliciteront le soutien et le conseil précieux chez ceux qui étaient capables de les donner et, à défaut, une prière adressée à Dieu pour aider les requérants.
Derb Moulay Ch’rif
Mon quartier, ce sont ses rues, portant souvent un numéro ; les noms de quelques rues d’importance viendront beaucoup plus tard. Les déménagements de ma famille, qui n’était pas propriétaire de son logement, m’avaient permis de nomadiser à travers Derb Moulay Ch’rif, la partie la plus vieille du quartier. Dans la rue 18, celle d’Ali Ouarda, de Skouri et d’autres, ma famille avait habité la maison qui tournait le dos à celle où habitait Boujmî, future star de Nass El Ghiouane. Au bout de la rue, logeait la famille d’Omar Essayyed. C’était un grand garçon affable qui affichait une certaine timidité. Ce label sera pourtant perdu à mes yeux le jour où je l’avais vu monter sur l’estrade de Dar Chabab pour chanter un air de Farid Al Atrache. Je n’aurais jamais osé le faire ! Ces deux camarades fréquentaient la même école et partageaient leur passion musicale naissante. Ce hobby a été à l’origine de la formation plus tard du groupe Nass El Ghiouane qui a révolutionné la musique marocaine et s’est taillé une grande réputation qui a largement débordé les frontières nationales.
Cette rue 18, première étape des pérégrinations familiales, était aussi celle des amateurs forcenés de football qui affrontaient des joueurs venant d’autres parties du quartier. Leur terrain de prédilection était la voie réservée aux gros camions qui transportaient les énormes blocs de calcaire destinés à l’usine de ciment. Elle passait juste derrière la rue 18. Les footballeurs prenaient le relais des camions, lorsque ceux-ci arrêtaient leurs va-et-vient en fin d’après-midi. Je n’avais pas l’âge de fréquenter cette équipe spontanée et mobilisable à toute occasion. Mais je ne crachais pas sur le spectacle des échauffourées qui ne manquaient pas d’opposer les protagonistes à la fin de certains matches. Il y avait aussi un étudiant en médecine entouré d’une véritable aura et qui, probablement, faisait rêver plus d’une jeune fille. Je découvrais alors le grand respect voué aux porteurs du savoir. J’adhérais à ce sentiment collectif, tout en enviant un peu le récipiendaire. On ne voyait l’enfant prodige qu’occasionnellement, lorsqu’il était de retour de Rabat ; cette ville que mon imagination n’arrivait pas à capter.
Le séjour familial dans cette rue fut de courte durée. Je continuais pourtant à m’enorgueillir constamment d’avoir habité à côté de ces noms dont certains allaient devenir prestigieux. Même aujourd’hui, je ne manque jamais d’y faire allusion lorsque l’occasion se présente.
La rue 4 allait retenir ma famille plus longtemps. Elle donne sur celle qui portait le numéro 1, et qui hébergeait le siège local du parti de l’Istiqlal. C’est là où on côtoyait les scouts, où on pouvait prendre des « cours » de théâtre, où on pouvait collecter des bribes des faits et gestes épiques de cette formation politique, comme nous les présentaient fièrement certains de ses militants. Plus tard, après 1958 et la scission de l’aile gauche du parti, nous entendrons d’autres sons de cloche auprès des animateurs du siège de l’UNFP, à quelques rues de là.
Mon nouveau lieu d’habitation m’avait davantage enraciné dans le quartier. J’y avais retrouvé des camarades de classe et je m’y étais fait des amis. J’y avais pratiqué pendant un moment tous les jeux de rue. Je m’y étais battu après des petits matches de football (c’est un peu pompeux étant donné la qualité médiocre des ballons sur lesquels tapaient nos pieds nus). C’était là où je commençais à prendre conscience de ma petite personne et de mes émotions. C’était là où je commençais à remarquer les jeunes filles. C’était là où je commençais à attirer l’attention des sages de la rue qui, remarquant mon assiduité entre l’école et le jamâa (m’sid) où m’envoyait mon père après les heures de classe, ne manquaient pas de m’encourager. J’essayais de soigner davantage ce côté de moi-même afin de mériter cet intérêt. C’était là où j’avais eu mon diplôme de certificat d’études et mon entrée en sixième. C’était là où j’avais appris les choses qui allaient me servir plus tard et connu des personnes auprès desquelles j’allais solliciter des conseils.
La bonne école publique
Ma famille avait poursuivi sa nomadisation en s’installant à Derb Essaad, la partie la plus récente de Derb Moulay Ch’rif. Il n’existait pas au moment où j’avais intégré l’école Othon Gambert en octobre 1955. C’était encore un grand terrain vague. Mon école jouxtait la fameuse cité Socica que j’évitais à cause de la mauvaise réputation de ses gangs de jeunes portés sur la violence. Je ne soupçonnais pas que je longeais chaque jour les murs d’un véritable trésor architectural. Et pour cause : j’étais à des années-lumière des préoccupations artistiques.
L’école avait été pour moi et pour beaucoup de jeunes du Derb le monde qui nous avait aidé à voir d’autres horizons et à comprendre que l’éducation était la seule issue pour les déshérités que nous étions d’échapper au sort de nos parents qui s’usaient la santé à vue d’œil pour nous offrir le peu qu’on pouvait avoir. L’école, notre école publique, prenait en charge notre éducation en nous mettant entre les mains d’excellents maîtres. Sa petite cantine améliorait l’ordinaire d’un certain nombre d’entre nous. Elle s’occupait de notre état de santé et de notre hygiène : campagne de soins des yeux, des dents, poudrage désinfectant et épouillage, vérification de la propreté des ongles...
Mon école avait attisé en moi la soif d’apprendre et l’ambition de réussir. Au moment où je finissais l’école primaire, les études et les diplômes devenaient populaires et visibles, car tout le monde assistait à l’embauche des premiers lauréats par la jeune administration du Maroc nouvellement indépendant, les banques, les écoles normales, etc. Les diplômés des écoles professionnelles remplaçaient progressivement les cadres moyens étrangers. Peu de gens étaient à l’époque conscients des possibilités encore plus grandes que donnaient les études universitaires. Mais cela ne saura tarder.
Mon école me permettait d’apprendre à parler les yeux dans les yeux avec mes maîtres, et de sortir ainsi progressivement de la phobie de regarder les adultes en face. Elle m’avait appris à utiliser le système « D » pour l’acquisition de certains livres liés au programme, autres que ceux fournis par l’école et utilisables en classe. Pour ce faire, je m’adressais aux élèves qui me devançaient. Je courais également les bouquinistes, ceux du souk fougani, à la lisière du grand bidonville des Carrières Centrales, profitant chaque fois des spectacles que fournissaient les halqa. Je fréquentais aussi, à côté de mon école, la minuscule échoppe d’El Yazid, bouquiniste et marchand de pépites et autres cacahuètes. Il avait fini par pratiquer le commerce des livres d’occasion et la location des illustrés et des romans-photos à l’eau de rose. Il était analphabète.
La lecture, un refuge
Mes années de collège, entrecoupées de deux séjours prolongés à l’hôpital, et une année orpheline au lycée Mohammed V avaient quasiment parachevé ma maturité. La lecture, abondante et variée, allait devenir mon refuge et mon passe-temps, puisque j’allais être définitivement privé des activités des jeunes de mon âge. Mon statut de garçon tranquille et réservé me facilitait le contact avec des gens plus avancés en matière d’études. Auprès d’eux, je bénéficiais de conseils dans les moments où j’avais besoin d’avis plus autorisés que ceux que je trouvais auprès de ma famille. Cette proximité occasionnelle avec ceux qui connaissaient beaucoup plus et beaucoup mieux que moi m’avait appris à relativiser et à évaluer à la baisse mon bagage intellectuel. Et du même coup, à chercher à apprendre plus et mieux. Pourtant, aussi bien au collège qu’au lycée, j’engrangeais bonnes notes et prix d’excellence.
Après le départ précoce, contraint et précipité du lycée, je fus engagé à l’ONE. Nous déménageâmes de Derb Essaad, par la suite, pour nous installer au quartier Belvedère.
Au total, en quittant le Hay, j’avais déjà acquis l’essentiel des démarches qui allaient guider mes pas dans la vie. J’allais les enrichir au fur et à mesure des étapes par lesquelles transitera mon parcours. Tous ces premiers enseignements, je les dois d’abord à ma vie dans mon quartier. En sortant de celui-ci, je ne le quittais pas, puisqu’une bonne partie de ma famille et celles de mes amis continuaient à y vivre. J’y revenais aussi pour me ressourcer comme la plupart de ceux de mes camarades. J’y retourne encore aujourd’hui pour mon grand plaisir, même si les nouveaux visages me sont inconnus.
Le hay dans la peau
Ma relation avec le Hay repose sur un lien indéfectible. J’ai envers lui une dette qui a continué à générer des intérêts, puisque ma qualité d’ancien du Hay est une référence très solide dans ma vie et dont j’use à volonté. Du reste, elle m’a attiré un certain nombre de sympathies et d’atouts. Ainsi, durant ma mission en tant que recteur de l’université de Casablanca, ce statut avait milité positivement en ma faveur. J’étais pour les Casablancais un des leurs. Du reste, la rage que j’ai mise à remplir ma tâche était en partie dédiée à mon quartier. Je n’avais pas pu m’associer aux activités qui avaient intéressé Hay Mohammadi, car celui-ci avait été trusté par les politiciens. Or je ne cherchais pas à immerger dans ce monde dont les règles du jeu et les ententes qui en résultaient m’échappaient. Du coup, je garde la sensation de ne pas avoir rendu à mon quartier un peu de ce qu’il m’avait prodigué avec générosité.
Le Hay est pour moi une appartenance gratifiante. Il m’a armé de la volonté de m’en sortir et m’a doté d’un repère solide. Je ressens toujours un plaisir quasi juvénile lorsque j’évoque mes souvenirs de l’époque avec mes camarades de quartier et de classe. Et nous ne nous privons jamais d’en parler sans nous lasser, chaque fois que l’occasion se présente. Les relations entre les anciens du Hay sont marquées par une singularité : lorsque nous nous retrouvons ou nous nous parlons au téléphone, nous avons les uns et les autres l’impression de nous être quittés la veille, alors que les occasions sont parfois, et avec certains, de plus en plus rares et espacées. La fierté de l’appartenance à cette entité constitue un ciment pour nos relations. Ceux qui ont vécu leur enfance au Hay ont celui-ci dans la peau. C’est pour eux une seconde nature. Faire revivre son souvenir et lui rendre hommage est pour eux un véritable sacerdoce.
Le temps du confinement a été mis à profit par beaucoup d’entre nous pour reprendre le contact et parler du quartier. Nos mémoires ont eu une opportunité de choix de se rafraîchir. Je me suis rappelé des noms de personnes et de lieux, des dates de certains événements. Un ami m’a rapproché avec beaucoup de savoir-faire de l’architecture de certaines des cités ouvrières du Hay. J’ai retrouvé chez des amis des photographies de l’époque. Celle de la classe de CM2 (1960-1961) m’a fait un immense plaisir. Elle montre combien nos maîtres d’antan avaient de la prestance et combien nos accoutrements étaient modestes mais propres.
Rabat, le 9 juin 2020





















