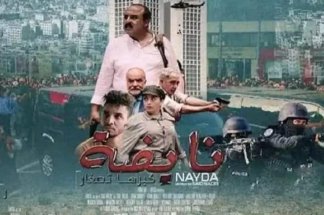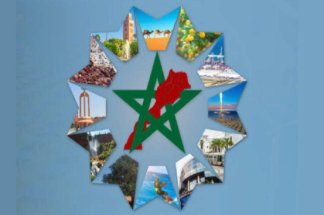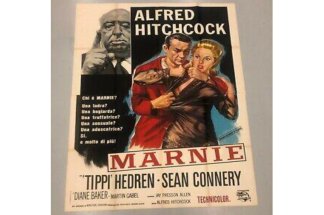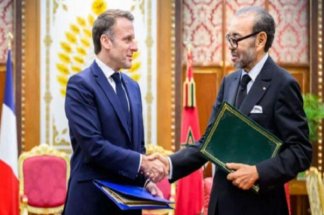chroniques
Les taux de réussite au baccalauréat et de la diminution des taux de fraude signifient-ils vraiment encore quelque chose ? – Par Bilal Talidi

Il existe une grande corrélation entre les taux de réussite et de fraude. Les établissements qui affichent les taux de réussite les plus élevés ont nécessairement des taux de fraude plus faibles. Cela ne signifie pas que la fraude n'a pas contribué à la réussite
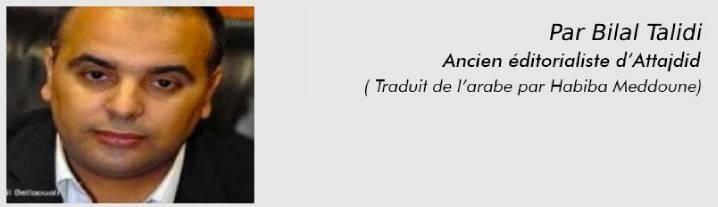
Il ne fait aucun doute qu'à l'annonce des résultats du baccalauréat, tout le monde se tournera vers deux chiffres importants : le premier concerne le taux de réussite et le second, le taux de fraude.
D'un point de vue quantitatif, ces deux taux sont des indicateurs importants pour mesurer l'amélioration du niveau des apprentissages et pour situer le système éducatif. C'est ce qui pousse les établissements d'enseignement privé à afficher sur leur portail principal les taux de réussite de leurs élèves comme une partie de la publicité pour leur mission éducative.
Dans les établissements d'enseignement public, ces chiffres jouent un autre rôle, car ils sont utilisés pour classer les établissements scolaires. Par conséquent, le financement et l'attention accordés aux écoles d'excellence tiennent compte de ces indicateurs. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale, dans un premier temps, avant de trouver les moyens de généraliser le projet d'excellence, sera obligé d'utiliser ces chiffres pour sélectionner les écoles concernées.
Il existe une grande corrélation entre les taux de réussite et de fraude. Les établissements qui affichent les taux de réussite les plus élevés ont nécessairement des taux de fraude plus faibles. Cela ne signifie pas que la fraude n'a pas contribué à la réussite. L'indicateur de la fraude repose essentiellement sur l'existence de rapports écrits par le comité de surveillance. En l'absence de tels rapports, de nombreux cas de fraude ne sont pas pris en compte dans ces indicateurs.
En réalité, tous les ministères successifs ont veillé à augmenter les taux de réussite et à diminuer les taux de fraude. Cependant, après avoir annoncé ces chiffres rassurants, ils se retrouvaient confrontés à des données choquantes révélées par des institutions constitutionnelles qui remettent en question la fiabilité de leurs chiffres, notamment en ce qui concerne les taux d'acquisition des connaissances dans certaines matières scientifiques, les compétences en lecture et la maîtrise des langues, parallèlement à l'abandon universitaire enregistré dans les premières années peut parfois atteindre 60 %.
La situation est paradoxale comme il apparait, car les taux annoncés ne reflètent pas vraiment la réalité. La raison principale est qu'il existe une tradition erronée qui lie la performance du ministère de l'Éducation nationale aux taux de réussite au baccalauréat et utilise un double critère pour traiter à la fois l'excellence et le décrochage scolaire.
Il est très compréhensible que l'accent soit fortement mis sur les indicateurs de décrochage scolaire, car les critères qui évaluent la qualité des apprentissages dans les cycles primaire, moyen et secondaire se concentrent sur cet indicateur. De plus, une part importante du financement extérieur inclut dans ses recommandations la lutte contre le décrochage scolaire. Cependant, au niveau universitaire, cet indicateur n'est pas mis en lumière, et la question du sort des étudiants qui quittent les établissements universitaires dès la première année, notamment dans les filières littéraires, économiques et certaines branches scientifiques, n'est pas posée.
En ce qui concerne les taux de réussite, la tradition erronée qui persiste au sein du ministère de l'Éducation nationale continue à inventer de nouvelles idées pour s'adapter, remplissant les examens du baccalauréat de questions très simples et de cadeaux flagrants qui ne testent ni l'intelligence ni les compétences des élèves, dans le but évident d'augmenter les notes obtenues.
Le mécanisme qui régit cette tradition corrompue doit être complètement démantelé, et en particulier, la relation entre les taux de réussite et les taux de fraude doit être rompue. Si la compétitivité entre les établissements doit être fondée sur la rivalité, cette compétition doit être réelle, sans instructions orales préalables qui incitent subtilement à la tricherie. Il existe de nombreux obstacles et pratiques conservatrices qui poussent les cadres éducatifs à tolérer la fraude, ou au moins à se contenter de retirer les documents et les téléphones des mains des élèves sans rédiger de rapports sur les incidents de tricherie. De plus, l'utilisation pour la forme des dispositifs électroniques pour détecter les téléphones introduits par les élèves dans la salle d'examen doit cesser.
Les résultats de cette tradition corrompue, adoptée par le ministère de l'Éducation nationale depuis le lancement du programme d'urgence, montrent que la fraude est devenue omniprésente. Elle crée des institutions réputées, pénalise celles qui luttent contre la fraude et envoie à l'université une large tranche d'étudiants non qualifiés qui ne peuvent pas s'adapter, les poussant à quitter l'université dès la première année. Les choses continuent ainsi jusqu'à ce que l'échec de la réforme soit proclamé, puis une nouvelle réforme est lancée, qui échoue également, plongeant tout le monde dans ce que le roi a appelé "la réforme pour la réforme".
Il y a des transformations énormes qui dépassent la capacité des institutions et des cadres éducatifs à les comprendre. Une grande partie de la nouvelle génération d'apprenants associe désormais leur avancement scolaire à la tricherie, considérant l'effort et l'acquisition des connaissances comme une perte de temps. Au lieu que chacun assume sa responsabilité face à ce phénomène, chaque acteur adopte une attitude d'adaptation et essaie de concilier ce comportement de manière détournée pour ne pas être accusé de promouvoir directement la tricherie scolaire.
Il dit que si la lutte contre la fraude avait été menée comme il se doit, les résultats auraient été catastrophiques, obligeant le ministre à démissionner et déclarant l'éducation dans le pays en état de catastrophe nationale.
En réalité, cette catastrophe existe, et tout le monde en est conscient, mais personne ne veut l'affronter avec un discours clair et des mesures concrètes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se demander qui est responsable, ni d'imputer des responsabilités à des politiques pratiquées depuis des générations. Il s'agit d'avoir le courage politique de dire les choses telles qu'elles sont et de commencer là où il faut commencer, même si les taux de réussite tombent en dessous de vingt pour cent.
Une ou deux années de confrontation avec la vérité rétabliront la valeur de l'apprentissage et de la persévérance comme les seuls fondements de la réussite. En revanche, continuer à observer le statu quo et annoncer des taux de réussite de quatre-vingts ou quatre-vingt-dix pour cent ne résoudra pas le problème de la baisse des compétences en lecture, de la diminution du niveau d'acquisition des connaissances dans plusieurs matières, de la détérioration de la maîtrise des langues, de l'augmentation alarmante des taux d'abandon à l'université, sans parler de la baisse des taux de recherche scientifique et du recul du classement des universités marocaines en conséquence.