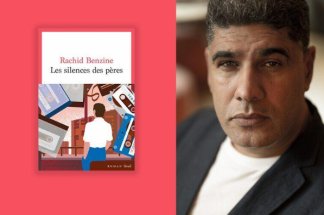Culture
Du Renaudot (1968) au Goncourt (2021) ou les riches heures africaines des Lettres d’expression française – Par Abdejlil Lahjomri (4ème partie)

Mohamed M’Bougar Sarr, Prix Goncourt (2021) –‘’La question, fondamentale, qui […] retiendra notre attention dans ces chroniques est la réception de l’œuvre, donc de la lecture, surtout la réception des œuvres africaines dans l’espace occidental, en arrière-plan d’une réussite aussi spectaculaire que celle du prix Goncourt ou de tout autre prix prestigieux. Question dont l’ambivalence est toujours d’actualité et l’ambiguïté du positionnement entre le centre et la périphérie toujours déconcertant

Dans cette série de chroniques consacrées au Goncourt 2021, le sénégalais Mohammed Mbougar Sarr pour La plus secrète mémoire des hommes, Abdejlil Lahjomri s’est principalement intéressé dans les trois premières à celui qui a inspiré à Mbougar Sarr le personnage de son roman, Yambo Ouologuem, romancier malien qui fut lauréat du prix Renaudot en 1968 pour son ouvrage intitulé ‘’Le Devoir de violence ‘’. C’était nécessaire voire condition sine qua non pour comprendre ce que Mbougar Sarr nous déconseille de faire : chercher à savoir ce dont il parle car à l’en croire « seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose ». Toute une histoire ! Compliquée et complexe que le Secrétaire perpétuel, de l’Académie du Royaume qui travaille à la création d’une Chaire des Lettres africaines, tente de dénouer en plongeant dans les méandres du concept centre/périphérie, si cher à Sami Amine en économie, mais qui s’applique comme pour tout ce qui est économique, à tout le reste, y compris à la culture en dépit de la prétention de celle-ci à tout couvrir et recouvrir.
Dans « La plus secrète mémoire des hommes » Mohamed M’Bougar Sarr, Prix Goncourt (2021) écrit ceci : « Un grand livre ne parle jamais que de rien, et pourtant tout y est ; ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu’il est grand. Ce piège est celui que l’opinion te tend. Les gens veulent qu’un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité c’est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n’a pas de sujet et ne parle de rien, il cherche seulement de dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout ».
Lire aussi : Du Renaudot (1968) au Goncourt (2021), Les riches heures africaines des Lettres d’expression française – Par Abdejlil Lahjomri (1ère partie)
Le roman de Mohamed M’Bougar Sarr est un grand livre. Donnons raison à son auteur et ne tombons pas dans le piège, comme il nous le conseille, de vouloir dire de quoi il parle et essayons de découvrir ce « seulement », qui est tout, dont il nous invite à entreprendre la recherche. Il nous demande en réalité de nous engager dans une quête, comme le principal personnage de son roman T.C. Elimane. Une quête, si on est écrivain, qui aboutit à écrire « Le Livre de Rien » et si on ne l’est pas de cerner les questions qui le structureraient. L’auteur de ce « Livre de Rien », qui est tout, qu’est le Goncourt 2021, présenté comme un « chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel » nous révèle surtout « qu’il se peut qu’il n’y ait rien à trouver dans la littérature ; qu’elle est un cercueil suspect, noir et brillant […] il est possible qu’il ne renferme aucun cadavre ». La littérature ne serait donc qu’un cercueil vide. Résumer La plus secrète mémoire des hommes serait vaine et inutile. L’auteur nous invite plutôt à éviter cet exercice, et à ne voir dans tout grand livre qu’une œuvre qui ouvre une question nouvelle, de nouvelles interrogations. En disant que Mohamed M’Bougar Sarr est un formidable écrivain, que son roman est étourdissant, exigent, étonnant, parfois envoûtant, on aura tout dit du bonheur de l’avoir lu et du plaisir de l’avoir relu. Alors quelle question nouvelle nous convie-t-il à ouvrir ? Quelles interrogations inédites nous conseille-t-il de chercher dans son œuvre surprenante. Si l’écrivain est pour lui un enquêteur, le critique l’est autant pour nous qui cherchons à dévoiler des questions. Il se trouve que le lauréat du Goncourt 2021 avait lui-même énuméré quelques-unes dans une de ses multiples interviews, par exemple : la question de l’écriture, de son énigme, de ses mystères, celle du silence de l’écrivain, du sens de la littérature, de celui de la quête existentielle par la littérature, celle de l’écriture comme lutte contre toutes sortes d’oublis, d’abus, comme dévoilement de tout ce qui est abimé en nous, pour finalement poser la plus essentielle d’entre ces interrogations, à ses yeux et aux nôtres ; celle de tenter de comprendre pourquoi l’écrivain ne sait pas pourquoi il écrit. Toutefois la question, fondamentale, qui cependant retiendra notre attention dans ces chroniques est la réception de l’œuvre, donc de la lecture, surtout la réception des œuvres africaines dans l’espace occidental, en arrière-plan d’une réussite aussi spectaculaire que celle du prix Goncourt ou de tout autre prix prestigieux. Question dont l’ambivalence est toujours d’actualité et l’ambiguïté du positionnement entre le centre et la périphérie toujours déconcertante.
Lire aussi : Du Renaudot (1968) au Goncourt (2021), les riches heures africaines des lettres d’expression française – par Abdejlil lahjomri (2ème partie)
Faudra-t-il pour que cette réception aille de la périphérie au centre que le récit se libère de ses consonances africaines ? C’est ce que semble suggérer un curieux épisode où le Président du jury Goncourt n’a pas manqué de rappeler « les tournures africaines » de certaines phrases dans La secrète histoire des hommes. Mohamed M’Bougar Sarr n’y voit « qu’une petite maladresse, sans malice » et ajoute que « Didier Decoin a aussitôt ramené le livre vers la littérature et l’a tellement défendu comme œuvre littéraire ». Cependant il n’y a pas si longtemps on assistait plutôt à l’inverse. Pour qu’un grand livre bénéficiât d’un prix il fallait qu’il y ait cette résonance africaine ou que l’éditeur l’exigeât. Dans le début de sa magistrale étude « La Fabrique des classiques africains-écrivains d’Afrique subsaharienne francophone », Claire Ducournau rappelle un épisode significatif : « Ayant achevé un manuscrit intitulé (les crapauds) de Tierno Monémembo (pseudonyme de Thierno Saidou Diallo) l’adresse aux éditions du Seuil. Ce texte retient l’attention des lecteurs de la maison et s’y voit publié en 1976 […] moyennant quelques ajustements. Le titre devient ainsi les « crapauds-brousse » par un arbitrage éditorial final n’ayant reçu l’accord de Diallo qu’après le lancement de la publication, parce que le comité de lecture estimait que le premier choix ne sonnait pas suffisamment africain … ». Pour que l’œuvre investisse le centre il fallait impérativement qu’elle sonne africain. C’est pourquoi Mohamed M’Bouger Sarr parle juste quand il constate qu’au-delà de la réflexion du Président du jury Goncourt concernant « ses phrases à tournure africaine », « il y a parfois une sorte de malaise à parler en Occident des œuvres d’Africains. L’imaginaire colonial pèse encore sur le langage de l’évaluation, de la description, du jugement de la création ». Malaise qui a surement fait rater le prix Goncourt à Ahamadou Kourouma du fait de « ses manières trop africaines » selon Robert Sabatier, membre du jury de l’époque. L’auteur de La plus secrète mémoire des hommes veut nous convaincre que cette question de la réception est soldée et réglée dans ce face à face des Lettres africaines d’avec l’impératif parisien. Mohammmed M’Bougar Sarr concluait : « En vingt ans les choses ont évolué. De tels propos ne peuvent plus être tenus aujourd’hui ». Il n’y aurait donc plus de centre. Le centre serait partout. Les éditeurs n’exigeront donc plus pour qu’elles soient publiées hors d’Afrique que les œuvres africaines ne sonnent plus africain ? Ce serait une espèce de révolution copernicienne qui donnerait raison aux signataires du manifeste « Pour une littérature-monde », qui dénonçaient l’exigence d’une connotation africaine, incontournable, pour que ce genre d’œuvres méritât au moins une publication, et si elles étaient éblouissantes, un prix. Les signataires de ce manifeste invoquaient l’universalité de l’acte de créer, pulvérisant le centre et les périphéries. Un grand livre qu’il soit africain ou autre est grand parce qu’il parle de la condition humaine, et que la culture qui l’a fait naître l’a fait naitre universel.
Lire aussi : Du Renaudot (1968) au Goncourt (2021), les riches heures africaines des lettres d’expression française – Par Abdejlil Lahjomri (3ème partie)
Ce manifeste sur « La littérature-monde » a encouragé un certain nombre de chercheurs à poser la question suivante : « La littérature africaine n’existe-t-elle pas ? » Kossi Efoui, écrivain togolais, affirme dans une interview publiée dans l’ouvrage Désir d’Afrique chez Gallimard en 2022 : « La littérature africaine est quelque chose qui n’existe pas. Quand Sony Labou Tansi écrit, c’est Sony Labou Tansi qui écrit, ce n’est ni le Congo, ni l’Afrique ».
La littérature africaine existe-t-elle ou pas ?
Voilà une des questions que Mohamed M’Bougar Sarr nous a invité à découvrir en lisant La plus secrète mémoire des hommes , « Ce seulement qui est tout » compose un chapitre essentiel dans la thèse de Tal Sela sur le « Roman africain francophone au tournant des indépendances (1950-1960) : la construction d’un nouvel écho d’auteur « consacré à l’existence ou non de la littérature africaine ». (A suivre)