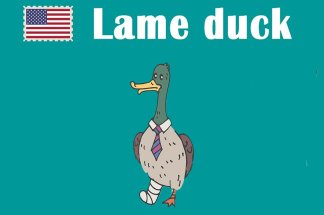chroniques
Algérie Mon Amour

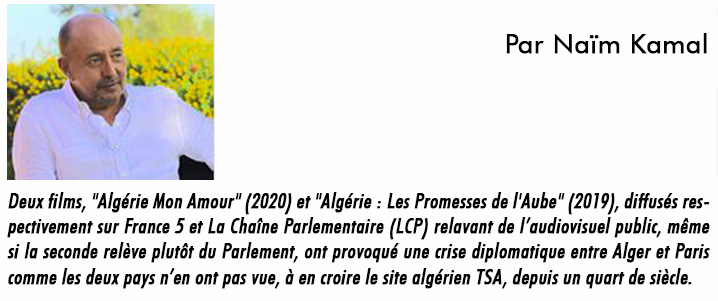
La dernière fois où l’Algérie a eu à rappeler d’urgence pour consultation son ambassadeur dans la capitale française remonte au milieu des années 90 du siècle dernier.
La crise de nerf dictant l’urgence était telle que le diplomate Salah Lebdioui a été rapatrié par vol spécial, le trafic aérien étant suspendu en raison de la pandémie. On ne peut mieux insister sur la gravité du moment.
L’ire algérienne n’est pas infondée, tant il est vrai que si France Télévisions avait diffusé un documentaire similaire sur le Maroc, on ne comprendrait pas au Quid que Rabat ne réagisse pas énergiquement. C’est que pour notre site le problème n’est pas tant dans le contenu du documentaire, mais dans sa diffusion par une chaine française relevant d’un pouvoir qui a souvent l’outrecuidance et la mauvaise habitude de vouloir faire croire à nous autres maghrébins que cet audiovisuel est libre de ses mouvements. La diffusion de film objet du litige serait sans arrière-pensée et à peine si la réaction d’Alger ne serait pas symptomatique de son extrême fragilité et caractéristique d’une paranoïa psychotique.
Criant de vérités
Ce qui n’enlève rien à la justesse et à la sensibilité du docufilm. Dans « Algérie Mon Amour », consacré au Hirark algérien qui a eu raison des prétentions de Abdelaziz Bouteflika sans rien changer au cœur du système algérien, il n’y a rien qu’un site algérien comme TSA, par exemple, puisse renier. Aux premières loges du mouvement, avant d’être contraint, de guerre lasse, de rentrer dans les rangs, il a exactement rapporté par ses mots ce que donne à voir par le son et l’image le docufilm de Mustapha Kessous.
Quadra, français d’origine algérienne, l’auteur met en scène cinq jeunes algériens : un jeune « disjoncté » branché Métal ; un jeune avocat, apparemment kabyle mais la tête bien faite ; un jeune ingénieur parti essayer l’immigration et qui est revenu et n’en revient pas d’être revenu ; une jeune psychiatre, elle aussi apparemment kabyle, qui s’éveille éberluée mais débordante de pertinence à une « révolution » qu’elle n’attendait plus ; et une jeune technicienne de cinéma , Hania, sublime par la clarté de sa locution et l’expressivité de sa mimique.
Artistiquement raccordés, sur fond d’images d’un Hirak frais et joyeux, heureux d’être enfin dans la rue, Ils racontent leur Algérie, leur accablement, leurs désillusions et clouent au ban de la société, en attendant le banc des accusés, un pouvoir vieillissant dirigé par une ploutocratie de gérontocrates qui leur ont fait perdre jusqu’à l’estime d’eux-mêmes. Un docufilm criant de vérités, 70 minutes haletantes qui se terminent, pour leur bonheur et le notre sur une note d’espoir qui assimile le Hirak à des bourgeons qu’il faudra tendrement couver pour le jour où ils finiront par faire fleurir aux Algériens leur printemps.
Monte le générique et on en garde que des sentiments mitigés vacillant de la tendre sensibilité du film au goût aigre de l’inachevé. Et une splendide baie d’Alger qui recèle un monde de frustrations. Les lumières, crues, s’allument sur une diplomatie algérienne fébrile dans son attente d’une « explication franche » avec la France sur « les (nombreux) sujets de tensions connus entre les deux pays. En tête de liste, nous apprend TSA, le « Sahara occidental ».
Figeant et affligeant. On ferme les yeux qu’on n’en croit pas et l’on se retrouve dans un autre film : L’Algérie est encore en 1976, le mur de Berlin n’est pas tombé, l’Union Soviétique est au faîte de sa gloire, le Hirak n’a pas eu lieu, le coronavirus ancêtre du Sars-CoV-2 n’a pas encore muté, le million de martyrs est aussi vivant qu’auparavant , Houari Boumediene est toujours à la tête du conseil de la révolution de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika son fringuant ministre des Affaires étrangères, Abdelmadjid Tebboune, à peine la majorité révolue, fonctionnaire moyen dans la Wilaya de Djefla, très loin de se douter qu’un jour il sera président de cette Algérie qui ne bouge pas.