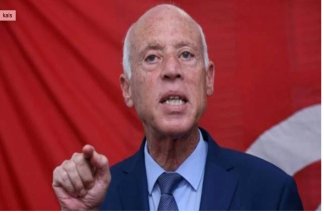chroniques
Parution : Archéologie du passé judiciaire de la monarchie marocaine - Par Talâa Saoud Al Atlassi

Le sultan Moulay Ismaïl a adressé en 1698 une lettre au roi d’Espagne Charles II lui proposant de livrer cinquante chrétiens en échange de « cinq mille livres pour chaque chrétien, parmi les ouvrages islamiques authentiques, choisis parmi ceux conservés dans leurs bibliothèques à Séville, Cordoue et Grenade… »
De Moulay Ismaïl à Mohammed VI, la monarchie marocaine a toujours fait de la justice un pilier central de sa gouvernance. À travers des lettres, décrets et initiatives royales, un nouvel ouvrage met en lumière une tradition séculaire d’équité, d’écoute du peuple et de respect du droit, révélant ainsi l’ancrage historique d’un pouvoir soucieux de justice et de dignité, écrit Talâa Saoud Al Atlassi qui a consulté l’ouvrage.
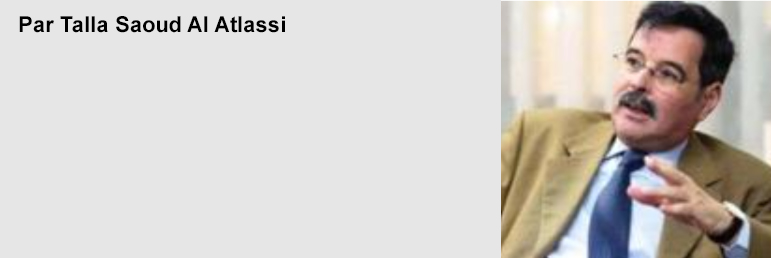
L'ancienneté de l'État marocain, imprégnée d’une longue histoire qui traverse ses structures et sa culture, puis s'étend au tissu social qui l'abrite et le soutient, trouve des milliers de témoignages et de manifestations dans le patrimoine matériel et immatériel, dans les vestiges historiques, et dans la vitalité de la gouvernance monarchique du Maroc. Parmi les multiples aspects de cette dimension de la monarchie marocaine, je me suis arrêté sur des éléments qualitatifs et significatifs de l’axe judiciaire de l’État, rassemblés dans un ouvrage important publié par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire : un livre élégant dans sa forme et précieux par son contenu.
Ce livre documente l’intérêt porté par les souverains de la dynastie alaouite à la justice. En raison de la diversité des documents rassemblés par ses auteurs — dahirs, lettres — l’ouvrage dépasse le seul cadre de l’histoire judiciaire pour offrir un aperçu, même succinct, de certains pans de la monarchie marocaine dans son authenticité, dans le respect des engagements de la bai‘a (البيعة -allégeance) liant le peuple marocain à ses rois, et surtout dans sa continuité historique enrichie par les apports successifs des rois et des dynasties.
Une recherche de longue haleine
Les rois de ce siècle appartenant à la dynastie alaouite — les regrettés Mohammed V et Hassan II, ainsi que le roi Mohammed VI — sont représentés dans l’ouvrage par de nombreux documents détaillant leur attachement à la question judiciaire. Ce n’est toutefois pas le cas pour les souverains antérieurs, depuis Moulay Ismaïl (1672–1727) jusqu’au sultan Moulay Abdelaziz (1896–1908), pour lesquels la documentation sur leur lien à la justice a nécessité un effort considérable de recherche et d’exploration.
Dans la préface du livre, le président délégué du pouvoir judiciaire et premier président de la Cour de cassation, M. Mohamed Abdennabaoui, qui a supervisé la réalisation de l’ouvrage, signale les difficultés rencontrées pour réunir les documents, dont beaucoup ont disparu au fil des siècles en raison de divers événements ou catastrophes naturelles, ou ont été endommagés par des conditions de conservation inadaptées. Il faut également noter que les juges conservaient souvent ces documents à titre privé, car ils étaient perçus comme des documents personnels liés à leur fonction, dans un système où le juge possédait une individualité propre.
La compilation du contenu de l’ouvrage a été rendue possible grâce à la consultation de livres et documents issus de la Bibliothèque royale, de la Direction royale des archives, ainsi que des archives de la Bibliothèque nationale de Tétouan et de certains tribunaux. Cela témoigne de la richesse documentaire du Maroc, révélatrice de la profondeur historique du pays et de la formation progressive, au fil des dynasties et des règnes, de la culture de l’État, de ses référentiels et de ses mécanismes. Malgré l’efficacité des institutions documentaires et la vitalité de la recherche historique, chaque plongée dans les événements et les institutions du passé met en lumière de nouveaux besoins d’éclairage pour dévoiler certaines zones d’ombre dans le patrimoine historique du Maroc. C’est précisément ce que tente de faire — et réussit à enrichir — cet ouvrage qualitatif en retraçant le développement historique de l’institution judiciaire dans le cadre des piliers de la monarchie alaouite. Il met en relief, comme l’indique M. Mohamed Abdennabaoui dans sa préface, « l’attention constante et enracinée à travers les âges portée par les souverains de la dynastie alaouite à la justice dans tout le Royaume, et leur souci permanent de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire afin d’assurer la justice aux sujets et citoyens ».
Cinquante captifs chrétiens contre cinq mille livres pour chaque chrétien
Dans ce contexte, je retiens du livre trois exemples de décisions de souverains de la dynastie alaouite qui me paraissent particulièrement significatifs des préoccupations qualitatives des rois du Maroc, mûries dans l’histoire et prolongées jusqu’à aujourd’hui…
Le sultan Moulay Ismaïl (1672–1727) a ainsi adressé en 1698 une lettre au roi d’Espagne Charles II au sujet de l’échange de cent prisonniers chrétiens (comme mentionné dans la lettre) contre cinq cents captifs musulmans. Il lui propose aussi de livrer cinquante chrétiens en échange de « cinq mille livres pour chaque chrétien, parmi les ouvrages islamiques authentiques, choisis parmi ceux conservés dans leurs bibliothèques à Séville, Cordoue et Grenade… », comme on peut le lire dans le texte de la lettre, dont une reproduction figure dans l’ouvrage.
Le sujet de cette lettre touche de près la question judiciaire, mais va au-delà, investissant les domaines religieux, culturels et souverains. Le souverain alaouite tenait à récupérer un trésor culturel à forte valeur religieuse, qu’il considérait comme un bien appartenant à l’État marocain. Ces ouvrages se trouvaient à bord d’un navire capturé par des pirates en 1614, avant d’être transférés au monastère de l’Escurial, près de Madrid. Cette bibliothèque appartenait au sultan saadien Moulay Zidan, fils d’Ahmed al-Mansour ad-Dhahabi. Elle constitue aujourd’hui le noyau de la célèbre bibliothèque de l’Escurial. Elle regorge de manuscrits originaux inestimables de dizaines de sommités de la pensée musulmane, parmi lesquels Ibn Khaldoun, Avicenne (Ibn Sina) et bien d'autres.
Les tentatives de récupération de ces livres se sont poursuivies, notamment à travers l’initiative du sultan alaouite Moulay Ismaïl, puis celle du sultan Mohammed ben Abdallah. Cela témoigne de l’insistance de l’État marocain sur ce qu’il considérait comme une propriété du Maroc, et non seulement du sultan saadien. Il s’agissait d’un bien culturel et intellectuel à portée religieuse. Les monarchies marocaines ont toujours accordé une grande importance à la culture, dans ses dimensions religieuse et savante, comme en attestent les relations entretenues par les rois du Maroc avec les juristes, érudits et écrivains de leur époque… Ce lien reste à ce jour l’un des fondements de la monarchie marocaine.
Rendre justice au faible contre le fort
Le livre nous livre aussi une autre lettre, cette fois du sultan Moulay Abd al-Rahman ben Hicham (1822–1859), adressée à « nos serviteurs, tous les habitants de Rabat ». Dans cette missive, il les informe qu’ils sont blanchis des accusations de leur gouverneur, qui prétendait qu’ils s’étaient soulevés, avaient pris les armes et proféré des menaces contre lui, ce qui avait conduit le sultan à envisager des sanctions. Mais, après vérification des faits, leur innocence dans cette affaire de sédition a été confirmée, et il s’est avéré qu’ils se plaignaient simplement des préjudices subis de la part du gouverneur. La lettre précise : « Les habitants de toute la région, y compris les femmes, les enfants et les juifs, se plaignent de lui. Dès lors, tout grief que nous avions envers vous est levé. » Le sultan annonce alors qu’il a décidé de sanctionner le gouverneur fautif et de le remplacer par un nouveau responsable, un juge.
Cette lettre illustre la vertu de le grâce, l’importance de la vérification avant de prendre une décision, la capacité de l’autorité à se prémunir contre la délation et les intrigues, mais surtout l’attachement du souverain à la justice, à l’équité, et à une gouvernance qui ne nuit pas à son peuple.
Le troisième exemple de gouvernance éclairée dans l’histoire de la dynastie alaouite est un dahir (décret royal) émis par le sultan Moulay Hassan Ier (1872–1894), en 1876, concernant la nomination d’un nouveau juge dans la ville de Marrakech. Le dahir définit les missions du juge et lui précise les références religieuses et morales à suivre :
« Nous lui avons permis de trancher les litiges, d’examiner les actes juridiques, et de juger selon ce qui est reconnu du rite de l’Imam Malik, confirmé et bien établi. Il devra rendre justice au faible contre le fort, et instaurer l’égalité dans son tribunal entre le noble et le commun. Qu’il craigne Dieu, Lui obéisse, et s’efforce de rendre ses jugements en toute intégrité, comme cela est promis à ceux qui pratiquent la justice... Qu’il sache que Dieu le voit, et que tous ses jugements seront exposés dans l’au-delà… »
Le contenu de ce décret se passe de commentaires : il est clair dans sa formulation, explicite dans sa signification, et profondément enraciné dans les valeurs religieuses qui ont toujours encadré la gouvernance de l’État marocain. La justice n’est ici qu’un prolongement de cette gouvernance, l’un de ses piliers fondamentaux. Les valeurs d’équité, de soutien aux faibles, d’égalité entre les justiciables, et d’appel constant à la conscience croyante sont au cœur de ce message.
La consécration constitutionnelle et politique de l’indépendance de la justice
Le livre consacre environ cinquante pages à ce que le roi Mohammed VI a entrepris de profond pour réformer le domaine judiciaire. Ces pages retracent ses décisions, ses discours officiels et ses messages royaux adressés à des rencontres et forums institutionnels, judiciaires, nationaux et internationaux. On peut résumer cette œuvre royale en disant qu’elle s’inscrit dans le vaste projet de réforme et de modernisation initié par le roi Mohammed VI depuis son accession au trône en 1999 jusqu’à aujourd’hui.
Le grand titre de cette entreprise est la consécration de l’indépendance de la justice — constitutionnelle, juridique et politique — ainsi que la modernisation des institutions de gouvernance judiciaire, afin d’en faire des leviers essentiels de la bonne gouvernance de l’État, mais aussi de leur permettre de poser leurs propres bases de légitimité, de souplesse et d’efficacité sociale.
Sans la dynamique de modernisation insufflée au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui anime aujourd’hui ses structures judiciaires et administratives, il n’aurait pas été possible d’envisager une fondation historique du lien entre monarchie et justice. Et sans cela, ce livre remarquable n’aurait peut-être jamais vu le jour.