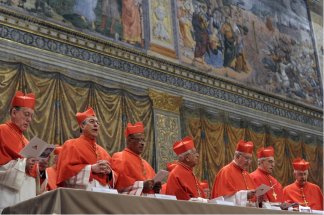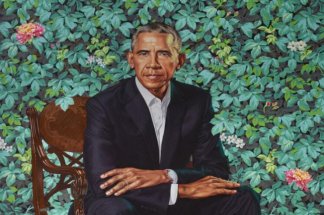International
Guinée : Derrière la grâce présidentiel, les équilibres ethniques d’une transition sous tension – Par Hatim Betioui

Le colonel Mamadi Doumbouya arrivé au pouvoir par un coup d’État en 2021, élevé au grade de général depuis, s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les liens avec la communauté malinké, tout en marginalisant l’influence des Peuls
En Guinée, la récente grâce accordé à Moussa Dadis Camara et le retour symbolique de Mohamed Touré, fils du père de l’indépendance, révèlent une stratégie politique plus profonde. Hatim Betioui revient sur ce qu’il y a derrière les apparences d’un geste de clémence : une recomposition ethnopolitique menée par la junte pour consolider son pouvoir dans un paysage fragilisé.
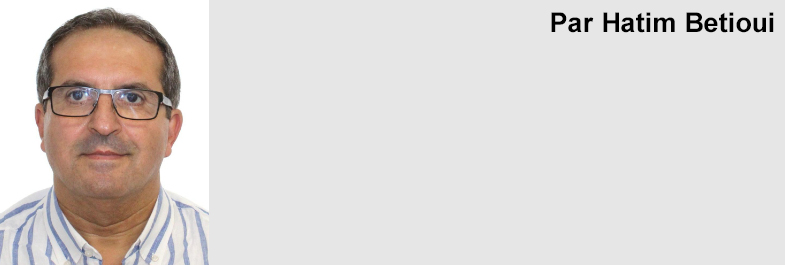
Une grâce plus politique que judiciaire
Derrière la décision de grâce rendue en mars dernier, se dessinent des dynamiques plus profondes qu’un simple acte de justice ou de stratégie politique classique. Car l’affaire ne concerne plus seulement un homme accusé de crimes contre l’humanité, mais touche également à des équilibres ethniques fragiles que le régime de transition tente de manœuvrer pour assurer sa survie dans un contexte interne et régional de plus en plus complexe.
Le timing est éloquent : la libération de Moussa Dadis Camara coïncide avec le retour de Mohamed Touré, fils du président historique Ahmed Sékou Touré, après un long exil. Le régime semble vouloir se réapproprier ce dernier à la fois comme figure symbolique et comme outil de mobilisation populaire.
Réhabilitation et révision de la mémoire collective
Mohamed Touré, longtemps porteur du lourd héritage paternel, est désormais présenté comme un pilier potentiel de « l’unité nationale ». Ce repositionnement est particulièrement significatif pour de larges pans de la communauté malinké — l’un des principaux groupes ethniques du pays — qui voient en lui un symbole historique marginalisé depuis plusieurs décennies.
De son côté, Moussa Dadis Camara, militaire arrivé au pouvoir par un coup d’État en décembre 2008 après le décès du président Lansana Conté, incarne un autre pan de la mémoire malinké. Connu pour ses méthodes peu conventionnelles et son franc-parler, son règne fut marqué par des violences extrêmes, notamment le massacre de plus de 150 civils en décembre 2009.
L’échiquier ethnique reconfiguré
Bien que condamné en 2022 à vingt ans de prison pour « crimes contre l’humanité », Camara a bénéficié de la grâce du colonel, élevé au grade de général depuis, Mamadi Doumbouya, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’État en 2021. Ce geste, loin d’être isolé, s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les liens avec la communauté malinké, tout en marginalisant l’influence des Peuls (ou Foulbés), groupe historiquement dominant dans l’opposition, l’élite intellectuelle et économique.
Les tensions entre les Malinkés et les Peuls ne datent pas d’hier. Accusés de « surreprésentation » dans les secteurs clés du pays, les Peuls sont régulièrement soupçonnés de nourrir un « excès d’ambition », ce qui attise les ressentiments et les rivalités interethniques.
La libération de Camara et le retour orchestré de Touré peuvent donc se lire comme une tentative de rééquilibrage politique en faveur des Malinkés, en constituant une base populaire solide autour du pouvoir militaire.
Une stratégie régionale partagée
Cette logique s’inscrit dans une tendance plus large en Afrique de l’Ouest, où les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée semblent redéfinir les contours de leur légitimité. En s’alliant à des forces sociales traditionnellement marginalisées et en brandissant un discours souverainiste opposé à l’influence occidentale, ces gouvernements reconfigurent l’ordre interne pour prolonger leur maintien au pouvoir.
Cependant, cette recomposition rapide soulève de nombreuses interrogations. Peut-on réellement construire une paix durable sur des alliances fondées sur l’ethnie ? Une réconciliation nationale est-elle crédible si elle se fait au détriment d’autres groupes, relégués ou négligés ?
Vers une paix fragile ?
Dans un pays où les blessures historiques restent béantes et les mémoires toujours vives, aucune manœuvre politique ne saurait remplacer une véritable justice. Le pardon sans équité peut aisément se transformer en catalyseur d’un futur embrasement plutôt qu’en vecteur de stabilité.
L’avenir de la transition guinéenne dépendra donc de sa capacité à dépasser les calculs ethniques et à inscrire ses décisions dans une logique d’inclusion, de justice impartiale et de reconnaissance des souffrances collectives.