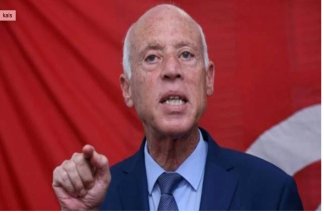chroniques
Le Congo, la malédiction de Lumumba – Par Hatim Betioui

Des rebelles du M23 dernier avatar d'une guerre interminable
Le Congo, une tragédie sans fin. Ravagée par les conflits, exploitée pour ses ressources et abandonnée par la communauté internationale, la République démocratique du Congo semble enfermée dans un cycle de violence dont personne ne veut vraiment la sortir. Derrière le chaos, écrit Hatim Betioui, un peuple sacrifié sur l'autel des intérêts régionaux et économiques.
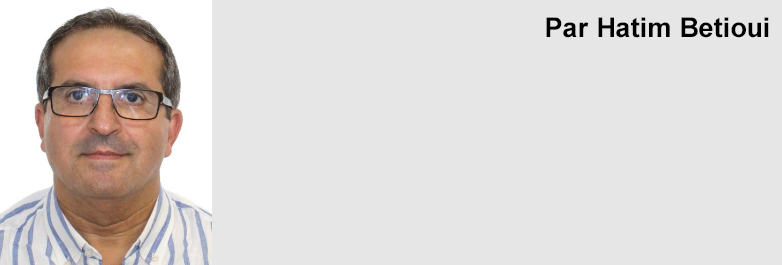
Une fois de plus, la République démocratique du Congo revient sur le devant de la scène, et les médias internationaux braquent leurs projecteurs sur un nouveau chapitre de la guerre permanente que connaît ce pays, où il semble, à première vue, que quelque chose a changé depuis des décennies. Mais la vérité reste que rien ne change, si ce n’est les noms des factions en guerre, tandis que le pays demeure gouverné par le chaos, encerclé par la convoitise, et incapable de se réformer.
D’un tyran à l’autre
Depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, les tragédies se répètent au même rythme, comme si l’histoire se rejouait sans que personne ne s’arrête pour poser la question : y a-t-il une issue à ce tunnel ? Ou bien le Congo est-il condamné à rester un champ de bataille permanent, où les acteurs changent, mais les règles restent les mêmes ?
Tout, au Congo, semble hors de contrôle : la politique, l’économie, la sécurité, et même le sort des individus. L’État, qui est censé gouverner ce vaste territoire, ne détient de la souveraineté que le nom, tandis que les milices armées contrôlent l’est du pays, que les pays voisins y imposent leurs politiques, et que les grandes entreprises interviennent de manière indirecte pour garantir la continuité de l’approvisionnement de leurs usines en minerais stratégiques.
Peut-on espérer qu’un État se réforme lorsque tout en lui a été conçu pour rester défaillant ?
Depuis son indépendance de la Belgique en 1960, le pays vit au bord de l’explosion. Après l’assassinat de Patrice Lumumba, une malédiction de divisions s’est abattue sur lui, et il est apparu clairement qu’aucun espoir de stabilité n’était permis. Le maréchal Mobutu Sese Seko a gouverné durant de longues décennies, mais il n’a pas fondé un État : il a bâti une dictature reposant sur l’achat des loyautés et la gestion du pays comme une propriété privée, sans aucune tentative réelle d’instaurer un système durable. Et lorsque Mobutu est tombé en 1997, sa chute n’a pas été une victoire pour la démocratie ni le début d’une nouvelle ère, mais simplement un transfert du pouvoir d’un tyran à un groupe de seigneurs de guerre, engagés dans un conflit féroce pour les richesses du pays, pendant que le citoyen ordinaire en payait le prix, de son sang, de sa vie, et de son avenir.
Une simple géographie livrée aux milices
Il n’est pas exagéré de dire aujourd’hui que le Congo n’est plus un État au sens propre du terme, mais un simple espace géographique disputé entre milices armées, pays voisins, et multinationales. À l’est du pays, des combats sans fin opposent des factions rivales soutenues par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. Chaque camp prétend défendre une cause, mais en réalité, chacun lutte pour le contrôle des mines et des postes-frontières.
Le mouvement « M23 », soutenu par le Rwanda, n’est qu’une nouvelle version de ce scénario qui se répète : une faction armée se rebelle, entre en négociation, obtient des concessions, puis reprend les armes.
La tragédie la plus profonde réside dans le fait que le conflit n’est pas uniquement politique ou militaire, mais fondamentalement économique. Le Congo détient des ressources naturelles inestimables — or, cobalt, cuivre, coltan — essentielles aux industries modernes, que ce soit en Occident ou en Chine. Mais au lieu d’être une bénédiction pour la population, ces richesses sont devenues une malédiction qui détruit leurs vies et les bouleverse de fond en comble.
Malheureusement, il n’existe au Congo ni industrie nationale capable de tirer parti de ces ressources, ni gouvernement en mesure de les protéger. La majorité de ces richesses est en réalité pillée indirectement par des milices opérant pour des intérêts extérieurs, les minerais étant ainsi acheminés hors du pays pour parvenir aux marchés internationaux avec une étonnante fluidité, comme si la guerre n’avait jamais existé. Et le plus étrange est que même lorsque des efforts de paix sont tentés, ils semblent se résumer à de vains exercices de façade.
Un pays sans espoir
La communauté internationale parle abondamment de la nécessité de stabiliser le Congo, mais elle refuse de s’attaquer au cœur du problème : comment établir la stabilité dans un pays dont le gouvernement ne contrôle même pas la moitié du territoire ? Et comment peut-on parler de réforme politique quand le véritable pouvoir est entre les mains de seigneurs de guerre et de milices armées ?
Tout ce chaos a fait du Congo un pays sans espoir de réforme, du moins dans un avenir proche. L’État est faible et incapable d’imposer son autorité, l’armée est épuisée et incapable de faire face aux menaces, tandis que les pays voisins profitent davantage du maintien du désordre que d’une éventuelle stabilité. Quant à la communauté internationale, elle parle de solutions sans vouloir prendre le risque de compromettre ses intérêts économiques. Le résultat : une spirale sans fin de violence, dont les pauvres souffrent, et dont les marchands de guerre tirent profit.**
Le Congo peut-il changer de réalité ?
Théoriquement peut-être, mais en pratique, tous les facteurs poussent à la perpétuation de la situation actuelle. Tant qu’il y aura des milices prêtes à se battre, des États prêts à les financer, et un marché mondial disposé à acheter les minerais pillés, faire taire les armes au Congo restera hors de portée.
Certes, il existe des crises qui se résolvent, et des pays qui se relèvent de leurs chutes, mais le Congo ne semble pas en faire partie, hélas. Car il est tout simplement encerclé par des convoitises sans fin, et épuisé par des conflits où il n’y a plus ni vainqueur ni vaincu — seulement un perdant : le peuple congolais.