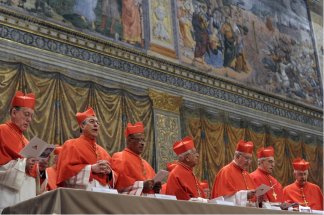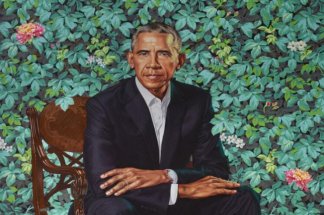International
L’Amérique ne dirige plus le monde*
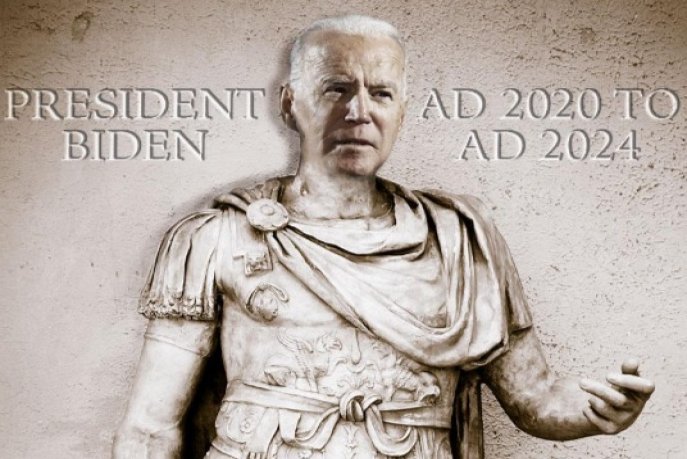
Le leadership mondial ne se limite pas à soutenir ses amis et à repousser ses ennemis. Les leaders, au sens plein du terme, ne se contentent pas d’être des chefs ; ils résolvent les problèmes et inspirent confiance.
Après quatre années de Donald Trump, Joe Biden était censé redonner aux États-Unis une position de leadership mondial. Selon les normes conventionnelles de Washington, il a tenu ses promesses. Il a anticipé l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a adroitement rallié l’OTAN pour y résister. En Asie, il a consolidé d’anciennes alliances, en a construit de nouvelles et attisé les difficultés économiques de la Chine. Après l’attaque d’Israël, il a réussi à le soutenir tout en évitant une guerre régionale totale.
Pourtant, le leadership mondial ne se limite pas à soutenir ses amis et à repousser ses ennemis. Les leaders, au sens plein du terme, ne se contentent pas d’être des chefs ; ils résolvent les problèmes et inspirent confiance. M. Trump n'a pas de prétention à ce genre de leadership sur la scène mondiale. Mais c’est précisément parce que la plupart des responsables américains l’ont que la situation actuelle de la puissance américaine est d’autant plus frappante. Jamais, au cours des décennies qui ont suivi la guerre froide, les États-Unis n’ont ressemblé moins à un leader du monde qu’à un chef de faction – réduit à défendre son camp préféré contre des adversaires de plus en plus alignés, alors qu’une grande partie du monde regarde et se demande pourquoi les Américains pensent qu’ils sont aux commandes.
Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, un frisson parcourut Washington. Après des décennies de guerre larvée, les États-Unis redeviendraient le « type bien » mondial, unissant le monde contre l’agression flagrante du Kremlin et l’affront à l’ordre. Au cours des premiers mois, la Maison Blanche a remporté de brillants succès tactiques, permettant la défense de l’Ukraine, organisant l’aide des alliés et facilitant l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN. Pourtant, si la Russie paie un lourd tribut à son invasion, le conflit représente également un revers stratégique pour les États-Unis.
Les États-Unis doivent désormais faire face à un homologue nucléaire frustré et imprévisible, Moscou. Pire encore, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord se sont rapprochés pour soutenir l’effort de guerre de la Russie et résister à ce qu’ils appellent l’hégémonie mondiale des États-Unis. Cette entente anti-américaine s’est déjà révélée suffisamment forte pour atténuer les effets de l’aide occidentale à l’Ukraine, et elle augmente le coût de la domination militaire américaine. La Russie borde directement six pays que les États-Unis sont tenus de défendre par traité. Pendant ce temps, le Pentagone se prépare à une invasion chinoise de Taiwan. Les États-Unis ne sont pas exactement surpassés. Mais ils sont largement sur-projetés (ou surtendus, overstretched en anglais)
Le reste du monde ne se précipite pas non plus aux côtés des États-Unis. La plupart des pays jettent la pierre aux deux camps, critiquant l’agression russe mais aussi la réponse occidentale. M. Biden n’a pas aidé les choses. En présentant le conflit comme une « bataille entre la démocratie et l’autocratie » et en déployant peu d’efforts visibles pour rechercher la paix par la diplomatie, il demande aux autres pays de s’engager dans une lutte sans fin. En dehors des alliés des États-Unis, pratiquement aucun pays n’a imposé de sanctions à la Russie. Isoler la Chine, si elle attaquait Taïwan, serait une tâche encore plus ardue. En Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, la perception de la Russie et de la Chine s’est, en fait, améliorée depuis 2022.
La guerre à Gaza est survenue au pire moment possible, et M. Biden a répondu à cette calamité en s’y jetant à corps perdu. Il a immédiatement promis de soutenir la campagne militaire impitoyable d’Israël plutôt que de conditionner l’aide américaine à la recherche par Israël d’une stratégie qui protégerait les civils. Ayant choisi de suivre, et non de diriger, M. Biden a dû se taire sur le comportement d’Israël depuis « les touches du terrain" qu’il s’était lui-même imposées. Dans un conflit déterminant, les États-Unis ont réussi à se montrer à la fois faibles et oppressifs. Les conséquences pour la réputation et la sécurité de l’Amérique commencent seulement à se faire sentir.
Il n’y a pas si longtemps, les États-Unis ont tenté de servir de médiateur entre Israéliens et Palestiniens à des conditions que les deux parties pourraient accepter. Ils ont utilisé la diplomatie pour empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire et encouragé les Saoudiens à « partager le voisinage », selon les termes de Barack Obama, avec leurs rivaux iraniens. Pour l’instant, l’administration Biden n’aspire apparemment qu’à consolider un bloc anti-iranien. En échange de la normalisation de ses relations avec Israël, l’Arabie saoudite cherche à engager les Etats Unis, par traité, à défendre son Royaume par la force. Cet accord, s’il se concrétise, n’a qu’une infime chance d’apporter la paix et la stabilité au Moyen-Orient – et une grande chance d’entraîner davantage les États-Unis dans la violence régionale.
Une partie du problème réside dans la tendance du président américain à s’identifier de manière excessive aux partenaires des Etats Unis. Il s’en est remis à l’Ukraine quant à la poursuite ou non des négociations de paix et a évité de contredire ses objectifs de guerre maximalistes. Il a accéléré l’aide à Israël tout en doutant publiquement de sa stratégie. M. Biden s’est également engagé à quatre reprises à défendre Taïwan, dépassant ainsi l’engagement officiel des États-Unis d’armer l’île, mais sans nécessairement se battre pour elle. Ses prédécesseurs n’ont pas toujours été aussi unilatéraux, entretenant une « ambiguïté stratégique », par exemple sur la question de savoir si les États-Unis entreraient en guerre pour Taiwan.
En fait, les instincts de M. Biden reflètent une erreur plus profonde, qui remonte à des décennies en arrière. Au sortir de la guerre froide, les décideurs américains ont confondu leadership mondial et domination militaire. Les États-Unis avaient, assurément, les moyens des deux. Ils pouvaient en toute sécurité élargir leur portée militaire sans se heurter à des représailles sévères. Mais « Le monde n’est plus divisé en deux camps hostiles », a déclaré Bill Clinton en 1997, l’année où il défendait l’élargissement de l’OTAN vers l’est. «Aujourd'hui, nous construisons des liens avec des nations qui étaient autrefois nos adversaires.»
Mais la création de liens n’a jamais permis de vaincre la suspicion mutuelle, en partie parce que les États-Unis continuaient de valoriser leur domination du monde. Les administrations successives ont élargi les alliances américaines, déclenché de fréquentes guerres et cherché à propager la démocratie libérale, espérant que leurs rivaux potentiels accepteraient leur sort dans l’ordre américain. Aujourd’hui, cette attente naïve a disparu, mais le réflexe de domination demeure. Les États-Unis continuent de s’étendre et rencontrent une résistance formidable – ce qui à son tour incite Washington à redoubler d’efforts… C’est un jeu perdant, et les Américains devront prendre plus de risques et payer un prix plus élevé pour continuer à y jouer.
Une meilleure approche est pourtant possible. Pour reconquérir leur leadership mondial, les États-Unis doivent montrer à un monde méfiant qu’ils veulent affermir la , et pas saigner un ennemi ou soutenir un allié. Cela signifierait soutenir l’Ukraine tout en travaillant à mettre fin à la guerre à la table des négociations – tout en réduisant progressivement son rôle au sein de l’OTAN et en insistant pour que l’Europe mène sa propre défense. La récente proposition de cessez-le-feu à Gaza de M. Biden était louable, sauf qu’elle ne comportait pas la menace de cesser d’envoyer des armes à Israël si celui-ci refusait.
Un retrait de l’Europe et du Moyen-Orient améliorerait l’engagement américain là où cela compte le plus : en Asie. Cela clarifierait que le but de l’Amérique n’est pas de rechercher l’hégémonie, comme le prétend la propagande de Pékin, mais plutôt d’empêcher la Chine d’établir sa propre hégémonie asiatique. De ce point de vue, les États-Unis pourraient être un leader digne de confiance dans la région Indo-Pacifique, même si la Chine continue de progresser. La Chine est aujourd’hui loin d’être capable d’imposer sa volonté dans toute la région, et la prise de Taiwan, extrêmement risquée pour elle, ne le lui permettrait pas davantage.
Bien entendu, rien de tout cela ne serait facile. Mais que serait l’alternative ? Diriger seulement une fraction du monde fait des États-Unis un suiveur impulsif et frénétique . Une telle position met les Américains perpétuellement au bord d’une guerre au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, craignant que perdre du terrain quelque part ne déclenche une catastrophe partout. Le véritable danger, cependant, est de faire dépendre une grande partie de la sécurité mondiale de l’engagement excessif d'un pays. Les vrais leaders savent quand faire de la place aux autres.