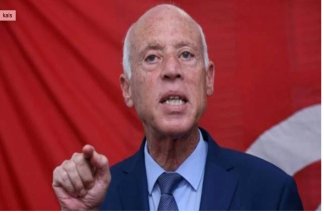chroniques
Dans une phase décisive, le dossier du Sahara n’est pas pour autant clos- Par Bilal Talidi

Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, et l’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Stafan Di Mistura au siège de l’ONU
Le titre de cette chronique est de nature à agacer. Mais alors que les conditions régionales et internationales semblent pencher en faveur du Maroc dans le dossier du Sahara, on sait que les prochains mois seront cruciaux. Malgré des acquis notables, la vigilance reste de rigueur face à toute tentative de manœuvre algérienne. Pour Bilal Talidi, la mobilisation diplomatique, stratégique et intérieure devra s’intensifier pour ancrer définitivement l’autonomie comme unique issue crédible et la mettre à l’abri de tout imprévisible.
La session du Conseil de sécurité, tenue ce lundi pour le briefing de mi-mandat de la MINURSO et de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, bien qu’elle ne soit qu’un indicateur de ce que pourraient être les six prochains mois, revêt indéniablement une grande importance sur les plans politique et diplomatique. Elle a permis de dégager les perspectives que prendra la mission de l’envoyé personnel dans la période à venir, les nouvelles dynamiques internationales encadrant son action, ainsi que les options encore disponibles avant que le Conseil de sécurité ne rende son verdict final — soit en actant une résolution effective du conflit, soit en laissant ce règlement à l’initiative de grandes puissances comme les États-Unis, à l’image de ce qui se produit actuellement pour tenter de mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
L’échec de la manœuvre de la partition
Il est certain que l’importance de cette session réside dans la présentation d’un rapport détaillé sur le travail de l’envoyé personnel, sur le rejet catégorique de la proposition de partition avancée par l’Algérie — que De Mistura avait transmise au Maroc et au Conseil de sécurité —, et sur le fait que le Conseil de sécurité se retrouve désormais face à deux options sans alternative : soit capitaliser sur l’élan créé par l’initiative marocaine d’autonomie et le large soutien international dont elle bénéficie, soit reconnaître l’échec de l’ONU à résoudre ce conflit et laisser aux États-Unis la possibilité de le régler, ce qui marquerait la fin du discours de la Quatrième Commission et du concept dévoyé de « décolonisation » défendu par l’Algérie.
Dans tous les cas, le grand acquis du Maroc à l’échelle onusienne est que l’envoyé personnel du Secrétaire général a clairement signifié à l’Algérie que la proposition de référendum n’est plus d’actualité, et que le projet de partition proposé par Alger a été catégoriquement rejeté par le Maroc. Ces deux propositions ne sont donc plus sur la table.
Le classement du Polisario comme organisation terroriste
Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, ont porté un message d’espoir : la possibilité de célébrer le cinquantenaire de la Marche verte dans un climat de victoire définitive. Ils ont évoqué un engagement américain en faveur de la clôture du dossier du Sahara sur la base de la proposition marocaine d’autonomie, soulignant que le dossier n’a plus que six mois devant lui pour atteindre ce dénouement prometteur.
Des indicateurs significatifs montrent que les États-Unis exercent une pression sur l’Algérie pour qu’elle s’engage immédiatement et sérieusement dans un règlement du conflit fondé sur la proposition marocaine d’autonomie. Cette pression transparaît dans la réaction algérienne à la reconduction par l’administration américaine de sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, et à ses relations avec la France telles que comprises par De Mistura qui y a vu une forme de résignation aux évolutions internationales sur le dossier du Sahara.
Il ne fait par ailleurs aucun doute que la menace américaine, à travers le Congrès, de classer le Front Polisario comme organisation terroriste, a poussé l’Algérie à revoir sérieusement ses calculs. Cette perspective a fait craindre à Alger des scénarios graves, dont le plus modéré serait de la placer dans la position d’un État soutenant des groupes menaçant la stabilité du Sahel.
L’isolement d’Alger
La conjoncture internationale et régionale actuelle est favorable au Maroc. L’Algérie se trouve dans un quasi-isolement : elle n’a plus d’ouverture à ses frontières, si ce n’est du côté de la Tunisie, elle-même en crise politique. Même la Libye, que l’Algérie tentait d’utiliser comme levier pour bâtir un axe maghrébin sans le Maroc, a vu son Conseil d’État refuser la tenue d’une réunion tripartite maghrébine à Tripoli. Au sud, l’Algérie est aussi en froid avec les trois pays du Sahel, après avoir abattu un drone appartenant à l’armée malienne sur le sol malien. Sur le plan occidental, elle traverse une nouvelle crise avec Paris, en raison de l’échec des initiatives visant à normaliser les relations. Enfin, ses rapports avec Moscou se sont refroidis depuis le refus de la Russie de l’admettre dans les BRICS, en raison de la position algérienne jugée contraire à la stratégie énergétique de pression de Moscou sur l’Europe.
Sur le plan diplomatique, l’Algérie semble incapable de préserver ce qui reste de pays soutenant sa thèse séparatiste. Politiquement, elle n’a plus aucune marge de manœuvre : elle n’est pas en mesure de pousser le Front Polisario vers l’option militaire, ni de faire du projet de partition une alternative crédible à activer en période de crise. Quant à l’option du référendum, elle est désormais reléguée, dans le langage des puissances internationales, au rang de slogan désuet et vide de sens.
Tout n’est pas encore fini
En réalité, tous ces indicateurs sont porteurs d’espoir, mais ils ne permettent pas encore d’affirmer que la bataille est tranchée. La nécessité d’agir et de se mobiliser sérieusement reste de rigueur, afin d’éviter que des changements stratégiques ou des bouleversements régionaux ne surgissent, offrant à l’Algérie, même partiellement, un espace de manœuvre. Les conditions actuelles servent la position marocaine, mais elles n’ont pas encore mis l’Algérie face au choix radical entre le suicide politique et l’adhésion à la proposition marocaine. Cela vaut aussi pour les relations franco-algériennes, que l’Algérie n’a toujours pas su orienter vers une voie de salut, même en agitant le référentiel du président Emmanuel Macron face au ministre français de l’Intérieur.
Il existe de nombreuses raisons qui imposent de ne pas céder au discours rassurant, bien que les signes soient encourageants et favorables à la position marocaine. La première de ces raisons est le caractère pragmatique de la nouvelle administration américaine. Le président Donald Trump est un homme de transactions, indifférent aux contraintes, capable de virer et de changer de position du jour au lendemain s’il y voit l’intérêt de l’Amérique — ou plus exactement, son propre intérêt. L’Algérie, dans un moment d’absence de choix, qui s’y est déjà essayée, pourrait exploiter cette voie et en faire un levier de manœuvre. Paris aussi nourrit l’espoir de tirer des avantages énergétiques supplémentaires de l’Algérie, et aspire à reprendre pied dans son ancien « arrière jardin » au Sahel. La pression forte exercée par Paris sur Alger est perçue par beaucoup comme une tentative de rejouer la carte d’août 2022, lorsque la visite d’Emmanuel Macron en Algérie lui avait permis de décrocher des gains énergétiques inédits pour faire face à un hiver difficile, en pleine crise avec Moscou.
L’heure n’est pas encore à l’autosatisfaction
Quant aux pays du Sahel, nullement à l’abri de bouleversements ‘’imprévisibles’’, en particulier le Mali — malgré les tensions directes avec l’Algérie qui soutient les tribus de l’Azawad contre les autorités maliennes — ils pourraient à tout moment, sur incitation russe, rechercher un compromis même temporaire permettant à l’Algérie de desserrer l’étau américain, et de transformer la région sahélienne en un outil de manœuvre diplomatique.
Il est certain que ces cartes sont difficiles à jouer. Leur activation suppose des évolutions qui nécessitent du temps, une grande capacité de manœuvre pragmatique que la diplomatie algérienne ne possède pas, et l’hypothèse d’un retrait marocain du champ de l’action et de la contre-manœuvre. Cela suppose aussi que le gain américain ou français à soutenir la thèse algérienne soit perçu comme plus important que celui tiré du soutien à la position marocaine. Mais en politique — ou plus précisément dans la gestion stratégique — il n’y a pas de risques lointains ou proches, il y a toujours une sphère de risques qui mérite la plus grande attention, et un cercle de vigilance continue qui ne vise pas seulement à protéger les acquis, mais aussi à les étendre et à les rendre irréversibles.
Les six prochains mois sont donc à consacrer à des efforts redoublés, sur plusieurs fronts :
Le front traditionnel, par un élargissement accru du soutien international à la position marocaine ; le front pragmatique, en créant des dynamiques concrètes sur le terrain qui incitent les acteurs internationaux à investir davantage dans le soutien à la proposition marocaine ; le front interne, en accélérant les projets de développement dans les provinces du Sud, et en donnant un élan particulier aux élections de 2026, afin qu’elles illustrent clairement l’espace de liberté, d’initiative et de représentativité des élites locales dans le cadre de la proposition marocaine d’autonomie.