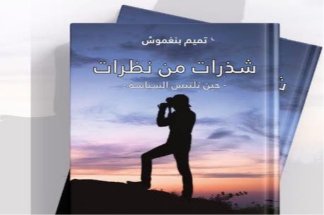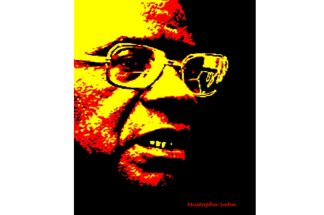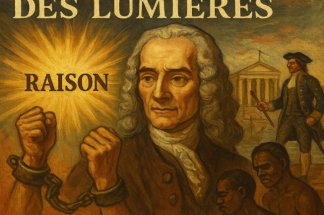Culture
VI- Le collier de perles dispersées - Par Eugène Ebodé

L’économie n’était pourtant pas la clé de voûte vers l’État vertueux. Les démons de la division, inoculés par les tacticiens du pillage en rase campagne de l’Afrique et de ses richesses
Par Eugène Ebodé
Ecrivain, universitaire et journaliste camerounais, poète aussi. Il est en charge la Chaire des Littératures et des Arts africains au sein de l’Académie du Royaume du Maroc que son Secrétaire perpétuel, Abdejlil Lahjomri, a mise en place en mai dernier avec le dessein de restituer l’Afrique à l’Afrique et de réhabiliter la périphérie en généralisant le centre.
Avril 1994 a été un coup de massue cloutée sur la nuque de l’Afrique. Elle se l’assena à elle-même. Les images qui nous parvinrent des vastes et soudains massacres au Rwanda créèrent la sidération et la confusion dans nos rangs, ceux des immigrés et des exilés, ceux des afro-descendants et des membres de la diaspora aux mille visages. Les années 1990, pour nous qui étions en Occident et qui ruminions l’Afrique comme des bovidés en transhumance soit en route vers le point de départ ou poursuivant nos vagabondages en quête de nouveaux et verdoyants pâturages. L’Afrique peinait à organiser son redécollage. Des saignées économiques, doctement infligées par les experts surgis des banquiers du monde washingtonien, avaient été administrées et portaient le technocratique nom d’ajustement structurel. Des économistes bardés de chiffres et de statistiques, que le taux d’endettement des pays à revenus intermédiaires comme ceux à revenus faibles inquiétait, pointaient les alarmes sur lesquels se brisaient tout élan optimiste sur l’Afrique : Corruption endémique, volontarisme politique et réformateur en berne, atonie infrastructurelle chronique, baisse de près de 1% des revenus des populations africaine alors que ceux des Occidentaux augmentaient dans la même proportion durant cette période. Mécaniquement, l’écart en termes de pouvoir d’achat s’accroissait et le différentiel ne pouvait qu’assombrir un peu plus les horizons d’une jeunesse africaine désenchantée. Pendant la même séquence historique, l’Asie du Sud-Est, tirée par ses dragons, soutenait la dynamique de la progression des revenus à 6%.
Si le président Mitterrand avait masqué les raisons économiques qui le poussèrent à un désengagement de ses subsides à l’Afrique par un conditionnement de l’aide contre l’opportun prétexte de la démocratisation, la dette, qui représentait 140% du PIB de la Côte d’Ivoire, par exemple, n’était pas la seule grosse ombre au tableau. D’autres causes macroéconomiques annonçaient les orages et carillonnaient le « mal-engagement » de l’Afrique dans la course à la croissance vue comme un critère magico-rédempteur vers le développement : la baisse du cours des matières premières et le spectre inflationniste accentué par les effet de la récession rampante. Ils fourbissaient les armes du désespoir en Afrique.
L’économie n’était pourtant pas la clé de voûte vers l’État vertueux. Les démons de la division, inoculés par les tacticiens du pillage en rase campagne de l’Afrique et de ses richesses, avaient semé les graines de la discorde que de médiocres intellectuels, au Rwanda, avaient goulûment picorées. Quand éclata le génocide des Tutsis au Rwanda, La France était en cohabitation. Le président de gauche entendait finir son mandat « sans laisser une miette de son pouvoir à ses adversaires de droite. On discutait de son parcours de la droite presque extrême à la gauche quasi moderne. Le journaliste d’investigation Pierre Péan (1938-2019), qui lança le passé du président finissant au visage de ses louangeurs à travers une enquête sur la période 1934-1947 au cours de laquelle le futur président jongla avec les apparentements politiques et une forme de donjuanisme politique. Une jeunesse française (Fayard, 1994) révèlera un passé pour le moins atypique et sulfureux du socialiste Mitterrand, redresseur de la gauche de gouvernement, mais aussi ancien sympathisant de la ligue droitière les Croix-de-feu.
Soupçonné à la fin de son double septennat d’avoir pour le moins fermé les yeux sur les ambiguïtés du régime du président Habyarimana et sur ses relations avec les extrémistes Hutu le poussant à une escalade tragique. Elle s’acheva par sa propre mort au-dessus de son domicile où un missile percuta l’avion présidentiel alors en phase d’atterrissage. Elle bifurqua vers l’innommable quand près d’un million de personnes à majorité Tutsie furent exterminées. Pierre péan, le journaliste d’investigation se mua en avocat d’une théorie du double génocide, si peu crédible et si peu étayée par l’argumentation et par les faits. Ce qui étonna, ce fut la hargne à soutenir une construction dictée davantage par la crainte de l’anglophonie que par l’examen lucide et cohérent de la tragédie que le Hutu power, renouant avec sa hargne vengeresse des années cinquante, échafauda pour l’Apocalypse finale en avril 1994 au Rwanda. Le centre de l’Afrique fut ainsi, en ces année 90, au Rwanda et au Burundi voisin -à bas bruit dans ce dernier pays- le furoncle géant planté au cœur de l’Afrique et qui poussa certains Africains dans le camp des exterminateurs.
Mais ces années-là avaient pourtant laissé apparaître quelques lueurs d’espoir…
Le 11 février 1990, Nelson Mandela (1918-2013), après 28 ans de prison, retrouvait la liberté et l’Afrique du Sud détricotait les mailles absurdes et calamiteuses de l’Apartheid. Le président De Klerk, signant enfin avec le leader de l’ANC la paix des braves. Ailleurs, du côté de la Russie, le revanchard Eltsine se défaisait de l’expérience soviétique, faisant mine de renouer avec l’Occident, mais installant en son sommet une caste thermidorienne habile à convoquer la posture tsariste et le mythe de la Sainte Russie pour gouverner et apeurer. Aux Etats-Unis, les politologues, décidés à reprendre la main sur les comptables et les banquiers, firent alors feu de tout bois. D’abord emmenés par un Francis Fukuyama (né en 1952) mi euphorique mi-persifleur, clama haut et fort son pensum neutralisateur : La fin de l’Histoire et le Dernier homme (1992). Ceux qui avaient lu Erich Maria Remarque (1898-1970), se souvenant de son saillant et saignant A l’ouest rien de nouveau, crurent entendre la petite musique pré-millénariste. Celle qui congédiait le futur et le stérilisait sous le mode du nihilisme soft. C’est alors que débarqua Samuel Huttington, pessimiste, bondissant et provocateur, il lança son livre comme un baril de poudre suivi du craquement d’une allumette : Il y avait du nouveau à l’horizon ! Tout allait reprendre, mais sous le régime des affrontements. L’histoire, était de retour, non sur des bases idéologiques mais sur des ressorts culturels ou cultuels. La promotion des identités tonitruantes pouvaient être reçue comme la nouvelle guerre de Troie au cours de laquelle les mythes disparaissaient en Occident pour renaître en Orient. Comme un signe sonore et brutal du changement de règne, de la transition vers d’autres modèles post-humanisme. Le choc des civilisations (1996), prédisait un nouvel ordre du chaos.
Nous n’avons pas eu la possibilité de méditer sur la tragédie des Tutsie. Le siècle courait vers sa fin. Nous broyions du noir en attendant le vingt-et-unième siècle. Les conférences nationales avaient été un soubresaut populaire et les épaules des peuples africains s’étaient à nouveau affaissées, faute de leaders pouvant méditer sur les transitions culturelles à l’œuvre et la faillite des modèles importés. Il y avait un espace à investir : celui de l’hybridité comme planche de salut pour ceux qui avaient quitté leur socle pour des mirages… Les révisions constitutionnelles opportunistes disaient le désarroi au sommet des États et la recherche désordonnée de la clef de la stabilité. Les longs règnes singeaient les monarchies. En République, on pouvait être président de père en fils. Comment le savoir ? En interrogeant Sirius la nuit. Et en espérant que le collier de perles dispersées que sont les Africains retrouvera un fil pour les renouer