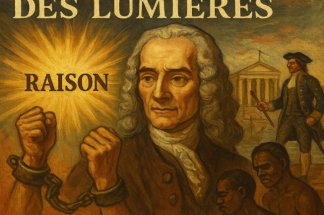Culture
CASABLANCA DE TOUS LES SAINTS. DAR EL BEIDA DE DRISS JAYDANE - PAR MUSTAPHA SAHA

Le récit réussit le prodige de faire d’une existence ordinaire une odyssée surnaturelle

Paris. 26 juillet 2022. Driss Jaydane me fait parvenir son nouveau roman, Moïse de Casa, éditions Les Avrils, que je parcours comme un retour virtuel dans ma ville maternelle. Mes réminiscences s’insèrent dans la narration. Le livre, fil conducteur de dérives mémorielles, m’accompagne dans mon voyage en Bretagne. L’indescriptible société casablancaise entrevue à travers une lucarne druidique. Réalités monstrueuses recouvertes de pudique voile poétique. Incommensurable imaginaire jusqu’au bout des nuits solitaires. Les prophètes ne sont-ils pas d’éternels enfants ?
Le récit réussit le prodige de faire d’une existence ordinaire une odyssée surnaturelle. Le substantif miracle ponctue la progression dramaturgique, faite de péripéties saugrenues et de réflexions ingénues, de situations distordues et d’interversions inattendues. Descentes aux enfers. Ascensions dans les cimes. Replongées dans les abîmes. L’intrigue circumambulatoire pérégrine à travers escapades homériques, méandres allégoriques, dédales fantasmagoriques pour revenir au point de départ, la vie routinière. « Il y avait dans ma tête des mots gelés, pointus, coupants. Et d’autres qui commençaient à fondre. Entre les deux, ceux qui voulaient s’enfuir comme de minuscules araignées ».
Première page. Le narrateur pénètre dans l’immeuble le plus haut de Casablanca, le dix-sept-étages, construit en 1950 par l’architecte suisse Léonard Morandi. La puissance occupante pensait rester dans le royaume chérifien pour l’éternité. « L'immeuble Liberté constitue la première expérience africaine à grande hauteur. Il témoigne du très grand effort que fait la France en Afrique » (L’Architecture française, numéros 95-96, Maroc, 1949). L’idéologie coloniale dans toute son autosuffisance. Le carrefour attenant se dénomme aujourd’hui place Jacques Lemaigre Dubreuil, homme d’affaires, gendre de Georges Lesieur, patron du groupe Lesieur, financier du groupe d’extrême droite La Cagoule dans les années trente avant de rejoindre les libéraux français favorables à l’indépendance marocaine, assassiné par La Main rouge et les services secrets français devant sa résidence, ce fameux gratte-ciel Liberté. Rien n’a changé dans le protocole d’accueil. Vieux concierge, centenaire peut-être, harnaché d’une veste rouge et d’une casquette noire brodée de lettres d’or. Ascenseurs en bois, les plus rapides de leur époque disait-on. Boutons d’étages en cuivre. Le visiteur s’élève dans le ciel. L’esprit gamberge. Conscience en branle comme au jugement dernier.
Dernière page. Moïse arrive dans sa Montagne de Dieu, sa Terre promise, l’appartement de son père. Il le trouve endormi dans une chambre très laide, malodorante. Il le laisse à son profond sommeil. Il ne le reverra plus. Il réalise enfin son complexe d’Œdipe. « L’ascenseur est arrivé en bas. Le vieux concierge maigre était resté assis sur sa chaise. Il a souri. J’ai poussé la porte la plus lourde de toute ma vie, la porte du plus haut des immeubles les plus blancs de la ville, si haut qu’on pouvait dire qu’il tournait sur lui-même au-dessus du port ».
La marche, thème récurrent du roman. La marche, thérapie au sentiment de n’être rien. La marche, remède à la détresse existentielle. La marche à pas soutenus, prophylactique, militaire, disciplinaire. La marche du pauvre. Marcher pour oublier la faim. La marche, rituel du vide. Le cri primal pour dégorger l’inexprimable. Moïse de Casa est Sisyphe. Flash-back. Casablanca. Lycée Moulay Abdellah. Années soixante. Notre professeur de lettres, Jean-Pierre Koffel m’assomme de lectures. Il m’offre chaque semaine un livre à commenter en classe. Trouvaille pédagogique. Pressentiment de la méthode transversale qui nous devient chère en Mai 68. La transmission, l’intersession, la translation ne sont plus écrasées par l’autorité mandarinale. Je reçois Le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus. Je découvre en même temps la philosophie de l’absurde et l’absurdité de la philosophie. « A partir du moment où l’absurdité est reconnue, elle devient une passion, la plus pénible de toutes ». Sisyphe marche en bas de la montagne pour recommencer son épuisante remontée. Albert Camus souligne : « C’est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m’intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d’un pas lourd, mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin ». Etrange délivrance dans l’acceptation de l’irrémédiable, de l’irréversible, de l’irrévocable, dans la résignation à l’inéluctable. Inutile de nier l’inévitable. La révolte commence avec la prise de conscience de cette fatalité. « Ce que j'appelle Moi, ce que j'appelle Monde ne peuvent jamais coïncider, ne peuvent jamais se séparer. (Paul Valery, Cahiers) ». Inamissible discordance entre l’appétence humaine, le désir de paradis sur terre, et le silence déraisonnable du monde. « Il s'agissait précédemment de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue. Il apparaît ici au contraire qu'elle sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. Vivre une expérience, un destin, c'est l'accepter pleinement. Vivre, c'est faire vivre l'absurde. L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte. Elle est une confrontation perpétuelle de l'homme et de sa propre obscurité. C'est ici qu'on voit à quel point l'expérience absurde s'éloigne du suicide… A cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore.… (Albert Camus) ».
1912. Le général Hubert Lyautey veut créer à Casablanca une ville française moderne aux allures américaines, un eldorado californien. Plages privées aux noms exotiques, Tahiti, Lido, Kon-Tiki. Style Art déco. Architecture arabo-andalouse avec pergolas, arcs brisés, tuiles vertes, zelliges, jardins patios. Bâtiments néoclassiques avec colonnades, loggias, moulures florales, guirlandes, médaillons. Diversité constructive. Multiformité décorative. Corbeilles de fruits, angelots, têtes de lions alternent avec des motifs orientaux en stuc et bois de cèdre. L’urbanisme est dirigé par Henri Prost, initiateur des cités-jardins et des habitations à bon marché en France. Contraste permanent entre indigence extrême et suprême richesse. Les quartiers populaires, les bidonvilles, champignonnent en cercles concentriques. Casablanca tentaculaire, classée dans les métropoles les plus riches d’Afrique. La pauvreté s’ignore dans les statistiques.
Le Maroc réhabilite les synagogues, les cimetières, les quartiers juifs. Dans la vieille médina, cohabitent la mosquée Ould Hmara, érigée en 1880 sous Moulay Hassan Ier, la synagogue Ettedgui récemment restaurée, l’Eglise San Buenaventura de los Franciscanos, édifiée en 1881 dans une architecture andalouse, aujourd’hui désacralisée, devenue une maison de quartier. La synagogue Elias Hazan, boulevard Bourgogne, est inscrite au patrimoine national en 2020. Le Musée du judaïsme est créé par Simon Lévy dans le quartier Oasis en 1997. Le temple Beth El, remarquable par ses vitraux lumineux et ses lustres éblouissants. L’église du Sacré avec son style gothique et Art déco. L’église Notre-Dame-de-Lourdes avec une grotte en béton, identique au sanctuaire pyrénéen. L’église orthodoxe russe, dite de la Dormition, bâtisse blanche coiffée de bulbes bleus. Les mosquées sont notre quotidien. Notre curiosité pour les autres cultures est insatiable. Les marqueurs urbanistiques pérennisent la singularité plurielle. La Tour de l’horloge, construite en 1908, devenue branlante et détruite en 1948, reconstruite à l’identique en 1994, une tour orientalisante, évoquant un minaret, avec des zelliges, des arcades, une petite koubba surplombée d’une étoile et d’un croissant, redonne à la ville sa signature originelle.
Cinémas d’antan, le Vox avec ses trois balcons, ses deux mille places, son plafond escamotable, démoli dans les années soixante-dix, cible de la spéculation foncière. Les cinémas du centre-ville, Rialto, Lynx, Rif, Lutétia avec leurs exclusivités américaines, anglaises, françaises, italiennes. Les cinémas des quartiers populaires, Mamounia, Atlas, Saada, Empire, Beaulieu, Opéra, Verdun, Arc, Liberté avec leurs films égyptiens, indiens. Casablanca, capitale des cinéphiles, consacrée en 1942 par le mythique Casablanca de Michael Curtiz, joyau du septième art avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.Nous suivons assidument le ciné-club du Centre culturel français, boulevard Zerktouni. Nous recevons une formation poussée dans les techniques du cinéma. Deux d’entre nous deviennent cinéastes. Le théâtre municipal des années vingt, à l’origine réservé aux français, bâti en trois mois selon les normes italiennes. Dans les dernières années du protectorat, Abd Samad Kenfaoui, Ahmed Tayeb al-Alj, Tahar Ouaziz, traduisent des pièces françaises pour la Troupe du Théâtre Marocain. La pièce Aâmal Jha, adaptée en 1955 des Fourberies de Scapin de Molière, assure la renommée durable de Tayeb Saddiki, qui devient, de 1965 à 1977, directeur du théâtre municipal. Le théâtre porte pleinement la culture de contestation. 1983, massacre de Sabra et Chatila. Une exposition de photographies montre pour la première les horreurs. Le poète et chanteur libanais Ahmed Kaâbour donne une lecture sous surveillance policière. Les spectateurs sont si nombreux que la plupart d’entre eux restent bloqués dehors. Ils scandent les refrains d’Ahmed Kaâbour et de Marcel Khalifa. Quelques semaines plus tard, le théâtre est détruit. L’art est subversif ou n’est pas. Années soixante toujours. Tayeb Saddiki, ami de Jean-Pierre Koffel, débarque dans notre classe au lycée Moulay Abdallah, engage notre groupe dans son atelier de théâtre, qui se tient dans une construction de bois donnant sur l’entrée des artistes. Juin 2022, je revois la famille Saddiki, l’épouse Amira, la fille Radia, les deux fils Zoubair et Baker, qui présentent, belle reconnaissance, au théâtre Montansier de Versailles, à l’occasion du 400ème anniversaire de Molière, la pièce Molière pour l’amour de l’humanité de Tayeb Saddiki (éditions Eddif, 1994).
Casablanca, à l’origine Anfa, capitale des principautés autonomistes, hérétiques, anarchistes des Berghwata, avant qu’ils ne soient anéanties par les Almohades au onzième siècle.La ville des saints, de l’interspiritualité, de l’interculturalité, s’enorgueillit de trente deux marabouts qui balisent sa mémoire et la gratifie d’une mythologie singulière. La légende raconte qu’au milieu du quatorzième siècle, le tunisien Sidi Allal quitte sa ville Kairouan pour rejoindre en bateau le Sénégal. Il fait naufrage au large d’Anfa. Il est recueilli par les pêcheurs du village. A la mort de sa femme, il demande à sa fille unique Lalla Baïda de le retrouver. A son tour, elle se noie. Le père et la fille sont inhumés dans un sanctuaire érigé en marabout au dix-huitième siècle par le sultan Moulay Mohammed Ben Abdallah, reconstructeur de la vieille cité, qui se dénomme désormais Dar al-Baïda, La Maison Blanche, en hommage à Lalla Baïda, au teint immaculé de vierge.
Je me souviens de mes tantes, aristocrates et précieuses, solennelles et malicieuses, pieuses et libertines, le cou et les bras surchargés de breloques en or, trois fois consacrées par leurs pèlerinages à la Mecque, qui enchaînaient les voyages, jusqu’aux montagnes inaccessibles, dans les foires religieuses, les retraites contemplatives, les processions mystiques. Entre deux pérégrinations dévotionneuses, visite aux sorciers juifs du Mellah.
Dans l’ancienne médina, le mausolée de Lalla Taja. L’une de mes tantes se prénomme Taja en hommage à cette sainte femme de la fin du dix-neuvième surnommée la maman des orphelins, belle, compassionnelle, qui consacre sa fortune aux enfants abandonnés. Un jour, elle reçoit une aide financière du consulat de Belgique pour son oeuvre. Une rumeur court qu’elle file une idylle avec un diplomate européen, qu’elle est espionne au service d’une puissance étrangère. Elle est, dès lors, bannie de la société, victime de jets de pierre, interdite d’accès aux lieux de culte musulmans. Les femmes du quartier continuent, contre vents et marées, à la fréquenter et à la soutenir de son vivant. La sainteté s’accorde par une volonté populaire, une détermination féminine. Des femmes ayant marqué l’imaginaire collectif par leur culture, leur courage, leur générosité, leur altruisme, leur humilité sont ainsi divinisées. Lalla Taja est enterrée dans une portion de terrain octroyée par la légation belge. Son petit marabout actuellement incrusté dans les murs de l’école primaire Omar Ben Abdelaziz, quelques mètres carrés à peine, avec sa porte verte, est toujours honoré par les femmes marocaines. Un poème qu’elle aurait composé est chanté dans les hammams pendant les rituels de henné où les femmes se délivrent de tabâa, la pousuiveuse, porteuse de malheurs. Les majdoubat, des folles mystiques emportées par leur état extatique, des délirantes, sont admises et respectées comme des bienheureuses. Pour Mustapha Akhmisse, auteur de Rites et secrets des saintes au Maroc (éditions Dar Kortoba, 2015), il existe au Maroc une centaine de mausolées de waliates vénérés par la population, particulièrement féminine. Un féminisme ancestral dont témoignent encore des survivances de matriarcat dans les régions isolées.
Le mausolée de Sidi Bousmara, l’homme aux clous, sanctuaire aux murs blancs sous tuiles vertes, creusé de deux niches où les croyants déposent des cierges, à l’ombre d’un vieux figuier banian, occupe une petite place paisible dans l’ancienne médina. Selon une coutume séculaire, les visiteurs plantent des clous dans le tronc de l’arbre pour solliciter le secours du saint. Au dixième siècle, Casablanca est victime d’une terrible sécheresse. Un sage, de passage dans la ville, frappe à une porte pour quérir de l’eau. Il reçoit pour toute réponse des pierres et des injures. Il bat alors le sol de son bâton de pèlerin et en fait jaillir une source. La nouvelle se répand instantanément. Les gens accourent avec leurs jarres. Le vieil homme s’installe à demeure, vit en ermite, médite de longues heures sous le figuier. Le clou revêt une forte symbolique dans la tradition ésotérique marocaine. Le sang qu’il fait écouler éloigne les djinns. En enfonçant le clou dans un arbre, on fixe une zone magique, une attache, un ancrage.
Remembrances d’Aïn Diab, de la plage sauvage de Sidi Abderrahmane, des roches anguleuses, des traverses broussailleuses, du pittoresque escalier briqué par les marées, des chouaffat, diseuses de bonne aventure, conjureuses du mauvais sort, plus accrocheuses que les chiromanciennes tziganes, des avenirs prédits dans l’doune, plomb fondu dans un seau d’eau, des naqqachat proposant des fleurs et des coquillages en guise de tatouages, des pleureuses par procuration, des âmes en détresse en quête de guérison, de fertilité, de prospérité, des herbes miraculeuses, des concoctions merveilleuses, des amulettes fabuleuses. Le village minuscule, surpeuplé, flotte entre ciel et mer. Le diable et le bon dieu se disputent le rocher. La corniche, vaste chantier touristique investi par les émirats du Golf. En 2013, les casablancais sont surpris par l’édification d’un pont reliant Sidi Abderrahmane à la terre ferme. La privatisation programmée se dote d’une première infrastructure.Le site disparaîtra sous les villas, les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux. Les maisonnettes des voyantes seront rasées, les sorcières déportées. Le mausolée sera désinfecté, hygiénisé, aseptisé, stérilisé. Sidi Abderrahmane, Sidi Boumazmar, l’homme au luth, couve son obscure généalogie. Le saint, venu d’ailleurs comme beaucoup de saints, de Bagdad dit-on, se retire sur l’îlot avec son instrument de musique. Il dort à la belle étoile. Il offre ses chants liturgiques à l’immensité océane. Il marche sur l’eau comme Moïse. Il voyage dans des mondes invisibles. Mystique païenne, culte islamique. Préceptes monothéistes et sciences occultes s’amalgament. Les superstitions marocaines se perpétuent comme un art de vivre. Les sédimentations culturelles se conjuguent. Les femmes sont souvent associées à cette affaire de sainteté. Sidi Abderrahmane est enterré aux côtés de sa fidèle servante, probablement sa maîtresse.
Sidi Belyout, contraction d’Abou Al Louyout, le père des lions, est un berger aveugle gardant son troupeau, en compagnie d’un lion, dans la forêt d’Aïn Sebaâ, loin des humains dont il déplore la vanité. Son mausolée en centre-ville, à proximité du port et des bazars bigarrés de la vieille médina, décline à son entré un palmier rabougri surgi la nuit de son enterrement. L’eau bénite de sa fontaine se boit comme une panacée. Une trouée dans la koubba, construite en 1881, laisse passer les rayons du soleil. L’homme de la nature, saint patron de la plus grande ville.
Je pense à Hayy Ibn Yaqdhan d’Ibn Toufayl, le philosophe autodidacte, sans père ni mère, élevé par une gazelle, vivant seul sur une île inhabitée, incapable de s’insérer dans la société humaine corrompue. Méditation, connaissance empirique, précognition théologique. Paradoxe philosophique. L’Utopie de Thomas More (1516), El Criticón de Balthasar Gracián (1651), Robinson Crusoé de Daniel Defoe (1719), Les contes philosophiques de Voltaire (1714 – 1775), Tarzan d’Edgar Rice Burroughs (1912) sont directement influencés par le roman allégorique d’Ibn Toufayl, douzième siècle. Léon Gauthier, Hayy Ibn Yaqdhan, roman philosophique d’Ibn Toufayl, texte arabe avec les variantes des manuscrits et de plusieurs éditions, et traduction française, 2ème édition revue, augmentée et complètement remaniée par Léon Gauthier, Institut d’études orientales de la Faculté des lettre d’Alger, 1936. Abou Bakr Mohammed ben Abdel-Malik Ben Toufayl el-Qaïci, dit Ibn Toufayl, connu en Occident sous le nom d’Abubacer, philosophe andalou, astronome, médecin, mathématicien, soufi, né en 1110 à Wadi-Asch, mort en 1185 à Marrakech. Il est le premier médecin et visir du khalife almohade Yacoub Youssef, qui règne à la fois sur l’Espagne musulmane et le Maghreb. Il présente au « souverain des deux continents » Ibn Rochd, Averroès, qui est chargé des commentaires des écrits d’Aristote (Léon Gauthier, Ibn Toufayl, sa vie, ses œuvres, éditions Ernest Leroux, Paris, 1909).
Je me souviens du lion de l’Atlas dans le zoo d’Aïn Sebaâ. Ma tante Fatima se procure auprès d’un gardien, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes, une touffe de poils du lion exigée par son exorciseur pour lui confectionner un filtre d’amour. Le zoo, laissé pendant des décennies dans un état de délabrement avancé, est enfin rénové et remis aux normes. Le mythique lion de l’Atlas est sauvé en état de captivité, mais l’esoir de sa réintroduction dans la nature est définitivement éteint. En 2020, le plus altier de ces lions, âgé de neuf ans, surnommé Volcan, convoité par des vétérinaires français, est offert au zoo de Paris. Le fauve, qui peuplait plusieurs régions marocaines depuis la préhistoire est décimé au vingtième siècle par les chasseurs européens. Il survit jusqu’aux années vingt dans le Moyen Atlas avant de disparaître complétement à l’état sauvage dans les années quarante (Stéphane Aulagnier, Fabrice Cuzin, Michel Thévenot, Atlas des mammifères sauvages du Maroc, éditions de la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères, 2017). Le lion de l’Atlas doit sa survie à la fauverie royale. Les chefs de tribu avaient coutume d’offrir au Sultan des lions et des lionceaux capturés dans la nature. Les lions vivant dans les jardins zoologiques descendent de cette population.
Retour à la lecture de Moïse à Casa. Quatre écoliers casablancais se prennent pour des prophètes hébreux. Moïse le ténébreux, dépositaire de la parole divine. Le Livre de l’Exode en référence. Il n’est pas de prophète sans apôtres, sans panégyristes, sans prosélytes, sans zélateurs. Dans les groupes d’enfants, toujours un leader, un meneur, un excitateur. Grande marche urbaine inspirée par la Marche verte. Les petits aventuriers singent les nouveaux héros, qui bravent les sables brûlants à la conquête pacifique du dernier territoire colonisé. Un nouveau personnage entre en scène, hypnotiseur, combinard, bizarroïde. Il porte un béret kaki avec une étoile rouge. Le fantôme d’Ernesto Che Guevara passe entre deux lignes. Son nom Béretto se plante comme une énigme. Béretto, béret, du béarnais berret, couvre-chef de laine, coiffe, toque, du latin birrus, pardessus à capuchon en bure, étoffe frustre des religieux. Tout ramène à la saga de Moïse. Je visualise par homophonie le fameux pistolet italien Beretta. S’annonce une intrigue policière. Visite inopinée chez une voyante, la mère adoptive de Béretto justement, femme forte aux cheveux orange, douce et rassurante. Chose rare, elle voit tout dans un jaune d’œuf, la carence filiale, la déséquilibration familiale, le présent problématique, le devenir éthique. Déculpabilisation talismanique. Initiation chamanique.
La marche verte s’invite en permanence à la télévision. Des masses impressionnantes d’ouvriers, de paysans, de jeunes, de vieux s’élancent dans le désert. Interminable marée humaine, irrésistible, irrépressible. Je pense à la Marche du sel du Mahatma Gandhi en 1930 pour arracher l’indépendance de l’Inde. Je pense à la Marche sur Washington de Martin Luther King en 1963. L’anaphore I have de dream plus puissante que les B-5 Stratoforteresse. Les longues marches, coups de dés gagnants quand les pieds nus et les mains désarmées déferlent d’un bloc dans l’histoire. La Marche verte, inscrite en lettres de feu dans la mémoire nationale, légitime désormais la marocanité. Les enfants tournent sur eux-mêmes comme des derviches emballés par leurs propres accélérations. Ils sont le peuple. Moïse pointe son bâton vers le ciel. Ils marchent vers la Terre Promise où le père manquant a disparu.
Connaître le terrain pour arriver à bon port, les plantations paradisiaques comme le parc de la Ligue arabe, les basses-fosses pandémoniaques comme le commissariat central. Les souvenirs reviennent à ma rencontre comme dirait mon vieil ami Edgar Morin, 101 ans le 8 juillet 2022, l’œil espiègle et l’esprit toujours créatif. Je lui fais cadeau de son portrait, une peinture sur toile. Il me répond : « Merci cher Mustapha da Vinci de ce beau portrait qui me donne une belle gueule. Edgar Morin ». Edgar Morin, marrakchi électif, plus marocain que jamais. Je suis devenu sociologue, urbanologue, parce que pendant mon adolescence, marquée par la lecture des Mystères de Paris d’Eugène Sue, j’explorais tous les quartiers, tous les recoins de Casablanca. Je guettais les merveilles des impasses luxueuses, les mystères des ruelles ténébreuses, les secrets des sanctuaires. Je regardais longuement les programmes des clubs de jazz. Comprendre la ville blanche dans l’errance, l’indétermination, l’extravagance, le vagabondage, le déroutage, la stupéfaction. Je tenais mon journal intime. Je composais des récits, des nouvelles. Chaque repérage apportait ses surprises, les ingrédients d’une trame narrative.
Dans un vieil immeuble délabré, apparaît un autre protagoniste, Guébara, Guevara, un révolutionnaire irrévocable, brisé par son incarcération sous terre, un survivant de 1965 sans doute. Dans la cour, une voiture antique, rouge et noire, pneus dégonflés. Archéologie des années subversives. Nostalgie des rouspétances convulsives. La révolution ne se fait pas avec les moutons. Je repense à notre classe d’excellence au Lycée Moulay Abdellah où se fomente l’insurrection du 22 et 23 mars 1965 après la circulaire de Youssef Ben Abbès, ministre de l’Education nationale, interdisant l’accès au second cycle des lycées des élèves de plus de dix-sept ans. A l’époque, le baccalauréat ne concerne qu’une infime partie de la population, 1500 personnes par an. Nous descendons au lycée Mohammed V, ancien lycée Lyautey, avenue du 2 Mars, où les chômeurs des bidonvilles nous rejoignent. Les chars sortent des casernes. Je me réfugie pendant trois jours dans le cimetière chrétien, boulevard de la Grande ceinture. Le vieux gardien partage avec moi sa nourriture. L’armée écrase la révolte dans le sang. Mille morts. Un massacre irréparable à l’origine de cinquante-six ans d’exil.
Mustapha Saha
Sociologue, écrivain, artiste peintre
Bio express. Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste peintre, cofondateur du Mouvement du 22 Mars et figure historique de Mai 68. Ancien sociologue-conseiller au Palais de l’Elysée. Nouveaux livres : « Haïm Zafrani. Penseur de la diversité » (éditions Hémisphères/éditions Maisonneuve & Larose, Paris, 2020), « Le Calligraphe des sables », (éditions Orion, Casablanca, 2021)
Mustapha Saha. Sociologue, poète, écrivain, artiste peintre.