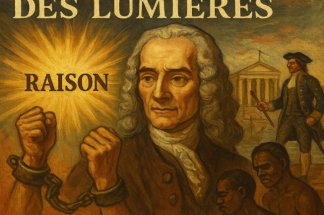Culture
L’amour maternel, note de lecture dans Habiller le Ciel d’Eugène Ébodé – Par Pierre Fandio

‘’Mère (photo) ne put aller à l’école, mais elle fut assidue […] au pavillon de la maternité de Douala’’ Eugène Ebodé -Habiller le ciel d’Eugène Ebodé se trouve ainsi être incontestablement le roman le plus intime de l’auteur de Souveraine Magnifique,est aussi un chant à la gent féminine et notamment à la femme africaine traditionnelle, à la famille et à la transmission.
Le nouveau roman d’Eugène Ébodé[1] est publié l’année des 60 ans de l’écrivain et surtout après que la « mort a enlacé, d’une étreinte blanche et sèche » (p.14), la mère du narrateur. L’on pourrait, à juste titre, penser que le fils adoré de Vilaria a attendu le « départ » de la « louve aux mots perçants » (p.22) pour mettre en mots des « crimes » qui, du fait de la disparition de la victime, pourraient être prescrits. En fait de « petites trahisons », le jeune Eugène en a commis dont la connaissance aurait certainement révulsé la femme pieuse qui a toujours « habillé le ciel des prières » afin que son rejeton reçoive les bonnes grâces du Tout-Puissant. La mère attentionnée ne saura ainsi jamais que, frottant ses genoux endoloris sur les « bancs rugueux » de l’Église du Christ-Roi de Douala, le futur auteur de La Rose dans le bus jaune lançait aux cieux une supplique très loin d’être catholique : « Seigneur, confesse-t-il perfidement, être courbé ici me tue. Ce dont je rêve, c’est de gratter la guitare, d’écrire des chansons ou de petites saynètes » (p.173). En clair, au lieu « de demander la grâce de l’Éternel », comme le lui réclamait sa mère, le « garnement » faisait tout le contraire : « J’avais davantage habillé le ciel, non de prières hachées, bâclées et mal embouchées, mais de mes idées, mes flâneries et mes fictions » (p.141).
La Mama Africa ne s’en serait sans doute jamais relevée si elle avait aussi découvert que, exilé au Tchad pour rechercher le dernier diplôme qui faisait défaut à sa collection en ce temps-là, son très cher et doux Pééé (terme affectueux par lequel elle appelait son fils) qui « détestait alors les diplômes comme Mère détestait le ballon rond » (p. 33), n’était pas seulement devenu le métronome de Cotton Tchad, une équipe leader du championnat de première division de football local, mais en plus, le « petit criminel » ne s’était point départi de son amour insatiable pour la musique, une autre abjection de son ancienne danseuse étoile de mère. Pire, dans une « Ndjamena sous la pluie des balles » (p.81) des hommes du rebelle Hussein Habré et de ceux de Goukouni Oueddei qui fit des milliers de morts, l’inconscient collégien avait imprudemment pris sur lui d’effectuer un grand détour par Farcha, l’épicentre des combats, habité par la vision d’hypothétiques « coups de reins euphorisants » (p.86) de Myriam Ningor, sa belle camarade de lycée dont il ne pourra même plus apercevoir le simple visage.
Tout en allongeant les foulées, et malgré les fracas revenus semer son désordre à Ndjamena, confesse l’intrépide idiot, je rêvais, je l’avoue, de l’échancrure de la robe de Ningor. Celle par laquelle se dévoilait un sein quand elle me préparait à ses assauts. Cette pensée me donna un supplément d’ardeur à vaincre l’épuisement (p.85).
En effet, dès les premiers coups de feu, la maison des Ningor avait été prise d’assaut par le ténébreux soupirant colonel K. qui, profitant du chaos ambiant, avait décidé que le moment était enfin venu d’assouvir un désir resté trop longtemps au stade de simple fantasme. Notre doux rêveur n’aura d’ailleurs la vie sauve que parce que l’officier supérieur longtemps éconduit par la lycéenne n’avait point reconnu son jeune rival dans le tumulte engendré par les événements…
Cependant, que Mère qui désormais sait tout, n’ait point reproché ces écarts de conduite et quelques autres, même pas dans la « Missive d’outre-limbes » (p. 252) qu’elle adresse a posteriori à son fils bien aimé, peut valoir absolution. Qu’est-ce qu’une mère ne ferait pas pour son enfant ? On l’aura sans doute compris : ce roman de 13 chapitres n’est point la narration de la trahison d’une mère par un fils adulé. Au contraire, dicté par l’amour de celui-ci pour celle-là, le onzième roman d’Eugène Ébodé est une palpitante ode à une mère dont le lecteur semble ressentir presque physiquement le souffle derrière chaque mot du narrateur, tant celui-ci imprègne le texte de bout en bout. Ainsi, même quand le je narrant parle de soi, c’est très souvent pour mieux exprimer cette génitrice inspirante avec qui, en dépit de quelques divergences compréhensibles, il partage beaucoup plus de convergences que l’une et autre semblent faire accroire. Les deux mélomanes dont la musique semble irriguer les veines tant elle est présente à tous les compartiments de leur vie, partagent aussi un même goût prononcé pour l’art en général (l’un a l’écriture chevillé au corps/cors et l’autre la chanson et la danse dans la peau), un sens identique de l’expression corporelle (l’une fut danseuse étoile et l’autre footballeur de haut niveau, etc.), un même sens aigu de la famille, une maîtrise similaire de l’art du bien dire, etc. « Telle mère… tel fils », serait-on tenté de dire.
Ce n’est donc pas une surprise que le manque (au sens psychanalytique) de celle-ci déclenche chez l’autre cette confession (« délire ») toute en tendresse, en délicatesse et en finesse. « Les chagrins, quels qu’ils soient, affirme à juste titre l’auteure de The Human Condition, deviennent supportables si on les met en récit ou si l’on en tire une histoire » (Arendt1958 : 10). A l’image de son compatriote Elvis Kemayo dans sa chanson à succès « Mama » (Best Of 3 : Paradis Noir), le fils de Vilaria « exilé » en France n’a ainsi pu assister à l’enterrement de celle qui lui a donné la vie et surtout la personne qu’il aime plus que tout au monde. Alors refluent dans la mémoire de l’adulte et néanmoins tout jeune orphelin, des moments partagés avec cette amazone qui, « la main toujours ferme sur le gouvernail » (p.226) de la vie, a quasiment toujours réussi à faire rimer difficulté avec opportunité, autour d’elle. La narration toute en poésie découvre alors une mère ambitieuse au sens noble du terme, qui ne recule devant aucun sacrifice pour faire émerger sa progéniture. Cette dernière, Eugène plus que les autres, le lui a généralement bien rendu en lui ramenant les diplômes de toutes provenances et de toutes taillescollectionnés au grès de ses pérégrinations scolaires et universitaires, afin de lui permettre « d’habiller les murs » de son salon. Plus qu’avec n’importe lequel de ses enfants, la mère poule prête « à déchiqueter et à mordre quiconque cherchait noise à sa progéniture » (p.248) aura victorieusement affronté vents et marées pour permettre à son Pééé de « fréquenter l’école des Blancs », formation dont elle n’a jamais pu bénéficier et qui très probablement lui a coûté une carrière internationale de danseuse qui lui tendait les mains.
Habiller le ciel qui se trouve ainsi être incontestablement le roman le plus intime de l’auteur de Souveraine Magnifique,est aussi un chant à la gent féminine et notamment à la femme africaine traditionnelle, à la famille et à la transmission. En effet, ni bête de somme, ni superwomen, Tante Arsène, Tante Marie-Thérèse, Grand-Mère Koulou, Mama Félicité, Vilaria, Mama Philo, Lydie, Petite sœur Chantal et bien d’autres femmes de l’univers diégétique sont, à des degrés divers, des stratèges au centre de leurs maisonnées et représentent ainsi, par leur travail acharné et leurs modes d'organisation astucieux, les premiers agents économiques et sociaux de leurs communautés respectives. En outre, « Le monde est méchant et la famille son laboratoire, mais une famille doit être soudée et savoir soutenir » (p.123) comme le dit avec justesse le narrateur. C’est ainsi que, bien que n’étant pas toujours sur la même « longueur d’ondes » sur tout, quasiment tous les membres du clan Ébodé élargi aux beaux-fils et aux belles-filles, œuvrent, chacun à son niveau, à la réussite du petit–fils de Philippe Ondoua, l’éphémère soldat de l’armée coloniale française. Les doyennes du clan des Amougou, quant à elles, sont les premiers agents de la transformation sociale par leur transmission adaptative des savoirs et des savoir-faire ancestraux qui, au bout du compte, font des jeunes filles de futures Rosa Parks dont l’Afrique en mutation a absolument besoin:
Les matriarches, expérimentées et dépourvues de toute naïveté, y feignaient de préserver cet ordre, mais transformaient les jeunes filles en amazones. Elles leur inculquaient, en douce, l’art de la morgue, celui de la rébellion sourde, de la riposte graduée par l’usage appropriée des proverbes. Ce dernier arsenal, conçu pour réduire la domination masculine, puisait dans l’héritage des sages les arguments pour moucher les mâles et les désarçonner. (p.23)
Roman autobiographique en ce qu’il est écrit par celui qui en est le sujet comme dirait Georges May, ce récit qui « redonne voix et corps à celle qui invitait [son fils] à habiller le ciel de prières pour détourner de [son] chemin de furieux orages » (4e de couverture), est en même temps un Bildungsroman dans la pure tradition de roman de formation. En effet, parallèlement aux « flashs indicibles remontant des émois concassés ou entassés dans la grotte des souvenirs cadenassés » (p.226) de l’ancien élève du collège Libermann de Douala, le narrateur déroule, étape par étape, comment le futur administrateur de la nouvelle chaire des littératures et des arts africains de l’Académie du royaume du Maroc, est devenu l’écrivain célébré que nous connaissons. D’abord ses débuts, ensuite ses échecs, ses doutes et le désespoir associé et enfin se succès sont successivement mis en scène. Le narrateur renseigne à cet effet que :
C’était la nuit à Douala, que l’envie de repeindre le ciel avec des formules et des incantations tout droit sorties de mon imaginaire a pris naissance. Par un glissement imperceptible, les histoires que je lisais dans les livres commencèrent leurs métamorphoses dans la nuit étoilée. C’est en égrenant d’abord dans ma tête et dans le silence au milieu des ronflements… ». (p.141).
Ce désir ardent, nourri par une volonté de fer, ne tarde pourtant pas, comme celui de la plupart de créateurs, à être violemment confronté à la dure réalité de la réception sans pitié d’un public qui ne lui fait aucune concession. : « Je ne récolte, se désespère l’artiste en herbe, que des moqueries. Serait-il possible de rendre les persifleurs moins coriaces ? (p.173). Quant à la reconnaissance, qui d’autre pour la prononcer sinon celle dont la vie toute entière a été mue par le désir de faire de son fils un homme respectable? Que la paysanne « qui n’a jamais su lire » (p.17) devenue danseuse à Douala se félicite, de l’au-delà, d’avoir pour maîtres rien moins que Apulée et Cheik Anta Diop, est la preuve que son rejeton est finalement devenu l’homme dont elle avait rêvé. La « note de lecture » du dernier livre d’Eugène Ébodé que celle qui se veut désormais mieux que Shéhérazade (p.258) délivre dans sa « Missive d’outre-limbes » en miroir au récit du fils, consacre ce dernier écrivain. Cette légitimation vaut bien plus que toutes les consécrations/légitimations que le lauréat du Prix Ève-Delacroix de l'Académie française (2007) pour Silikani, du Prix Yambo Ouologuem (2012) pour Madame l'Afrique, du Grand prix littéraire d’Afrique noire (2014) pour Souveraine Magnifique ou encore du Prix Jean d'Heurs du roman historique décerné par le département de la Meuse » (2015) pour Souveraine Magnifique aura engrangées et même probablement celles qu’il obtiendra :
Yanpoupo, j’ai lu ton dernier livre sur ta petite maman. […] Tu as bien résumé mes sentiments dans ton livre. […] Une dernière chose Pééé : avec ce livre sur la louve qui t’a enfanté, tu es parvenu à accoucher de ta vieille maman sans douleur, proclame-t-elle. (pp.256-258)
Comme dans tout roman autobiographie, l’on peut bien comprendre que des noms et des lieux soient modifiés et des événements recréés pour les rendre plus dramatiques, mais l'histoire de Habiller le ciel ressemble beaucoup à celle de la vie de l’auteur de La Divine colère. Prenant en charge une tranche de vie d’une soixantaine d’années dans un monde qui vit des mutations dont l’accélération n’a jamais connu pareille vitesse depuis l’histoire de l’humanité, le dernier roman en date du Chevalier de l'Ordre de la Valeur de la République du Cameroun 2016,ne pouvait ainsi ne pas interférer avec celle de son pays, de l’Afrique et du reste du reste du monde.La grande Histoire s’invite ainsi, quoi que par le biais, dans la petite histoire des « assauts de culpabilité qui ont rongé » (4e de couverture) le jeune orphelin suite à son absence aux obsèques de sa mère. Il en est ainsi, par exemple, de l’inévitable comparaison entre le premier et le deuxième régime politique qu’a jamais connus le pays du ministre Charles Onana Awono, ci-devant oncle du narrateur. Le dualisme plus ou moins justifié qui structure globalement les analyses de la chose politique du Cameroun y est lancinant. Sous « l’ancien régime », affirme de co-auteur de « Halte à la présidence à vie en Afrique » (Le Monde Afrique, 11 septembre 2020),« Le meilleur gouvernement [n’était] pas celui qui [donnait] satisfaction aux membres de la famille des ministres, mais à l’ensemble du pays » (p.159). Par contre, en faisant « du Cameroun, faussement paisible sous un ardent volcan de tribalisme » (p.128), le « nouveau régime », quant à lui, semble avoir transformé l’espace de référence commun à celui de Le Match des adieux (2022) d’Élisabeth Ewombè Moundo, en « un fagot de bois sec qui n’attendait que la buchette et l’allumette pour flamber ». (Moundo Ewombè 2022 : 152).
Le détour par l’interminable guerre du Tchad, pour sa part, permet à l’observateur intéressé de l’Afrique de pointer du doigt, non seulement le côté proprement absurde et absolument contreproductif de la violence postcoloniale dont les principales victimes sont encore et toujours les populations au nom desquelles elles sont prétendument déclenchées, mais aussi et surtout le racisme rampant qui structure fondamentalement « l’assistance » tout comme le prétendue « aide » internationales. Que de pauvres Africains qui croyaient en l’universalité de l’humanité soient rejetés sans ménagement à l’embarquement des avions dits « humanitaires » venus « sauver les populations » des bombes à Ndjamena, que dans l’indifférence la plus totale de la prétendue « communauté internationale », des désespérés accrochés aux avions « qui croyaient qu’on les prendrait en pitié » (p.94) se voient transformés en « parachutistes sans parachute » (p.92) et finissent éclatés au sol par leur poids décuplé par l’énergie cinétique, voilà une leçon à méditer par tous ceux qui continuent de croire qu’entre la France et le Tchad et plus généralement entre l’Occident et l’Afrique, il peut y exister autre chose que des intérêts mercantiles.
En tout état de cause, fort de ses « noces de Diamant » bien méritées, le Pépa (mot-valise affectueux pour dire père ou papa dans le sud du Cameroun) de Vilaria peut désormais se permettre des sentences traduisant des savoirs et des savoir-faire accumulés Ces dernières pullulent dans ce texte dont un certain nombre de mouvements se trouvent ainsi rythmés par le savoir gnomique sur l’homme, sur l’histoire, sur le pouvoir, etc. On peut ainsi en relever dès l’entame de la narration où le désormais sage affirme qu’« un être n’est pas seulement la somme des événements du passé reconstruits ou non » (p.14). Autour du milieu de la narration, il proclame: « Être un écrivain est une condamnation » (p.142). Dans les derniers moments de l’histoire, l’observateur est tout aussi gratifié un « Le pouvoir n’enfle pas seulement les têtes, mais il réclame le sang. Beaucoup de sang. Surtout, quand il est absolu. Il réclame absolument le sang » (p.241).
Ainsi qu’on l’aura constaté, Habiller le ciel s’appuie sur les faits réels, à l’image des précédents textes de l’auteur de « Pouchkine : l’icône universelle ou le Bantou magnifique » : l’arrestation de Rosa Parks le 1er décembre 1955 dans La Rose dans le bus jaune, le génocide des Tutsis au Rwanda dans Souveraine Magnifique, la chanson Silikani de Tabuley Rochereau dans Silikani, la guerre d’indépendance au Cameroun dans La Transmission, etc. Mais à la différence de ceux-ci, le dernier roman est une autobiographie, qui inscrit l’histoire personnelle de l’auteur et donc celle de son imposante œuvre, au centre de la narration. Et du coup, au-delà de dimension intime évoquée plus haut, le roman explore encore mieux les ingrédients convoqués séparément dans les œuvres précédentes qui expliquent au moins en partie leur réception enthousiaste.
Exploitant alors à merveille la culture encyclopédique de l’adolescent migrant devenu intellectuel attachant sans attache véritable, cette histoire captivante et prenante de « mère et fils » (p.13) en devient une alchimie harmonieuse faite d’un mélange subtil de réalité et de fiction, capable de convoquer et combiner l’histoire et la géographie, l’Occident et l’Orient, les imaginaires et les représentations en ce que ces derniers ont de convergent voire de divergent. La grande lisibilité de cette histoire qui, à quelques lignes d’intervalle, associe des héros connus ou méconnus, qu’elle confronte avec les pires criminels de la grande comme de la petite histoire, tient aussi à cette écriture jubilatoire qui mêle avec un art consommé ironie, humour, sarcasme ou dérision. La narration est ainsi sertie d’épisodes mémorables où le sourire se discute au rire franc ou jaune, voire au fou-rire. Le narrateur autodiégétique réussit ainsi faire sourire, même devant la tragédie qui le frappe. L’annonce du décès de sa mère qui, dit-il, « a toujours adoré le mois de la rentrée des classes » (p.16), manie avec une rare dextérité l’absurde, la dérision et l’autodérision. Le conteur espiègle y marie, en trois phrases, Meursault de L’Étranger (Albert Camus), Camara de Le Zéhéros n’est pas n’importe (Williams Sassine) et bien plus : « Elle s’est donc éteinte le 4 septembre. Mais, septembre n’est vraiment pas un bon mois pour mourir quand on a un fils enseignant. Elle n’avait pas le choix. » (p. 16). Habiller le ciel en est, au bout du compte, une narration exigeante mais tout aussi haletante et plaisante.
[1]Habiller le ciel, Eugène Ébodé, Paris, Gallimard, Collection « Continents noirs », 2022, 262 pages