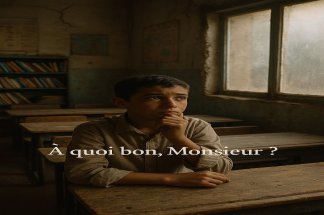National
Après Addis-Abeba, la politique extérieures du Maroc a besoin d’être réévaluée - Par Bilal Talidi

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain au sommet de l'UA les 15 et 16 février 2025
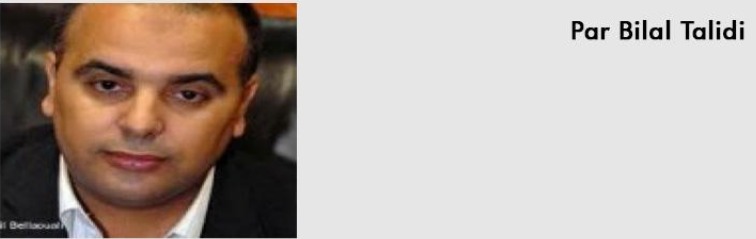
L’élection du poste de vice-président de la Commission de l’Union africaine (UA) lors du 38ème sommet de l’UA à Addis-Abeba, a montré que la diplomatie marocaine n’a pas réussi cette fois-ci à neutraliser les manœuvres de l’Algérie qui a jeté toutes ses forces dans cette échéance. Et il est indéniable que le Maroc a perdu cette bataille, un état de fait qui a besoin d’avantage de réflexion et réévaluation que de justification.
Contrairement à certaines analyses erronées, le problème ne réside ni dans la candidature ni dans la personnalité choisie par le Maroc pour ce poste. L’élan que le Maroc a acquis grâce à une politique africaine active depuis plus de deux décennies, ainsi que les qualifications dont dispose Mme Latifa Kharbache, rendent peu pertinente une remise en question de ces deux faits.
Qu’est-ce qui a faussé les calculs ?
Ce constat est renforcé par le fait que les chances du Maroc et de l’Algérie étaient équilibrées (21/21) au premier tour, et que l’écart entre la candidate marocaine et sa rivale algérienne était minime par la suite. Cependant, le retrait de la représentante égyptienne Hanan Morsi au quatrième tour a creusé l’écart, permettant à la candidate algérienne de l’emporter au sixième avec 33 voix. Ce qui laisse entrevoir que des ‘’détails’’ ont fait basculer l’issue du scrutin et que le problème se situe quelque part dans notre politique extérieure.
Certains, peut-être pour éluder la réalité, évoquent une « diplomatie des valises » en affirmant que l’Algérie a soudoyé plusieurs pays pour obtenir leurs votes. Or, ce type de pratiques, qui n’est pas nouveau, fait partie des paramètres que le Maroc prend en compte bien avant de décider de présenter son candidat à un poste donné.
D’autres se cantonnant dans ce qu’il faut bien appeler des spéculations, attribuent la défaite du Maroc à la perte de cinq des six pays empêchés de voter en raison de problèmes administratifs avec l’Union Africaine (notamment des coups d’État). Mais même s’ils en avaient eu la possibilité, arithmétiquement, le compte n’y est pas. Tout au plus peut-on supputer qu’ils auraient contribué à une dynamique favorable. Encore faudrait-il que tous leurs votes soient effectivement acquis au Maroc. Quoi qu’il en soit, cette situation n’était pas une inconnue dans l’équation, et le Maroc ne s’attendait certainement pas à ce que ces pays régularisent leur statut auprès de l’Union africaine avant l’élection. C’est dire que cette réalité faisait partie des éléments intégrés dans l’évaluation des chances du Maroc avant de présenter sa candidate.
Le cas de l’Egypte
L’une des explications avancées attribue cette défaite à une « trahison » de l’Égypte et au revirement de sa position. Cette explication, qui a fait l’objet d’une intense couverture médiatique, présume l’existence de profonds désaccords entre l’Égypte et l’Algérie, du fait que Le Caire avait présenté sa propre candidate. Cette candidature ‘’impromptue’’ aurait braqué l’Algérie qui y aurait vu une manière d’avantager le Maroc. Ils en veulent pour démonstration que la candidature égyptienne ne cadrait pas avec les relations historiques entre Le Caire et Alger.
Mais ce raisonnement néglige un fait important : L’Égypte savait pertinemment qu’elle n’avait aucune chance de l’emporter. Elle a présenté sa candidate ni pour les beaux yeux du Maroc ni pour ceux de l’Algérie, mais uniquement pour renforcer sa position de négociation. Dès qu’elle a vu son intérêt se tourner vers l’Algérie, elle s’y est ralliée sans états d’âme, après avoir donné l’impression au Maroc qu’elle visait ainsi à le soutenir et à l’imposer face à l’Algérie.
Un autre discours tente de minimiser l’impact de la perte par le Maroc du poste de vice-président de la Commission de l’Union africaine, en mettant en avant la victoire du ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, un candidat proche du Maroc, à la présidence de la Commission africaine en remplacement du Tchadien Moussa Faki. On serait ainsi en présence d’une sorte de succès par procuration. Mais aussi fidèle et loyal que pourrait l’être le nouveau président djiboutien, ces postes sont soumis à de nombreuses fluctuations, en fonction des intérêts, des pressions et des contradictions que leurs titulaires doivent gérer dans leurs nouvelles fonctions, sachant qu’en diplomatie la constance est un bien beau mot mais sans consistance.
Les vraies questions
L’évaluation marocaine de cet ‘’insuccès’’ doit être fondée sur le réalisme et l’objectivité. Il faut surtout éviter de lui substituer un discours émotionnel qui dispense de l’autocritique et rejette la responsabilité sur les pratiques ‘’immorales’’ des adversaires. Il ne faut pas non plus se focaliser sur la recherche de boucs émissaires, mais se concentrer sur l’essentiel pour prendre la mesure de ce qui est une alerte sérieuse.
Les questions les plus importantes qui méritent d’être posée, indépendamment du rôle de l’Égypte et de son revirement en coulisses, consistent à savoir comment l’Algérie a-t-elle obtenu 22 voix dès les premiers tours ? Quelle est la liste des pays qui ont voté pour elle ? Et quelle est la position de la diplomatie marocaine vis-à-vis de ces États ?
Les données relatives aux votes obtenus par la candidate marocaine, sans compter les pays privés de vote, sont raisonnables et reflètent une part importante du dynamisme de la politique marocaine en Afrique. Cependant, elles restent insuffisantes, car elles révèlent une faille dans la politique du Maroc en Afrique du Nord, notamment en Libye. Pourtant, depuis plus de quinze ans, le Maroc joue un rôle central dans la résolution de la crise libyenne en facilitant le dialogue entre les factions politiques à Skhirat et Bouznika, dans le but de parvenir à un accord final permettant à la Libye de progresser vers un État institutionnel. En même temps, le Maroc peine toujours à décrypter la position de l’Égypte d’Al-Sissi.
Néanmoins, ce qui s’est passé à Addis-Abeba indique que le problème ne réside pas seulement dans la politique de Rabat envers ces deux pays d’Afrique du Nord, pour lesquels elle dispose pourtant de nombreux leviers de persuasion en faveur d’une coopération mutuelle fructueuse. Il s’agit plutôt d’une nécessité plus profonde : celle de renouveler le paradigme structurant la politique étrangère marocaine. Cette nécessité découle d’un handicap originel aussi bien que des transformations majeures qu’a connues le continent africain après la pandémie de COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne.
Il est certain que la politique étrangère marocaine à l’égard de l’Afrique est largement conditionnée par la question du Sahara. Cela a eu un impact sur la production d’initiatives (comme l’Initiative atlantique) et sur les enjeux stratégiques (comme le gazoduc Nigéria-Maroc). Ces projets visent à capitaliser sur l’élan acquis par la politique africaine du Maroc depuis 2002 et à consolider son retour au sein de l’Union africaine en 2017. Toutefois, la diplomatie marocaine est restée concentrée sur le cercle des 28 pays ayant soutenu ce retour, sans véritablement réussir à étendre cet élan à l’Est, au Centre et au Sud de l’Afrique, où les déplacements du Roi avaient pourtant ouvert des pistes prometteuses. Cette nécessité d’aller au-delà de la zone de plus ou moins de confort, existait bel et bien dans la doxa diplomatique du Royaume, mais elle est souvent restée au stade d’une volonté et de l’intention.
L’urgence d’un nouveau paradigme
Il semble donc urgent de forger un nouveau paradigme pour la politique marocaine en Afrique, qui capitalise sur les acquis en Afrique de l’Ouest tout en explorant des voies innovantes pour percer dans d’autres régions du continent. Il est crucial de bâtir sur les avancées diplomatiques obtenues en direction du Nigeria et de l’Éthiopie, ainsi que sur l’ouverture balbutiante avec l’Afrique du Sud. Pour élargir son influence, le Maroc doit multiplier les axes d’action sans les enfermer dans une vision unique, car l’immobilisme stratégique limite sa capacité à s’étendre au-delà de la sphère naturelle de sa présence en Afrique de l’Ouest.
Dès le mois prochain, Rabat fait face à un autre défi : la compétition pour le siège de l’Afrique du Nord au Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine. Ce poste n’a pas été tranché lors de cette session, mais l’Algérie a déjà obtenu 30 voix contre 17 pour le candidat marocain et 6 pour celui de la Libye.
Un mois ne suffit certainement pas pour évaluer et rectifier toute une vision diplomatique. Cependant, ce laps de temps offre au moins une opportunité d’analyser les enseignements d’Addis-Abeba et de s’en inspirer pour éviter la reproduction de l’échec de la semaine dernière.