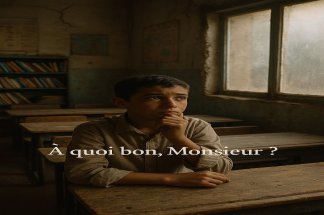National
Rose à parfum : Une récolte record attendue à Kelâat M’Gouna en 2025

Des prévisions optimistes pour cette année : plus de 4.800 tonnes de roses à parfum devraient être récoltées lors de la campagne agricole 2024-2025, contre 3.500 tonnes l’an dernier
La filière de la rose à parfum, emblème de Kelâat M’Gouna et moteur économique de la région, s’apprête à battre un record en 2025 avec une production prévisionnelle dépassant les 4.800 tonnes. Portée par une demande croissante, une valorisation de son terroir et le soutien du Plan Maroc Vert, cette culture continue de se positionner comme un levier clé du développement durable des zones oasiennes.
Une filière en pleine floraison
A la 60e édition du Salon international de la rose à parfum, organisée du 5 au 8 mai à Kelâat M’Gouna, l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) de Ouarzazate a annoncé des prévisions optimistes : plus de 4.800 tonnes de roses à parfum devraient être récoltées lors de la campagne agricole 2024-2025, contre 3.500 tonnes l’an dernier.
Ce bond de production est le reflet d’une dynamique soutenue, notamment dans la province de Tinghir, où 1.020 hectares sont actuellement consacrés à cette culture. Les exportations, elles, atteignent environ 60 tonnes, signe de l’intérêt grandissant pour ce produit aux propriétés prisées dans l’industrie cosmétique et aromatique.
Selon Abdellah Abdellaoui, chef du service de la production agricole à l’ORMVA, la filière s’appuie sur un climat propice, une main-d'œuvre qualifiée et une infrastructure industrielle en développement, permettant la transformation et la valorisation locale de cette ressource naturelle.
Atouts et défis d’un patrimoine vivant
Reconnue pour sa qualité exceptionnelle, la rose de Kelâat M’Gouna a obtenu deux signes distinctifs dans le cadre du Plan Maroc Vert : l’Appellation d’Origine Protégée "Rose de Kelâa M’gouna-Dadès" et "Eau de Rose de Kelâat M’Gouna-Dadès". Ces certifications viennent renforcer la notoriété de la région, tout en assurant la traçabilité et l’authenticité de ses produits.
La culture est concentrée dans cinq communes clés : Ait Sedrate Sahl Gharbia (31 %), Khémis Dadès (29 %), Ait Sedrate Sahl Charkia (19 %), Kelâat M’Gouna (11 %) et Ait Ouassif (10 %). Toutefois, plusieurs défis persistent. M. Abdellaoui alerte notamment sur la persistance de pratiques agricoles peu développées, ainsi que sur la concurrence déloyale de produits de moindre qualité, qui affectent la rentabilité des producteurs locaux.
Pour pérenniser les acquis et faire de la filière un véritable moteur économique régional, il plaide pour le renforcement de la recherche scientifique, l’innovation dans les techniques de culture et de transformation, ainsi qu’une meilleure régulation du marché.
Le Salon international de la rose à parfum constitue chaque année une vitrine pour ce savoir-faire ancestral. Il vise à souligner la dimension économique, sociale et culturelle de la filière, tout en inscrivant son développement dans les objectifs de la stratégie Génération Green, qui mise sur une agriculture durable, inclusive et orientée vers la valeur ajoutée.
Rassemblant producteurs, experts, institutions et partenaires internationaux, cet événement met en lumière la rose à parfum non seulement comme produit d’exportation, mais surtout comme symbole d’un développement régional intégré, ancré dans les spécificités oasiennes du Sud marocain.