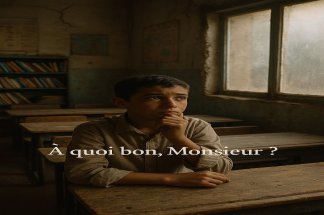National
Devant le Conseil des Oulémas, Bouayach en appelle à Ibn Rochd pour étayer la convergence entre les finalités de l’islam et les droits de l’Homme

La présidente du CNDH, Amina Bouayach
Une femme ‘’civile’’ devant le Conseil Supérieur des Oulémas, c’est inédit, fut-elle la présidente du Conseil National des Droits de l’homme (CNDH), comme est inédite cette rencontre de communication’’ organisée par les ‘’sentinelles du dogme’’ avec des responsables politiques, hauts fonctionnaires de l’Etat dans des secteurs aussi sensibles que la justice et la sécurité, ainsi que des responsables d’institutions constitutionnelles. Mais bien plus qu’une rencontre, il s’agit d’une ouverture d’un ‘’cénacle’’ sur le monde extérieur et sur ses préoccupations dans une double voie de communication à deux sens.
C’est en tout cas ainsi que l’a compris la présidente du CNDH, Amina Bouayach, en y voyant une opportunité, qu’elle considère comme précieuse et stimulante pour la réflexion, l’interrogation et le questionnement. Cela exige, dit-elle une attention particulière et une remise en question des problématiques que nous identifions à travers le travail quotidien (du CNDH) auprès des individus ou des groupes, ainsi que des plaintes » qu’il reçoit, « en lien avec les axes de cette rencontre. » Ce texte, reconstitué par Quid.ma, reprend quasi intégralement l’exposé d’Amina Bouayach où, devant le Conseil supérieur des Oulémas, elle insiste sur l'importance du rationalisme et de la pensée critique, soulignant qu’il est « crucial de renforcer l’utilisation de la raison dans la construction des systèmes de valeurs, en encourageant une réflexion libre et rationnelle, où l’adhésion aux principes religieux découle d’une conviction profonde et non d’un simple conformisme ».
Il ne vous échappe pas que le Conseil est une institution nationale des droits de l’Homme qui, conformément à sa loi organique, examine toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et des libertés, ainsi qu’à la garantie de leur exercice intégral et à la préservation de la dignité des citoyens et citoyennes, individuellement et collectivement. Son action s’inscrit dans le respect des dispositions de la Constitution du Royaume, des références universelles en matière de droits de l’Homme et des principes internationaux régissant le travail des institutions nationales des droits de l’Homme.
J’ai choisi de mettre en lumière l’approche du Conseil dans son interaction avec la question du développement à travers trois principes interconnectés : Le développement, un droit fondamental de l’Homme, le développement qui ne se résume pas à des programmes ou à des efforts visant à satisfaire les besoins des personnes, et l’adoption d’une stratégie fondée sur l’effectivité des droits.
Le développement est un droit fondamental de l’Homme
Il s’agit d’un droit qui renforce les capacités des individus en leur permettant d’y participer, d’y contribuer et d’en bénéficier. Sa philosophie repose sur l’équité, l’égalité et la justice, qui constituent des déterminants essentiels du développement. Ce droit au développement devient ainsi un levier pour la mise en œuvre complète des autres droits et libertés.
Le développement ne se résume pas à des programmes ou à des efforts visant à satisfaire les besoins des personnes
Il est lié à leurs droits. Il y a une distinction fondamentale entre une approche qui se limite à répondre aux besoins, mettant ainsi la personne dans une position passive, et une approche basée sur les droits, qui fait d’elle un acteur du processus de développement. La première approche cherche à fournir des éléments manquants, tandis que la seconde, fondée sur les droits, vise à lever les obstacles empêchant les individus de jouir pleinement de leurs droits.
Une stratégie fondée sur l’effectivité des droits.
Cette stratégie repose sur des bases à la fois juridiques et non juridiques, incluant les dimensions économiques, sociales et culturelles.
Dans nos approches de travail, nous partons d’une conception large des droits de l’Homme, en tant qu’ensemble de droits et libertés inhérents à chaque individu du seul fait de son humanité, indépendamment de son sexe, de son origine ethnique, de sa religion ou de sa situation sociale. Les droits de l’Homme ne sont pas de simples principes théoriques, mais des engagements fondés sur des bases qui constituent leur cadre philosophique et juridique. Ces bases sont avant tout la dignité inhérente à chaque être humain, l’égalité, la liberté, la justice et l’État de droit. Ces principes sont évidemment en lien direct avec le sujet que nous abordons, puisqu’ils constituent des points d’articulation entre les droits, le développement et la culture.
La convergence des finalités approfondie et élargie par l’effort d’interprétation
Dans cette perspective, et étant donné que les valeurs varient selon les contextes civilisationnels, culturels et sociaux, il apparaît clairement que les finalités fondamentales de l’islam, en tant qu’appel universel s’adressant à l’ensemble des êtres humains, convergent avec les principes fondateurs du système des droits de l’Homme. Cette convergence peut être approfondie et élargie grâce à l’effort d’interprétation (ijtihad), qui est un travail humain visant à concrétiser ces principes dans la vie quotidienne et à les traduire en comportements. Cet effort est nécessairement sociétal, c’est-à-dire soumis aux transformations de la société. Cette convergence se manifeste à au moins deux niveaux :
Lire aussi : DANS UN CROISEMENT INÉDIT : FOUZI LEKJAA FAIT LE PROCÈS DE LA FRAUDE ET DES FRAUDEURS DEVANT LE CONSEIL DES OULÉMAS
- Les finalités profondes de la religion musulmane ne sont pas en contradiction avec le fondement moral du système universel des droits de l’Homme.
Des philosophes et penseurs comme Al-Fârâbî et Ibn Rochd l’ont démontré. La Déclaration universelle des droits de l’Homme, en tant que référence fondatrice, reflète un consensus entre différentes civilisations et cultures. Elle consacre notamment la protection de la liberté de culte, l’exercice de la religion et la pratique de ses rites.
- L’accord sur l’essence des valeurs morales fondamentales ne signifie pas l’uniformité dans leur application concrète.
Il existe des écarts et des différences dans la mise en œuvre des valeurs, ce qui peut être traité par le biais de l’ijtihad et des processus de réforme visant à améliorer les pratiques, les comportements et les mentalités pour mieux protéger la dignité humaine.
Ces processus multidimensionnels ne nécessitent pas seulement une révision des lois, des procédures et des mécanismes administratifs, mais exigent également une attention particulière aux composantes intrinsèques de l’individu, y compris les dimensions sociales, économiques, culturelles et religieuses, afin de placer l’être humain au centre du développement… en tant qu’acteur et bénéficiaire.
Par conséquent, la réflexion sur les moyens et mécanismes du développement au Maroc doit s’appuyer sur une approche consciente des articulations entre les droits de l’Homme et les complexités humaines et territoriales du développement. Nos observations nous ont conduits à la conclusion qu’il ne faut pas réduire le développement à des indicateurs de croissance uniquement, mais l’inscrire dans une équation plus large, qui exige de mettre l’accent sur les dimensions culturelles et sociales déterminantes des valeurs motrices du développement.
De nos rapports, de nos observations et de l’examen des plaintes en lien avec les questions soulevées dans le cadre de cette rencontre, il en ressort quatre valeurs fondamentales que nous considérons comme des bases communes de travail entre tous les acteurs du développement :
- La valeur de la liberté
La liberté ne relève pas seulement d’une réflexion philosophique abstraite, mais elle est devenue un pilier essentiel du développement. Certaines libertés, selon les normes internationales, peuvent être soumises à des restrictions dans leur exercice, à l’exception du droit à la vie, qui est un droit absolu. La liberté reflète la volonté des individus et des communautés, notamment en ce qui concerne notre sujet, à savoir leur liberté d’initier des projets de développement et leur capacité à innover et créer des richesses dans un cadre légal.
C’est pourquoi les théories économiques modernes ont établi un lien étroit entre liberté et développement, comme en témoigne l’approche de l’économiste Amartya Sen, lauréat du prix Nobel d’économie.
L’ancrage de la valeur de la liberté dans nos sociétés implique une compréhension profonde des transformations et des défis liés aux mutations engendrées par les réseaux sociaux, qui offrent désormais des opportunités inédites de débat et de mobilisation des individus et des groupes en dehors des cadres traditionnels du débat public.
Ces transformations nous interpellent sur notre capacité à appréhender les mutations structurelles de la société, notamment l’émergence de nouvelles formes d’expression publique dans l’espace numérique, qui traduisent les aspirations des individus et des groupes à un espace plus ouvert et plus juste. Nous entendons par expressions publiques, les formes et dynamiques qui émergent d’échanges virtuels et évoluent vers des actions publiques interpellant la réalité sociale.
- La valeur de l’égalité
L’égalité est l’un des piliers fondamentaux d’un développement inclusif et durable, car elle représente un facteur transversal essentiel à la réussite des politiques de développement. Son inscription dans les constitutions et son encadrement législatif ne suffisent pas à garantir son impact réel sur les relations sociales, économiques et culturelles.
Le principe d’égalité se traduit par des mécanismes favorisant l’égalité des chances dans l’éducation, l’accès au marché du travail, aux soins de santé et à l’autonomisation économique, garantissant ainsi que tous les citoyens puissent bénéficier du développement sans discrimination. Il est également essentiel de mettre en place un environnement inclusif, permettant la participation des groupes vulnérables à l’élaboration des politiques publiques.
Dans ce contexte, le Conseil National des Droits de l’Homme a constaté que le Maroc fait encore face à des défis majeurs pour combler les écarts, équilibrer les dynamiques du développement et atteindre une véritable égalité dans ses différentes dimensions.
- La valeur de la justice
Dans les années 1980, les approches du développement ont soulevé le débat sur la justice distributive et l’allocation équitable des ressources. Cependant, la théorie des capacités, développée par Amartya Sen, a démontré que la simple répartition des ressources ne suffit pas à garantir la justice sociale si elle n’améliore pas concrètement les conditions de vie des populations les plus vulnérables.
Par exemple, l’accès à l’éducation et à la santé ne se limite pas à une question de distribution des services, mais dépend aussi de la capacité réelle des individus à en bénéficier. C’est cette inégalité d’accès qui alimente les disparités sociales et spatiales et qui devient une source de tensions dans la société.
Ainsi, la justice, en tant que fondement du développement équitable et inclusif, repose sur une approche qui garantit l’intégration des populations les plus fragiles et défavorisées, en assurant une égalité des chances dans l’accès aux services publics essentiels.
Dans cette perspective, la justice ne doit pas être mesurée uniquement en termes quantitatifs (nombre de bénéficiaires du développement), mais aussi en termes qualitatifs en tenant compte du contexte social et économique des populations concernées**.
L’un des obstacles majeurs expliquant l’écart profond entre les ressources allouées aux politiques publiques sociales et leur impact réel** réside dans **l’absence d’une justice redistributive efficace, qui permette de réduire les inégalités sociales et spatiales et d’orienter les politiques vers **un changement qualitatif dans la vie des individus**.
- La valeur de la solidarité
La solidarité constitue un pilier fondamental des choix de développement, en tant que valeur humaine ancrée reposant sur deux éléments essentiels :
- La conscience des individus de leur destin commun ;
- La volonté spontanée qui découle de cette conscience, visant à coopérer, à s’entraider et à s’unir pour relever les défis et surmonter les obstacles.
Les crises que nous avons traversées ont prouvé que la valeur de la solidarité est profondément enracinée dans l’héritage culturel marocain**, et qu’elle se renouvelle sous différentes formes. L’histoire nous enseigne qu’au fil des épreuves et des situations difficiles que nous avons vécues, les pratiques solidaires ont joué un rôle essentiel dans la consolidation de l’identité sociale et le renforcement de la conscience collective.
Ces valeurs constituent des principes directeurs des orientations stratégiques du développement et s’inscrivent dans un horizon universel. Toutefois, leur mise en œuvre demeure conditionnée par **un processus continu d’adaptation aux évolutions sociétales**.
Les pistes pour promouvoir les valeurs motrices du développement
L’évolution du système des droits et libertés n’a jamais été le fruit d’un seul modèle ou d’une unique expérience civilisationnelle, mais le résultat de transformations sociales, politiques, économiques et culturelles interdépendantes, traversant les civilisations et les époques. Cette évolution est le produit de dialogues, de débats et de confrontations intellectuelles prenant en compte les spécificités des sociétés.
Les finalités de l’islam soulignent un ensemble de valeurs fondamentales et immuables qui reflètent ses principes universels, tout en offrant une flexibilité qui permet leur adaptation aux divers contextes historiques et sociaux. Des concepts tels que la justice, l’égalité, la dignité humaine et la liberté forment un cadre général d’organisation de la société, garantissant un équilibre entre les principes religieux et les exigences du monde moderne.
Lire aussi : RENCONTRE AU CONSEIL SUPÉRIEUR DES OULÉMAS : UN MESSAGE ET UN TIMING – PAR BILAL TALIDI
Dans cette perspective, il serait contre-productif de considérer l’être humain comme un être figé, imperméable aux transformations culturelles, sociales et économiques qui l’entourent. Une telle approche risquerait de creuser un fossé entre ses convictions et la réalité changeante qui l’entoure. C’est pourquoi l’ijtihad (l’effort d’interprétation) s’impose comme une nécessité impérative, afin d’apporter des réponses aux défis émergents qui entravent le développement et la dignité humaine.
Nous devons alors nous poser la question suivante : L’absence d’une pensée critique permet-elle d’éviter les problématiques dont souffre la société ?
a réponse est non, sans aucun doute, car les transformations sociétales et les aspirations humaines sont en perpétuelle évolution, influencées tant par des dynamiques internes que par des contextes plus larges. Cela souligne l’urgence d’un ijtihad contemporain, adapté aux évolutions du monde, et s’appuyant sur un dialogue inclusif et ouvert à différentes perspectives philosophiques.
L’islam modéré et centré sur la réflexion rationnelle met en avant des valeurs fondamentales pour l’épanouissement de l’être humain, mais ces valeurs ne peuvent pleinement s’exprimer lorsque la pensée critique et rationnelle est limitée. Ce déficit affaiblit la capacité des sociétés à faire face aux défis contemporains et réduit leur résilience morale et intellectuelle.
L'importance du rationalisme et de la pensée critique
Il est donc crucial de renforcer l’utilisation de la raison dans la construction des systèmes de valeurs, en encourageant une réflexion libre et rationnelle, où l’adhésion aux principes religieux découle d’une conviction profonde et non d’un simple conformisme. À cet égard, Ibn Rochd soulignait l’importance de la raison pour interpréter les textes religieux et les éclairer à la lumière de la pensée logique, dans le but de **réaliser les objectifs supérieurs de l’humanité.
Ainsi, chers participants, mobiliser les individus et les communautés pour s’engager dans le développement nécessite une éthique rationnelle, qui favorise la pensée critique, stimule les initiatives et encourage l’innovation. Le développement de la pensée et sa protection contre l’ignorance et la désinformation ne sont pas de simples impératifs intellectuels, mais une obligation sociétale et religieuse visant à renforcer le rôle actif du citoyen dans le développement**.
L'éducation, levier de la pensée critique et du développement
Nous considérons que la protection intellectuelle et morale repose sur un système éducatif qui favorise la recherche scientifique et encourage l’ijtihad afin d’apporter des réponses pratiques et méthodologiques aux enjeux du quotidien. L’éducation doit permettre aux individus d’interroger la réalité qui les entoure, tout en développant leurs capacités analytiques et méthodologiques, afin qu’ils puissent interagir de manière consciente et critique avec les problématiques sociétales, y compris celles liées au développement.
Le lien entre les pratiques religieuses et les interactions sociales joue un rôle clé dans le renforcement du sens de responsabilité chez les citoyens. Cependant, les programmes éducatifs restent souvent focalisés sur les aspects juridiques et rituels des pratiques religieuses, en insistant sur leurs conditions, obligations et modes d’accomplissement, tout en négligeant leurs dimensions éthiques et comportementales. Ce mode d’enseignement purement normatif affaiblit la capacité des individus à comprendre les dimensions spirituelles profondes de la religion, les réduisant à de simples prescriptions appliquées mécaniquement, sans stimulation de la réflexion critique ni approfondissement de la compréhension des finalités de l’islam. Cette approche risque d’accentuer la séparation entre les pratiques religieuses et les interactions sociales.
Ainsi, réformer les programmes éducatifs et renouveler le discours religieux ne constitue pas un luxe intellectuel, mais une nécessité vitale pour assurer une adaptation aux transformations du monde contemporain et faire de la religion un levier d’épanouissement des valeurs humaines et du développement. Il est essentiel de relier les approches juridiques et spirituelles, en insistant sur l’interdépendance entre les pratiques religieuses et leur impact sur les relations humaines et sociales.
L’intégration du fiqh maqâsidî (jurisprudence basée sur les finalités), l’éducation aux valeurs et l’ouverture intellectuelle représente une voie essentielle pour produire un discours religieux renouvelé, capable de favoriser une participation citoyenne accrue dans le développement, en s’appuyant sur les réalités et les préoccupations quotidiennes des populations.
Vers une convergence entre les finalités de l’islam et les droits de l’Homme
Les finalités de l’islam et les droits de l’Homme constituent des piliers fondamentaux pour l’élévation des valeurs humaines et la réalisation d’un développement durable. Malgré les différences de fondements et de référentiels, ces deux systèmes convergent dans la promotion des valeurs universelles telles que la justice, l’égalité et la dignité humaine.
Dès lors, il est essentiel de renforcer la sensibilisation aux droits de l’Homme, de promouvoir une culture de la citoyenneté et d’encourager l’ijtihad pour adapter les valeurs universelles et les législations aux réalités contemporaines, garantissant ainsi **une justice équitable et un développement durable pour tous.