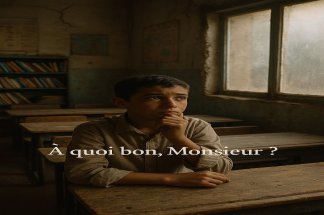National
GRÈVE GÉNÉRALE ET CLIMAT SOCIAL - Par Mustapha SEHIMI

Pourquoi une grève générale aujourd’hui ? Historiquement, c'est une décision qui marque un tournant: elle vise à jouer un rôle majeur dans l'obtention de droits sociaux. N'a-t-elle pas aussi une teneur politique ? Au Maroc, 1'historique des grèves générales ne manque pas d’intérêts
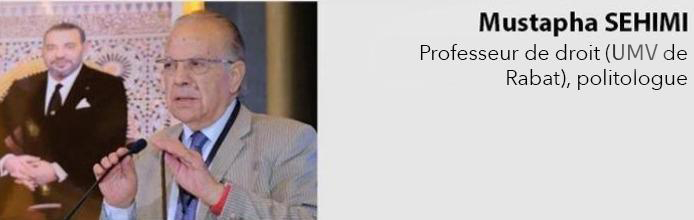
Ce début d'année se distingue par la question sociale. On vient de le voir avec la grève générale des 5-6 février courant. Les mois qui viennent vont être confrontés à cette situation. Les réformes annoncées, attendues et incontournables vont peser sur le déroulé de la vie politique nationale.
***
Première interrogation: cette grève générale a-t-elle réussi pour les cinq centrales syndicales qui ont pris cette décision ? Pour celles- ci, la réponse est positive, avec un taux de 80%, un "succès retentissant selon le communiqué de l'UMT. Ce débrayage a paralysé la majorité des secteurs (éducation, santé, ports, industries manufacturières et énergétique, transports, secteur bancaire et assurances, médias audiovisuels, etc.). Du côté du gouvernement, d'autres chiffres sont avancés: 32 % dans le secteur public et 1,4 % dans le privé, 36% dans l'éducation, 33% dans la santé, 30% dans la justice, et 26% dans l'administration et les collectivités locales. Tous ces chiffres sont sans doute à pondérer, tant ceux des syndicats que ceux de l'exécutif. Pour autant, il vaut de noter que par exemple dans la métropole économique du Royaume, l'appel à la grève a été massivement suivi.
Capacité de mobilisation
Cela dit, pourquoi une grève générale ? Historiquement, c'est une décision qui marque un tournant: elle vise à jouer un rôle majeur dans l'obtention de droits sociaux. N'a-t-elle pas aussi une teneur politique ? Au Maroc, 1'historique des grèves générales ne manque pas d'intérêt: juin 1981, mai 1984, décembre 1990, octobre 2014. Il faut aussi mentionner février 2011, sans mot d'ordre syndical, qui ne fut pas une grève, mais qui a pris de fait la dimension d'une vaste contestation sociale et nationale; enfin, la multiplication des grèves sectorielles - fonction publique (10 décembre 2015), syndicats d'enseignants (mars 2019) et de multiples mouvements sociaux (avocats, greffiers, médecins, etc.). Plusieurs observations peuvent être tirées de tous ces mouvements sociaux. Quelle est encore la capacité de mobilisation des syndicats alors que seuls 8 % des travailleurs sont encartés ? Ce chiffre doit cependant prendre en compte que les centrales- surtout 1’UMT - encadrent les secteurs vitaux de l'économie... Le champ de la contestation sociale est, par ailleurs, occupé de plus en plus par des acteurs associatifs - telles les coordinations optimisant de nouveaux leviers comme les réseaux sociaux...
Mais il y a plus. Ainsi, les syndicats comptent se remobiliser à propos de la réforme des caisses de retraite. Annoncé pour ce début 2025, ce chantier se heurte déjà aux propositions contenues dans la copie gouvernementale qui ne leur a pas été encore soumise : retraite à 65 ans, augmentation des cotisations des salariés et limitation de retraites à un plafond double du SMIG. Voilà bien un dossier complexe. Effervescent aussi. Il ne peut que mettre les centrales syndicales vent debout, en premier ligne de la contestation. Le gouvernement arrivera-t-il à finaliser la réforme qu’il veut au moindre coût financier et politique ? Le calendrier ne lui est pas tellement favorable dans la mesure où 2025 est une année préélectorale. Les partis d’opposition y trouveront - eux aussi - des éléments de contestation, s’ajoutant à d’autres tout également clivants relatifs à la réforme du Code de la famille, du Code pénal…
Quelles raisons ont conduit les syndicats à décider cette grève générale ? Ce qui est en cause regarde, en premier lieu, les conditions dans lesquelles le projet de loi organique a été adopté par la Chambre des conseillers, lesquelles sont jugées inappropriés. Sont mis en causes plusieurs faits : les « manœuvres » du ministre de 1'Emploi visant à faire part de l'approbation de ce texte par les syndicats ; la "majorité numérique" parlementaire du gouvernement dans les deux Chambres du Parlement conduisant à son adoption précipitée ; la mise en équation du dialogue social qui est pratiquement en panne, la réunion semestrielle de septembre dernier n'ayant pas eu lieu ; enfin le non respect des normes internationales. Référence est faite à cet égard aux conventions internationales de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles relatives à la négociation collective (N° 154) et aux consultations collectives (N°98). Il faut y ajouter des décisions contenues dans l'accord du 30 avril 2022 encore inappliquées : alignement du SMAG sur le SMIG, création de l'Observatoire national du dialogue social, rapport annuel sur le climat social, mise en place du Conseil de négociation collective (article 101 du Code du travail), de celui de la médecine du travail (art. 332) et de la Commission de suivi du travail temporaire.
Des avancées, mais…
Par ailleurs, l'on ne peut manquer de relever que le texte adopté aujourd'hui enregistre des avancées. Le préambule définit désormais la grève de manière large ; le droit de grève est reconnu à toutes les catégories socioprofessionnelles (secteur privé, fonctionnaires, travailleurs indépendants et non salariés, domestiques, etc.). Le personnel de certains secteurs, considérés comme vitaux, est astreint à un service minimum (transport, justice, sécurité, soins d'urgence...). D'autres acquis concernent les points suivants : la réduction des délais d'appel à 7 jours et de préavis à 5 jours ; les pénalités en hausse pour les employeurs et la suppression de la contrainte physique pour les grévistes.
Les syndicats ont voulu rebondir aujourd'hui. Ils invoquent en effet le vote du projet de loi organique sur la grève jugé "restrictif" et même "inconstitutionnel" pour relancer la contestation sociale en l'élargissant à des questions comme la détérioration du pouvoir d'achat des travailleurs, l'aggravation du chômage, l'aggravation de la pauvreté et 1'accentuation de la précarité sociale. La grève des 5-6 février se veut un "avertissement", ce qui signifie qu'elle peut se prolonger par d'autres actions d'envergure. Le climat social passablement délétère ; il est nourri par une conjoncture particulière liée dans quelques semaines par le renchérissement traditionnel des prix au cours du Ramadan. Le gouvernement met en exergue le projet d'"État social" et sa déclinaison dans des politiques d'amélioration des conditions de travail et de vie des citoyens. Il doit donner des gages supplémentaires d’application de ce programme. Le fera-t-il ? Sera-t-il audible ?