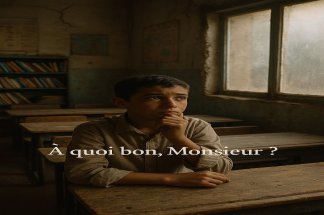National
Jbel Irhoud : quand le Maroc pensait déjà l’humanité – Par Adnan Debbarh

Des restes d'Homo sapiens qui ressemblent à l'homme d'aujourd'hui ont été mis au jour au Maroc.
Et si l’histoire du Maroc ne commençait pas avec l’Islam ou les Idrissides, mais bien avec l’aube de l’humanité ? La découverte de Jbel Irhoud bouleverse notre récit national : ici, il y a 320 000 ans, des Homo sapiens vivaient, pensaient, inventaient. Une trace originelle qui redonne au Maroc, écrit Adnan Debbarh, sa place oubliée dans la genèse du monde.

Avant le mythe, il y eut la poussière. Avant la mémoire, il y eut la trace.
Il est des lieux silencieux qui bouleversent les cartes. Des poussières oubliées qui déstabilisent les certitudes. Et parfois, au détour d’un plateau caillouteux du Maroc central, surgit une vérité profonde : notre histoire ne commence pas avec l’autre. Elle palpite avec l’humain.
En 2017, la publication des résultats des fouilles de Jbel Irhoud, près de Youssoufia, a déclenché un séisme discret mais décisif. Sous les strates de calcaire, des crânes fracturés par le temps racontent : ici, des Homo sapiens marchaient il y a 320 000 ans. Plus anciens que ceux d’Afrique de l’Est. Plus anciens que la mémoire que nous pensions nôtre.
Cette révélation ne se mesure pas en millénaires, mais en révolution cognitive. Elle oblige à réécrire notre rapport au temps, à l’espace, à nous-mêmes.
Ce que murmure Jbel Irhoud, ce n’est pas seulement que le Maroc était habité. C’est qu’il a habité l’humanité. Qu’il fut non pas un carrefour, mais un creuset. Une matrice où s’inventèrent, dès l’aube des âges, des rites funéraires, des outils de pierre chauffée, des stratégies de survie face au climat aride. Des gestes qui, cumulés, définissent ce que « être humain » veut dire.
Lire aussi : Repenser l'Histoire, refonder le récit national – Par Adnan Debbarh
Pendant des siècles, le récit historique — scolaire, politique, médiatique — a dépeint ce pays comme un réceptacle. Un vase recevant la religion de l’Orient, les lois de Rome, les techniques de l’Europe. Avant cela ? Un vide, peuplé de silences commodes. Cette vision téléologique, la science elle-même la pulvérise aujourd’hui.
Mais encore faut-il que le récit suive.
Il ne s’agit pas de forger un mythe de substitution. Plutôt d’oser une archéologie du possible : sur ces hautes steppes balayées par les vents, des hommes et des femmes pensaient. Ils polissaient le silex en formes asymétriques mais efficaces, enterraient leurs morts avec des offrandes — peut-être des fleurs aujourd’hui fossilisées —, observaient les cycles lunaires. Ils faisaient monde, simplement, obstinément.
C’est ici que les poètes rejoignent les géologues : l’appartenance naît moins d’un drapeau que de la persistance d’une trace. Une trace qui défie ce que Fernand Braudel nommait « la tyrannie des courtes durées ».
L’un des effets les plus subtils — et les plus pernicieux — du récit historique dominant est sa périodisation forcée : Préhistoire, Antiquité, Islam, Dynasties, Protectorat, Indépendance. Comme si tout ce qui précède les Idrissides était silence, un désert historique. Comme si le Maroc n’avait existé qu’à partir du moment où certaines populations sont venues l’habiter.
Or, ce que révèlent Jbel Irhoud, Oued Beht ou Kach Kouch, ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des jalons d’une continuité têtue. Des preuves d’ancienneté, certes, mais surtout des signaux d’autonomie.
L’histoire, doit-on le rappeler, est aussi une archéologie du savoir : il faut aller chercher dans les strates profondes les conditions de possibilité d’un récit libérateur.
Reconnaître que le Maroc est l’un des berceaux de l’humanité, ce n’est pas céder à une nouvelle mythologie. C’est, au contraire, se délier des anciennes : celles qui commencent toujours ailleurs, celles qui minorent notre sol, celles qui font du Maroc un simple objet de l’histoire mondiale et jamais un sujet.
C’est refuser d’être constamment produit par l’Autre.
Ce retour aux origines n’a de sens que s’il fertilise l’avenir. Il ne s’agit pas d’idéaliser le silex ou de sacraliser l’os. Il s’agit de retrouver une assise symbolique, un point d’ancrage, une dignité du sol. Il s’agit de retrouver une identité-enracinement qui permet de s’ouvrir sans se dissoudre.
Walter Benjamin l’a magnifiquement exprimé :
« Même les morts ne seront pas en sécurité si l’ennemi l’emporte. »
À nous de protéger nos morts de l’oubli. Et, à travers eux, de redevenir les auteurs de notre histoire.
Certes, ce n’est pas le Maroc qui commence avec l’humanité. C’est l’humanité qui, en partie, commence ici.
Cette simple inversion change tout. Elle ne réécrit pas le passé — elle le réanime. Elle offre à chaque Marocain un droit imprescriptible : celui d’habiter son histoire sans demander permission, des premières lueurs de Jbel Irhoud aux défis du XXIᵉ siècle.
Car le temps ne s’est pas arrêté au silex. Dans les profondeurs du Néolithique marocain, une autre mémoire travaille notre présent.