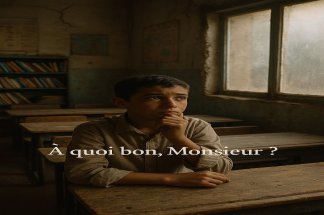National
Niveau de vie des Marocains : une enquête du HCP suggère que moins de deux ont suffi pour amorcer le rattrapage des dégâts du Covid19

Le HCP indique que la dépense annuelle moyenne par ménage est passée entre 2014 et 2022 de 76.317 dirhams (DH) à 83.713 DH à l’échelle nationale correspondant à 95.386 DH en milieu urbain et à 56.769 DH en milieu rural
Le niveau de vie des Marocains s’est globalement amélioré entre 2014 et 2022, avec une nette progression entre 2014 et 2019 et une décélération entre 2019 et 2022, une période marquée par la pandémie Covid-19, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
L’enquête qui semble avoir intégré dans ses données les répercussions de trois ans de la pandémie du Covid 19, suggère que les moins de deux ans qui nous séparent de la sortie de pandémie, ont suffi pour amorcer le rattrapage des dégâts causés par celle-ci au point de relever une amélioration. Pour rappel, la pandémie, sans s’arrêter sur les effets de la sécheresse, a eu pour conséquence une récession historique. En 2020, le PIB du Maroc a reculé de 7%, une contraction sans précédent en raison des restrictions sanitaires et du ralentissement de l’activité économique., cependant que le chômage en hausse a bondi à 12,3% en 2021 contre 9,2%* en 2019, avec des secteurs comme le tourisme, l’artisanat et le commerce pratiquement immobilisés. Ces facteurs ont induit une hausse de la pauvreté plongeant un million de Marocains dans la précarité, avec une augmentation notable du taux de pauvreté et de vulnérabilité, faisant dire au même HCP que le Covid19 a ramené la pauvreté au Maroc à son niveau de 2014.
Toujours est-il que l’actuelle enquête du HCP indique que la dépense annuelle moyenne par ménage est passée entre 2014 et 2022 de 76.317 dirhams (DH) à 83.713 DH à l’échelle nationale correspondant à 95.386 DH en milieu urbain et à 56.769 DH en milieu rural, précise le HCP dans une note sur les principaux résultats de l’enquête nationale sur le niveau de vie des ménages 2022-2023.
Ramenée à l’échelle individuelle, la dépense annuelle moyenne par personne est passée de 15.876 DH en 2014 à 20.658 DH en 2022, relève le HCP, notant qu’elle a progressé, aux prix constants, à un taux annuel moyen de 1,1% entre 2014 et 2022, passant de 3,1% entre 2014 et 2019 à -3,1% entre 2019 et 2022.
Consommation des ménages : plus de charges pour l’alimentation, moins de dépenses de loisirs
La part des dépenses alimentaires a augmenté de 37% en 2014 à 38,2% en 2022, alors que les dépenses d’habitation et d’énergie sont passées de 23% à 25,4%.
Pour les dépenses d’hygiène et de communication, elles sont passées respectivement de 2,7% à 3,9% et de 2,2% à 2,6%.
En revanche, les dépenses de soins de santé ont diminué de 6,1% à 5,9% et les dépenses de transport ont baissé de 7,1% à 5,8%.
Pour leur part, les dépenses d’équipements ménagers sont passées de 3,2% à 2,3% et les dépenses de loisirs et culture de 1,9% à 0,5%.
Les inégalités sociales se creusent avec une stabilité des inégalités territoriales entre 2014 et 2022
Le niveau de vie des 20% les moins aisés a annuellement progressé de 1,1% entre 2014 et 2022. Cette progression résulte d’une amélioration de 3,9% entre 2014 et 2019, et d’une baisse du niveau de vie de -4,6% entre 2019 et 2022.
Pour les 20% les plus aisés, le niveau de vie a annuellement progressé de 1,4% entre 2014 et 2022, une amélioration marquée de 2,8% entre 2014 et 2019, mais avec une régression de -1,7% entre 2019 et 2022.
Quant à la catégorie sociale intermédiaire, son niveau de vie a progressé de 0,8% entre 2014 et 2022, avec une progression de 3,3% entre 2014 et 2019 et une régression de -4,3% entre 2019 et 2022.
Les couches les plus pauvres et les plus riches ont vu globalement leur niveau de vie progresser alors que la classe moyenne n’a pas pu autant bénéficier ni des fruits de la croissance ni des politiques de redistribution.
Dans ce contexte, les inégalités du niveau de vie, mesurées par l’indice de Gini, se sont creusées entre 2014 et 2022, passant de 39,5% à 40,5%, après avoir enregistré une diminution à 38,5% en 2019.
Par ailleurs, les disparités entre les milieux urbain et rural, mesurées par le rapport entre le niveau de vie moyen des citadins et celui des ruraux, sont restées stables à 1,9 fois entre 2014 et 2022, après avoir été réduit à 1,8 fois en 2019.
D’après le HCP, les politiques de filets sociaux ont un impact tangible sur la réduction de la pauvreté, mais la vulnérabilité des couches sociales non ciblées par ces politiques, augmente.
Ainsi, la part des ménages avec un risque de déclassement vers la pauvreté s’élargit, et, pour la première fois, concerne autant les milieux urbains que ruraux.
Et d’estimer que l’inflexion dans la trajectoire d’amélioration des différents indicateurs à partir de 2019 jusqu’en 2022, une période marquée par la pandémie Covid-19, nécessite une nouvelle évaluation du niveau de vie des ménages afin de distinguer ce qui relève du structurel et ce qui relève du conjoncturel.
Principaux résultats de l’enquête nationale sur le niveau de vie des ménages 2022-2023
Selon l’enquête de structure, qui fait suite à une enquête similaire en 2014 et une enquête partielle en 2019, fournirait, selon le HCP, une vision actualisée des dynamiques socio-économiques qui caractérisent la société marocaine.
Ainsi, si les inégalités sociales se creusent avec une stabilité des inégalités territoriales entre 2014 et 2022, le taux de pauvreté absolue aurait globalement reculé entre 2014 et 2022, passant de 4,8% à 3,9% après avoir atteint, avant la pandémie, un taux de 1,7% en 2019. La vulnérabilité à la pauvreté n’aurait connu qu’une légère hausse de 12,5% à 12,9% entre 2014 et 2022 après avoir atteint 7,3% en 2019., tandis que la pauvreté multidimensionnelle aurait considérablement diminué, passant de 9,1% en 2014 à 5,7% en 2022, surtout en milieu rural, où le taux est passé de 19,4% à 11,2%, tandis qu’en milieu urbain, il est passé de 2,2% à 2,6%.
Des changements significatifs dans la consommation des ménages ont été relevés, avec plus de charges pour l’alimentation et moins de dépenses de loisirs.
Les revenus salariaux représentent la principale source de revenu pour les ménages, contribuant à hauteur de 35,1% du revenu total. Cette proportion est de 36,4% en milieu urbain et de 29,5% en milieu rural.