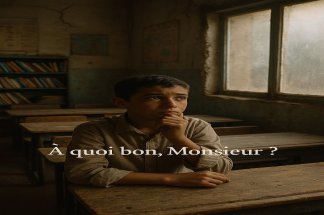National
Six mois seulement nous séparent-ils de la clôture définitive du conflit du Sahara ? – Par Abdelhamid Jmahri

L’optimisme de Omar Hilale (photo), est-ce celui d’un responsable patriotique qui regarde avec satisfaction les avancées sur le terrain, en particulier sur le plan international, en faveur du Sahara ? Ou est-ce la déclaration d’un ambassadeur en poste à Washington qui surestime la capacité des États-Unis à résoudre les problématiques internationales ?
À six mois d'une échéance onusienne cruciale, le Maroc multiplie les signaux d’un dénouement imminent dans le dossier du Sahara. Alors que les États-Unis renforcent leur engagement en faveur de l’autonomie et que l’Algérie s’enferme dans une posture défensive, une dynamique géopolitique inédite pourrait faire basculer ce conflit vieux d’un demi-siècle. Entre effondrement du narratif séparatiste et redéfinition des enjeux sécuritaires, le conflit, pour Abdelhamid Jmahri pourrait bien changer de nature aux yeux de la communauté internationale.
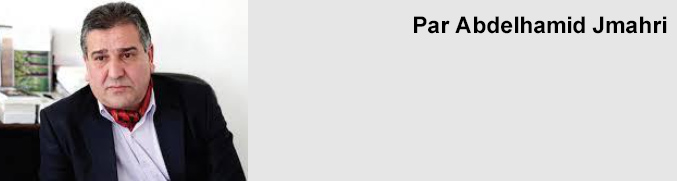
Le représentant du Maroc aux Nations Unies, Omar Hilale, a fixé un horizon proche pour la fin du dossier du conflit artificiel. Il a relevé le niveau d’optimisme quant à une issue imminente à un dossier qui s’éternise depuis un demi-siècle, en évoquant une résolution proche du conflit. Il a exprimé le souhait que l’anniversaire de la Marche Verte, en novembre prochain, soit le moment du grand soulagement national. Cette date coïncide d’ailleurs avec la session d’octobre au cours de laquelle le Conseil de sécurité traitera le dossier en adoptant des résolutions contraignantes.
Une échéance diplomatique déterminante : novembre 2025
Ce que l’on comprend de Omar Hilale — connu pour sa modération, sa retenue et son éloignement de toute rhétorique triomphaliste —, c’est que lors de la prochaine réunion, le Conseil de sécurité aura mis un point final au dossier du conflit régional avec l’Algérie.
On peut en conclure, sans crainte d’exagération ni de spéculation, qu’il ne nous reste actuellement que six mois avant la clôture de ce dossier… au niveau des Nations Unies.
Est-ce l’optimisme d’un responsable patriotique qui regarde avec satisfaction les avancées sur le terrain, en particulier sur le plan international, en faveur du Sahara ? Ou est-ce la déclaration d’un ambassadeur en poste à Washington qui surestime la capacité des États-Unis à résoudre les problématiques internationales ? Et comment cela serait-il possible au sein du Conseil de sécurité, compte tenu de l’équilibre des forces qui y règne ?
Ces questions, et bien d'autres, s'imposent d'elles-mêmes — non par doute, loin de là, mais plutôt par ce besoin légitime de dire : « Oui, mais pour que mon cœur soit rassuré ! »
L’activisme américain : un tournant structurel
Cet optimisme, exprimé en des termes clairs et affirmatifs, repose essentiellement sur la volonté déclarée des États-Unis de clore définitivement le dossier.
La principale preuve en est le contenu de ce qui a été communiqué à M. De Mistura, l’envoyé onusien chargé de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que du recueil et de la transmission des positions exprimées par les parties, qu’elles soient confidentielles ou publiques, au sein de l’appareil exécutif des Nations Unies.
L’élément le plus marquant réside dans l’engagement des États-Unis à relancer la dynamique politique et à s’impliquer activement dans l’incitation des parties — ici, principalement l’Algérie et le Maroc — à parvenir à une solution d’autonomie, autour de laquelle un large soutien international s’est élaboré.
Dans ce cadre, les États-Unis, en tant que penholder (rédacteur des résolutions), tout comme la France ou le Royaume-Uni sur d’autres dossiers que celui du Sahara, disposent des leviers nécessaires pour jouer ce rôle :
– La rédaction des résolutions concernant le Sahara. À notre sens, un pays comme les États-Unis ne peut rédiger, négocier, puis présenter au vote des textes qui seraient en contradiction avec ses propres convictions.
C’est pourquoi les États-Unis ne proposeront pas à la communauté internationale une lecture du droit international qui reviendrait, par exemple, à l’époque du référendum !
– L’adoption d’initiatives, conformément aux usages en vigueur au sein du Conseil de sécurité et de l’ONU, pour les dossiers qu’ils pilotent — ici, en l’occurrence, la question du Sahara. Cela inclut la convocation des parties concernées à des tables rondes. Il est peu probable, dans ce cas, qu’un pays comme l’Algérie refuse une invitation émanant des États-Unis…
– Le penholder est celui qui conduit les négociations en vue de l’adoption des résolutions, un élément central dans l’engagement américain — ce qui est précisément ce qui nous concerne ici dans la position américaine.
+ Le penholder peut également prendre des initiatives concernant les activités du Conseil de sécurité en lien avec le dossier à l’étude, telles que des réunions ultérieures, des débats qu’il juge opportuns, ou la définition de missions spécifiques pour certaines délégations ou missions spéciales… au-delà de celles déjà en place !
Voilà donc les moyens institutionnels à la croisée entre l’usage onusien et la capacité politique dans la gestion du dossier.
Concernant ce qui est « hors-texte », de nombreux éléments ne peuvent être ignorés dans l’analyse de la situation actuelle :
Le premier est que Washington traite de nombreux dossiers et peut aussi bien accélérer la marche vers une solution qu’y mettre des obstacles. Elle dispose de nombreux leviers de pression à cet effet.
– Washington a également entamé de nombreuses négociations, même en dehors du cadre du Conseil de sécurité dans les cas où cela s’est avéré difficile (Ukraine, Moyen-Orient…).
De plus, nous bénéficions actuellement d’une conjoncture extrêmement favorable marquée par une convergence de vues entre la France et les États-Unis sur le dossier, ainsi que sur une action conjointe entre les deux pays en faveur de l’autonomie, envisagée comme un engagement franco-américain commun à défendre la souveraineté du Maroc et à œuvrer activement à cette solution tant sur le plan national qu’international.
Une stratégie algérienne en perte de vitesse
Enfin, quelle est la situation des « autres parties » ? Toutes les politiques menées par les voisins pour entraver une solution politique ont échoué, tant sur le plan militaire sur le terrain que sur le plan politique à l’échelle internationale.
La première erreur a été de considérer que la déclaration de retrait de l'accord de cessez-le-feu, signé entre les séparatistes et les Nations Unies, pouvait représenter un levier de pression ou de persuasion pour faire croire que la paix était en danger et que la guerre était sur le point de reprendre… etc. Mais rien de tout cela ne s’est produit, en dépit des nombreuses attaques contre le Maroc. On peut même interpréter les rapports de la MINURSO comme ayant retiré cette carte des mains de ceux qui la brandissaient, en reconnaissant que le conflit est à basse intensité et que la partie marocaine contrôle le terrain, tandis que ce qui reste aux autres parties n’est qu’un brandissement hypothétique de la menace de guerre.
Cette menace a été revêtue d’un habillage politique, fondé sur les propos introductifs de De Mistura évoquant « l’absence de tout canal diplomatique de communication », « la persistance de la fermeture des frontières » et « l’escalade de la course à l’armement entre les deux pays », le Maroc et l’Algérie.
Sur le plan politique direct, on trouve la tentative de l’Algérie de se soustraire aux tables rondes, en prétendant qu’elle n’est pas concernée, alors qu’elle était la façade politique de toute l’opération du côté des autres parties. Ce que les attaques à distance n’ont pas réussi à obtenir, la diplomatie du gel ou de l’aggravation des tensions n’a pas non plus réussi à le rtéaliser, en essayant de vider les résolutions du Conseil de sécurité de leur contenu pacifique.
L’objectif était, bien entendu, de bloquer le processus politique en contrepartie du gain marocain obtenu par l’abandon du référendum, afin de négocier un retour à la situation antérieure à la proposition d’autonomie.
Mais les parties concernées ont échoué dans cette tentative. Pire encore, elles se sont retrouvées en contradiction avec la communauté internationale en se plaçant en dehors de la dynamique de recherche de solution et de promotion de la stabilité.
Un environnement géopolitique favorable au Maroc
Le plus grave encore, c’est l’élargissement du cercle de tension à l’ensemble de la région : au nord, l’Espagne et la France ; à l’ouest, le Maroc ; au sud, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad ; à l’est, la Libye… En parallèle, on assiste à des tentatives de construction d’axes d’influence pour semer le trouble dans la région, sans oublier les signes de rapprochement affichés avec l’Iran.
Sur le plan macro-géo-politique, le Maroc tire parti de la diminution de la polarisation aiguë autour de la question du Sahara, qui avait marqué les phases précédentes entre deux pôles idéologiques. Actuellement, la Chine, par exemple, approuve les résolutions du Conseil de sécurité soutenant les processus diplomatiques favorables au Maroc. Le Royaume bénéficie aussi de l’opinion publique internationale qui s’est consolidée en faveur de l’autonomie, ainsi que de la révélation de vérités dramatiques concernant l’intersection entre terrorisme et séparatisme à Tindouf, les alliances entre Téhéran et l’Algérie, et les efforts américains, au sein même du Congrès, pour classer le Polisario comme une organisation pratiquant des actes terroristes et entretenant des liens suspects à l’international…
Ainsi, l’idée d’un « peuple sahraoui » s’est effondrée, laissant place à celle d’une organisation terroriste ! C’est là un tournant supplémentaire dans l’évolution du dossier, le faisant passer d’un conflit territorial à une affaire de lutte contre le terrorisme.