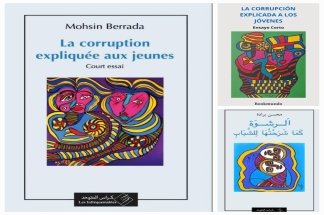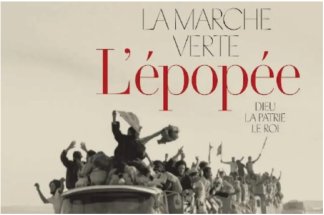chroniques
LE POUVOIR DES SYNDICATS : RÉALITÉ OU MYTHE ? – Par Gabriel Banon

Au Maroc, si aucune centrale syndicale de peut s’absoudre de politique, Noubir Amaoui et sa CDT, longtemps bras séculier de l’USFP de Abderrahim Bouabid, a fait du syndicalisme l’arme politique absolue.
Qu’est-ce qui explique la puissance ou la nuisance des syndicats, au Maroc et ailleurs ?
En France, une poignée de cheminots ont arbitrairement pris des centaines de milliers de Français en otages, lors des départs en vacances des fêtes de fin d’année. A tort ou à raison, cet épisode difficile a été considéré comme un scandale aux yeux de la majorité des français.
Au Maroc, comme en France, leur puissance apparente, interdit-t-elle de dénoncer leur nuisance ou leurs abus ? La question est de savoir si ce pouvoir est considérable, détenu par une minorité de personnes sur l’ensemble de la population laborieuse ou simplement citoyenne.
Dans les sciences sociales, d’éminents intellectuels, dont plusieurs prix Nobel, se l’étaient posée, aux États Unis, en Angleterre et dans les pays scandinaves, où le syndicalisme occupe une place plus importante encore qu’au Maroc.
Le syndicalisme est institutionnalisé dans le système démocratique des pays libres, aussi on associe syndicalisme et liberté. Il parait impossible de remettre en cause cette avancée sociale et libérale.
Par contre, on peut et on doit se poser les questions suivantes :
- Pourquoi des syndicats sont nécessaires ?
- Doit-on parler de Droit du travail ou droit au travail ?
-Les syndicats ont-ils une influence sur le chômage, les crises ?
-Apportent-ils quelque chose à la démocratie ?
- Syndicalisme et liberté sont-ils compatibles ?
Le syndicalisme tient aussi bien de l’idéologie que de l’économie. Il a vu son prestige grandir en critiquant le capitalisme et en développant le postulat : le travail échappe à la loi du marché. (Vraiment ?).
Marx et sa lutte des classes ont posé la première pierre de ce que sera plus tard le syndicalisme. D’un côté le propriétaire exploiteur et de l’autre le prolétaire exploité, le syndicalisme se veut être la réponse à cette injustice. Le déséquilibre semble inéluctable : l’un des contractants a le temps et l’argent pour lui, l’autre doit accepter les conditions qui lui sont offertes. C’est un déséquilibre entre offre et demande, la loi du marché est inapplicable car le salaire n’est pas un prix et le travail n’est pas une marchandise.
Ces idées sont devenues courantes, même si elles n’ont aucune consistance réelle : Le travail n’est pas le seul facteur de production et il n’y a pas seulement le capital, mais aussi et surtout l’art d’entreprendre.
Le « capital humain » a une importance considérable dans la rémunération perçue. Cette importance varie avec la formation, l’âge, l’expérience, la qualification.
Il ne saurait y avoir de salaire unique, il irait à l’encontre de l’émulation et le progrès, et rendrait l’effort inutile.
Le syndicalisme se veut être la réponse à cette « injustice » et représenter la défense du faible contre le fort. Il faut reconnaître que cela est parfois vrai, particulièrement dans les pays en voie de développement.
Le contrat individuel étant, par essence, asymétrique, lui sera substitué le contrat collectif. Ainsi va naître un « droit du travail » qui échappe à la logique contractuelle qui met habituellement en relation deux individus égaux. C’est ainsi, que le syndicat est devenu alors « partenaire social », il va détenir progressivement le monopole de la négociation salariale, spécialement dans les grandes entreprises.
Ce droit du travail collectiviste explique, dans beaucoup de pays, la démarche syndicale fondée sur le cartel de l’embauche, particulièrement aux États-Unis.
Le syndicat cherche à détenir le monopole de la représentation salariale, une aberration dans les PME et les petites unités familiales. Dans les grandes entreprises, il a pour « partenaire » les instances patronales.
Le paradoxe dans la vie des syndicats est que le nombre d’adhérents importe peu, et son pouvoir de nuisance n’y est pas proportionnel. En France par exemple, le taux de syndicalisation est très faible mais la majorité est la plupart du temps acquise au syndicat quand il décrète la grève. Elle est suivie largement par le personnel, syndiqué ou non. Ce paradoxe est commun à plusieurs pays.
Dans certains, particulièrement aux États-Unis, les salariés sont prêts à payer des cotisations syndicales élevées pour bénéficier d’un salaires minimum payé par le syndicat lors des jours de grève. Dans certains pays comme la France, le financement des syndicats provient de sources gouvernementales et patronales, mais dans la plus grande discrétion.
Le droit du travail supprime le droit au travail (conçu comme la possibilité d’accéder à un emploi) : dans des pays comme les États-Unis ou l’Allemagne, celui qui n’est pas représenté syndicalement a peu de chance d’être embauché.
Les syndicats défendent leur action en prétendant œuvrer pour le plein emploi et pour la stabilité économique. Force est de constater que le chômage a diminué dans les pays où le pouvoir des syndicats a été combattu et amoindri. Les politiques de Thatcher au Royaume-Uni lors de la grève des mineurs et Reagan aux États-Unis lors de celle des contrôleurs aériens, ont assuré durablement le plein emploi mais elles ont été abandonnées ensuite pour des raisons politiques.
Alors, les syndicats apportent-ils quelque chose à la démocratie ?
C’est finalement la vraie question. La réponse est donnée par l’étude des « décisions publiques » (public choice) : la classe politique a pour objectif majeur et permanent : le calendrier électoral. Or, les syndicats sont des alliés très efficaces dans le jeu électoral. Ils ont une influence sur le climat politique par leurs initiatives : manifestations, grèves, couvertures médiatiques. Leur action contribue à influencer ceux qui vont penser que tout va à peu près bien (pouvoir d’achat maintenu, moins de chômage) ou que tout va très mal (inflation, désordre).
On peut réellement se demander ce que devient la démocratie quand le pouvoir est attribué à des candidats qui ne représentent qu’une infirme partie de l’électorat. On peut même s’interroger, comme le faisait Benjamin Constant, écrivain et homme politique, sur l’erreur fondamentale qui consiste à voir la démocratie comme la loi de la majorité, « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » de Lincoln, au lieu de la tenir pour la protection de la minorité allant jusqu’à l’individu. Constant opposait ainsi la « démocratie des anciens » (Athènes) et la démocratie des modernes (États-Unis de 1777).
Il faut garder en tête qu’aucune entreprise ne ressemble à une autre. Par exemple la pratique de la participation voire même de la cogestion (la mitbestimmung allemande) varie considérablement suivant la taille, l’activité, etc. Dans ces conditions, une loi pour l’organiser comme l’a fait en France, le premier ministre de l’époque, Michel Debré, n’a aucun sens. On a eu là, une volonté politique de centraliser, uniformiser, au prétexte de progrès social. Mais le progrès social doit respecter la liberté d’entreprendre et d’échanger.
Les responsables syndicaux se doivent de connaître l’économie. Les grandes centrales ont maintenant leur propre école de formation pour leurs cadres, comme par exemple la centrale marocaine, l’UMT (Union Marocaine du Travail)
Les syndicalistes très engagés sont capables de faire la distinction entre économie et politique. C’est une attente dans plusieurs pays. En fait, le principe libéral de base doit rester le respect de la diversité et donner de l’importance à l’épanouissement des capacités personnelles et le respect des autres.
Oui, un syndicalisme libéral est possible !