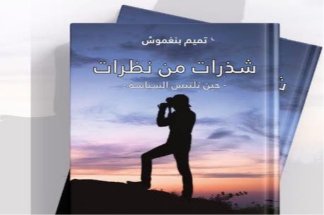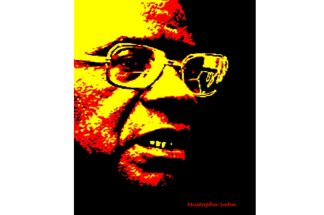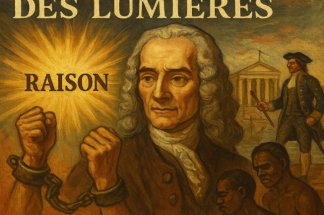Culture
L'ailleurs de nos peintres de Abdejlil Lahjomri : une histoire de peinture

Expression bleue de Jilali Gharbaoui, huile sur toile de jute, 1960
L’Ailleurs de nos peintres. Cette nouvelle série de chroniques de Abdejlil Lahjomri dédiées à la peinture marocaine aurait pu s’intituler Esquisse d’une histoire de la peinture marocaine. Mais le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume a tenu à l’inscrire ailleurs. Dans le mouvement collectif de la peinture marocaine et dans l’individualité de chaque peintre et de son « Ailleurs », au sens de l’une des significations que lui donne Baudelaire. Un ailleurs rêvé pour exprimer la distance que le poète ou l'artiste creuse entre soi et soi, une distance suffisante pour lui permettre de se supporter lui - même. C'est un cheminement dans la création poétique, ici plastique ou picturale. Et c’est dans l’Essai de Jean-Paul Sartre sur Baudelaire que Abdejlil Lahjomri picore la définition idoine de L’Ailleurs de nos peintres. « Pour Baudelaire dont le spleen réclame toujours un ‘'ailleurs'’, écrit l’existentialiste Sartre, la signification d’une chose est le symbole même de l’insatisfaction...et l’effort de Baudelaire est de s'emparer de lui-même...réaliser son Altérite en s’identifiant au monde tout entier ». Ce fait d’être un autre n’escamote pas l’identité, mais lui permet de se concrétiser en se transposant en une multitude de signes dans la création d’un peintre. Et c’est à sa quête que part Abdejlil Lahjomri dans ses chroniques pour comprendre et faire comprendre une peinture dont l’histoire est encore en développement dans une effervescence artistique en perpétuel renouvellement.
Comment est née et s’est développée la peinture au Maroc ? Qui en sont les pionniers ? Quelles étaient leurs formations ? Y a-t-il eu des écoles ? (dans le sens ici de courants). Comment expliquer la vitalité de la création picturale au Maroc depuis 1956 et la première exposition collective à la galerie « La Mamounia », au siège du ministère de la culture de l’époque, qui avait réuni quelques peintres comme Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia et Mohammed Ben Allal ? Peut-on aux lendemains de l’indépendance parler de transmission ou sont-ce des ruptures successives qui ont donné naissance à ces surgissements de couleurs et de lumière que les collections réunies proposent à l’émerveillement d’un public curieux, et ébloui ?
Autant d’interrogations légitimes de lecteurs, dilettantes de peinture ou collectionneurs patentés, ne peuvent trouver de réponses, sans prétendre à l’exhaustivité, que si l’on prend chaque peintre, son parcours et son apport indépendamment des autres, mais aussi en interaction avec les autres, pour aboutir à une esquisse documentée et commentée de l’histoire de la peinture au Maroc. Une histoire d’une grande intensité qui, dans la diversité d’une mémoire esthétique foisonnante, révèle l’unité d’un itinéraire, d’un engagement, d’une permanente volonté de ces créateurs de participer non seulement à l’affirmation d’une identité culturelle mais aussi d’être des acteurs reconnus sur la scène internationale. Et c’est cette réussite là que cette série de chroniques espère donner à voir : des tableaux et des peintres dont la plupart de ces peintres enrichissent les cimaises des plus grands musées du monde.
Maintenant que la question identitaire s’est assagie, on ne peut ignorer l’existence d’une transmission et si, très vite, de jeunes peintres se sont révoltés contre ce qu’ils ont qualifié de « peinture exotique », nous savons que cette transmission s’est opérée essentiellement dans la Tanger cosmopolite du début du siècle précédent. Mohammed Ben Ali R’bati s’y révèle « le premier peintre marocain à oser la peinture comme mode d’expression plastique spécifique » et qui en 1936 ouvrit une galerie qu’il anima lui-même jusqu’à son décès. Des peintres étrangers résidant au Maroc, comme Jacques Majorelle, Jean Azema, ou Mariano Bertucci, pour ne citer que ceux-là, avaient œuvré à l’apparition d’une peinture de chevalet et encouragé des peintres comme Mohammed Ben Allal, Abdellah Ouazzani, Ahmed Drissi, My Ahmed Yacoubi (propulsé par Paul Bowles, voire par Francis Bacon). On ne peut ignorer non plus que les peintres à qui nous devons l’émergence d’une peinture marocaine se sont formés à l’étranger ; Mohammed Serghini et Meriem Meziane, vers les années quarante, Hassan El Glaoui, Farid Belkahia, Jilali Gharbaoui, Mohamed Melihi, vers les années cinquante et bien d’autres qu’il serait fastidieux de contenir dans une série de chroniques, quand il faudrait leur consacrer une étude détaillée dans « Une histoire raisonnée de la peinture au Maroc ».
Quand Farid Belkahia, jeune directeur de l’école de Casablanca avec Mohamed Melihi et Mohamed Chebaa constituèrent un groupe sous le nom de « Formes et Couleurs » et nièrent en quelque sorte l’existence de cette transmission, ils contestaient en réalité un type conventionnel d’enseignement que diffusaient cette école et celle de Tétouan. Elles privilégiaient le sujet et la représentation, non la forme, non la couleur, quand c’est d’abstraction qu’il s’agissait pour cette génération d’artistes et surtout de modernité. Le manifeste qu’ils publièrent pour justifier l’exposition qu’ils organisèrent sur la place Jamaa El Fna était bien un manifeste d’exigence de modernité qui éloignait la créativité picturale de la peinture figurative, pour libérer l’imaginaire et faire de la lumière, des couleurs et des formes la thématique essentielle de leurs œuvres.
On peut, par une approche didactique, comme le critique André Goldenberg le fait dans son article : « Trente années de peinture marocaine », déceler trois axes qui caractériseraient la peinture marocaine depuis les expositions des premières années de l’indépendance : une tendance favorisant la peinture figurative, une seconde tendance, la peinture non figurative, et une troisième qualifiée rapidement, artificiellement et avec un peu de mépris de « peinture naïve ».
Toutefois si la dominante est l’abstraction, la tendance figurative traverse malgré tout l’ensemble des œuvres, de la première génération, avec quelques surgissements qui n’étonneraient personne au cours de ce long parcours d’une soixantaine d’années de ruptures créatives.
Il semblerait que ce qui, sans conteste, caractériserait la peinture marocaine dans une étonnante permanence, ce serait la forte personnalité de l’artiste, son charisme, sa volonté de recherche, son exigence de renouvellement, érigée en un crédo presque mystique. D’expérience inédite en percée originale, il propose de nouveaux matériaux, un nouveau questionnement, de nouvelles pistes, fragmentant les couleurs, la lumière et les signes. On aurait cru que dans ce riche champ d’expérimentation ouvert à toute fulgurante initiative, l’artiste dans son « atelier-isoloir », représenterait à lui tout seul un courant, une échappée individuelle, séduisante mais solitaire.
C’est l’approche thématique qui serait la mieux appropriée pour guider le visiteur dans le cheminement choisi par cette exposition. Je l’emprunte à Farid Zahi, fin connaisseur de la peinture marocaine et qu’il a utilisée avec bonheur dans sa présentation du catalogue de la collection de l’Académie du Royaume du Maroc intitulé « Une Collection émergente ». (Celle-là, les collections du ministère de la culture, et de la Fondation des Musées avec quelques œuvres prêtées par des collectionneurs privés constituent l’essentiel de ce parcours). Farid Zahi réunit M’Hammed Belhaj, Sâad Ben Cheffaj, Ahmed Ben Yessef, Ahmed Cherkaoui, Hassan El Glaoui, Said Qodaid, Abdellah Sadouk, Mohamed Tayert, Fatma Benkirane, Mohamed Fkih Regragui, Hassan Boukhari, Mohamed Khzoum, Mahjoub Houmaine dans un univers qu’il nomme « L’appel du visible », où le réalisme figuratif est stylisé, symbolisé, nuancé, minimaliste. Il y a dans ces œuvres, écrit-il, comme « une attraction pour la mémoire ... révélatrice d’un attachement inébranlable à l’émerveillement instantané face à ce qui risque de disparaitre ». Et qui en fait, semble-t-il, a disparu.
Mohamed Abouelouakar, Mohamed Drissi, Fatima Hassan, Mahjoubi Aherdan, ceux-là mettent en exergue la nature des éléments et la portée insondable des sens, et naviguent, affirme-t-il, dans un univers « où le sens de l’être est caché ».
Comme c’est « la magie du signe » qui jaillit de celui de Ahmed Azouz, Farid Belkahia, Mustapha Boujemaoui, Abdelkébir Rabi’, Mohamed Nabili, Issa Ikken, et « la gestualité » qui anime les œuvres de Bouchaib Habbouli, Hassan Megara, Mohamed Kacimi, Najeb Zoubir.
Y-a-t-il une « architecture du sens », comme il l’affirme dans l’univers de Aziz Abou Ali, de Rédouane Dellouli, Mohamed Khallouf , Mohamed Melihi, ou Abdelhay Mellakh ? Ou bien, parce que Brahim Hanine, et Mehdi Qotbi, s’étant aventurés dans une exploration du signe, des signes, dans les subtilités de la calligraphie, la lettre s’était-elle envolée (il qualifie leur univers de l’univers de « la lettre envolée »). Cette évaporation épure-t-elle ce qu’on qualifierait d’appel de la trace, une trace mémorielle, nostalgique, mythique, au point que l’œuvre ainsi produite reste, fascinante mais n’en demeure pas moins muette, comme absente. Ces traces « nous font signe, dit un critique, dans le silence ».
A la fin de ce voyage plastique à travers ces chroniques, dont le but, même s’il n’est pas avoué, est d'être une défense et illustration de la peinture marocaine, le lecteur ne peut échapper aux interrogations légitimes qui s’imposent à lui devant cette louable initiative de combler les lacunes sur le plan historique, et de donner enfin à voir avec la pluralité des œuvres présentées, une fulgurante rétrospective d’une période d’une soixantaine années de création, de recherche, d’expérimentation, d’innovations, d’intuitions fertiles, d’intenses ruptures esthétiques, d’éblouissantes initiatives qui parfois s’épuisaient dans des conflits stériles et improductifs.
Il lui semblerait raisonnable et justifié de se demander pourquoi « il est difficile de parler d’école », comme vient de l’affirmer Fouad Bellamine dans l’entretien récent, fort instructif, qu’il a accordé récemment à Latifa Serghini et où il assène, péremptoire, « il y a des peintres marocains, non une peinture marocaine ». « Il n’y pas de courant artistique ayant fait école ».
Pas de courants, donc, qu’est-ce à dire, alors ? , pas d’écoles au sens de « fauvisme », « dadaïsme », « impressionnisme » pour ne citer que ceux-là.
Pourquoi ?
Une autre interrogation va impérativement surgir qui ne trouvera probablement pas de réponse : l’abstraction dominante dans cette prodigieuse production picturale est-elle uniquement produit de la révolte contre « l’exotisme », le conservatisme, le conventionnel, hérités des artistes « coloniaux » ou de leurs imitateurs autochtones ? Ou est-elle produit de la formation « toute occidentale » des peintres marocains dans leurs pérégrinations esthétiques ou encore simplement produit d’un aniconisme qui en religion interdisait toute figuration humaine, interdiction qui en fait n’est ni impérative, ni décisive, ni absolue ?
Il applaudira enfin, la peinture dite « naïve », mais s’interrogera sur son déclin, sur la stagnation de cette spontanéité comme si cette veine commençait à tarir et ne pouvait fournir aux galeristes matière à exposer.
Il se posera des questions, sur l’après de cette « exposition – pause », en se demandant comment se révèlera demain le bouillonnement artistique d’aujourd’hui, qui avance résolument vers une modernité encore plus exigeante que celle des aînés. Comment l’ambiance effervescente actuelle que brouillent en de magnifiques fulgurances les débats des jeunes artistes en herbe insufflera- t- elle une vibrante vitalité à la culture nationale (en littérature, en peinture, en musique) qui ambitionne de conquérir une place lumineuse dans les ciels de l’universalité artistique ?
Dans la prochaine chronique : Amine DEMNATI, peintre et martyr



4.jpg)