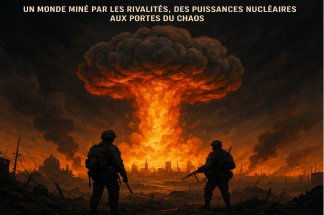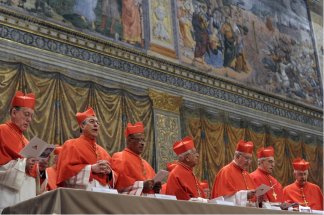International
El Conquistador et la Guerre Commerciale 1/3 Par Samir Belahsen

En règle générale, les conflits commerciaux entraînent des réactions en chaîne, où les États cherchent à défendre leur économie en mettant en place des mesures de représailles
À l’intersection de l’économie et de la géopolitique, les conflits commerciaux sont le reflet d’intérêts nationaux divergents, exacerbés par le protectionnisme, la mondialisation et les rivalités historiques. De la loi Smoot-Hawley à la menace japonaise, jusqu’aux tensions actuelles avec la Chine, ces affrontements dépassent l’économie, rappelle Samir Belahsen, pour redessiner les équilibres de pouvoir à l’échelle mondiale.

Première partie : le contexte de la guerre commerciale
"La guerre économique s'est traduite en conquêtes de parts de marché qui ne concernent plus seulement les matières et les territoires à conquérir, mais les esprits à soumettre. La soumission des esprits par la propagande publicitaire est l'objectif de la guerre de l'information à l'échelle mondiale."
Jean-Claude Besson-Girard - Decrescendo cantabile, 2005
"On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse."
Georges Clemenceau
Au carrefour de l'économie mondiale et des relations internationales, les conflits économiques se manifestent lorsque les États défendent leurs intérêts nationaux en recourant à des mesures telles que des droits de douane, des quotas ou des restrictions sur les importations.
Les affrontements ont pour origine des désaccords initiaux concernant des pratiques commerciales perçues comme déloyales, telles que le dumping, le soutien excessif ou injustifié aux industries locales, ainsi que la manipulation des devises.
En règle générale, les conflits commerciaux entraînent des réactions en chaîne, où les États cherchent à défendre leur économie en mettant en place des mesures de représailles punitives. Cela peut déclencher un cycle de représailles qui risque de compromettre la stabilité économique mondiale.
Les répercussions potentielles des conflits commerciaux sont diverses et peuvent se manifester à différents échelons. Au niveau local, ces pratiques peuvent impacter négativement les consommateurs en entraînant une hausse des prix et une diminution de la disponibilité des produits. Au niveau macroéconomique, ces fluctuations peuvent impacter la croissance économique, entraîner des suppressions d'emplois dans des domaines spécifiques et perturber les marchés financiers en conséquence. Ces conflits ne se restreignent pas à leurs conséquences économiques ; ils peuvent entraîner des répercussions géopolitiques, impactant les alliances historiques et modifiant les dynamiques du pouvoir à l'échelle mondiale.
Chaque litige commercial engendre des conséquences spécifiques, souvent liées entre elles, nécessitant une approche analytique pour en comprendre pleinement l'ampleur.
Les conflits commerciaux mettent en lumière les tensions profondes au sein de la coopération mondiale et posent la question de la durabilité des systèmes du libre-échange.
Un peu d’histoire
L'histoire des conflits commerciaux met en lumière une dynamique complexe dans laquelle l'économie et la politique sont étroitement liées. Les rivalités nationales, parfois teintées de nationalisme, ont fréquemment dégénéré en conflits prolongés et d'envergure.
Des rivalités pour la domination des voies commerciales entre Venise et Gênes au Moyen Âge jusqu'à l'ascension de l'Empire britannique au XVIIIe siècle, les conflits commerciaux ont eu un impact significatif non seulement sur les relations internationales, mais également sur le développement de l'histoire économique et globale.
Le motif sous-jacent de ces conflits était la quête de ressources précieuses et de débouchés commerciaux inexplorés, tout en reflétant des tensions politiques, notamment entre des puissances telles que la France et l'Angleterre rivalisant pour le contrôle et l’exploitation des colonies en Amérique et en Inde. Ces conflits ont instauré des dynamiques de pouvoir qui continuent à se manifester de nos jours.
Les conflits commerciaux du siècle dernier étaient caractérisés par les confrontations idéologiques et économiques héritées des deux guerres mondiales et de la Guerre froide.
Le protectionnisme, qui a démontré son efficacité lors de la crise économique des années 1930 fait l'objet d'un regain d'intérêt, certaines nations étant tentées de favoriser leurs industries nationales au détriment du commerce international
La loi tarifaire de 1930 : Tarif Smoot-Hawley
À la suite de la Grande Dépression, les États-Unis ont instauré des tarifs douaniers élevés sur de nombreux produits importés. Cette législation a incité d'autres nations à prendre des mesures de représailles.
Cela a été suivi par une intensification des tensions commerciales, entraînant ensuite une diminution du commerce international.
Les États-Unis et l'Union soviétique, en tant que principaux acteurs de la scène internationale à cette époque, ont utilisé les sanctions et les tarifs douaniers comme des instruments pour étendre leur influence idéologique et géopolitique.
La menace japonaise dans les années 80.
L'augmentation de la rivalité entre les États-Unis et le Japon a donné lieu à l'émergence de la "menace japonaise". La croissance économique du Japon, notamment dans les domaines de l'électronique et de l'automobile, a conduit les États-Unis à mettre en place des mesures protectionnistes telles que des restrictions quantitatives et des plaintes déposées auprès du GATT.
À l'époque actuelle, marquée par la mondialisation, le panorama des conflits commerciaux a subi des transformations profondes. La multiplication des échanges interconnectés, l'apparition de nouveaux acteurs économiques tels que la Chine et les récentes tensions géopolitiques ont mis en lumière la résurgence inévitable de ces conflits.
Il convient de souligner que les embargos économiques et les restrictions commerciales ont fréquemment été utilisés comme des instruments dans cette confrontation idéologique, entraînant des modifications dans le panorama des échanges internationaux.
Ces conflits commerciaux, bien que motivés par des considérations économiques, ont fréquemment dépassé le cadre strictement économique en s'entremêlant avec des enjeux de puissance et d'influence, posant ainsi les bases des discussions actuelles sur le commerce et la souveraineté nationale.
La mondialisation
La mondialisation, en redéfinissant profondément les aspects économiques, politiques et sociaux des nations, s'est imposée comme une tendance majeure favorisant l'intégration des marchés et l'interconnexion des économies. Cela a conduit à une diversification significative des chaînes d'approvisionnement. Cela a permis aux acteurs de diminuer les coûts de production tout en touchant une clientèle mondiale.
Cette dynamique a engendré de nouvelles problématiques.
Les nations industrialisées, en exploitant la main-d'œuvre moins chère des économies en développement, ont été confrontées à une désindustrialisation dans certains secteurs, entraînant des pertes d'emplois.
Les pays en développement ont vu leur capacité de croissance augmenter au détriment de leur autonomie économique sinon de leur souveraineté.
L'accroissement des disparités entre les pays a été amplifié par des mesures protectionnistes visant la relocalisation industrielle.
Ce qui a permis aux acteurs de réduire les coûts de production tout en atteignant une clientèle globale.
L'inégalité croissante entre les nations, exacerbée par des politiques protectionnistes de réindustrialisation entraîne non seulement des conséquences économiques mais également des tensions géopolitiques.
La mondialisation s’avère une épée à double tranchant : d’un côté, elle fait surgir des opportunités sans précédent, et de l'autre, elle catalyse des conflits qui peuvent engendrer des guerres, au moins, commerciales.