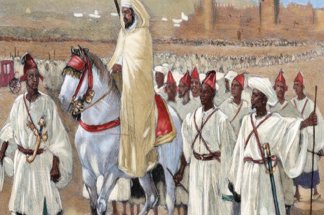National
Abroger Tâasib (l’agnation) – Par Soukaïna Regragui

Le film de Leila Marrakchi « Rok the kasbah » affiche magistralment l’arrogance patriarcale sur la question de l’héritage.

Peut-on admettre l’application d'un fiqh datant du 8ème siècle, persévérer dans un retour à 1400 ans ? Le fiqh ancien ne peut résoudre des problèmes actuels. Des règles porteuses d’inégalité de genre ne peuvent perdurer quatorze siècles plus tard, dans un contexte totalement différent. Peut-on admettre qu’au Maroc du XXIéme siècle, nation millénaire avec ses importantes traversées pour raffermir « sa » démocratie, œuvrant pour ses spécificités mais aussi sa place dans le concert des nations, puisse continuer à fonctionner sous un système successoral qui attribue encore la double part au garçon ; qui ne permet pas à la fille unique ou la fille sans frère de recueillir la totalité du patrimoine de ses parents décédés ; qui admet qu’une épouse non-musulmane, d’un conjoint marocain musulman, ne puisse pas hériter de son époux et de ses enfants ?
L’agnation, stade suprême du patriarcat
L’islam appelle à choura, la consultation. Le Prophète la pratiquait réunissant hommes et femmes, rejetant toute exclusion de genre. Il importe de le réitérer : L’islam précède les démocraties occidentales et les « modernistes » ne visent pas à occidentaliser le Maroc. L’évolution des lois ne peut continuer à se réaliser sans la présence des femmes au sein du Conseil supérieur des oulamas. Les foukahas des siècles passés les en avaient exclues. Des règles discriminatoires sacralisées se sont instaurées. Peut-on se considérer citoyen-ne-s à part entière alors qu’existent de telles lois ? Les enquêtes terrain, les vécus archivés et continus, démontrent les drames découlant d’un système successoral défiant les transformations sociétales. C’est le cas de la règle du tâasib, l’héritage par agnation - (l’agnation, contrairement à la cognation qui inclut les liens par les femmes, était la seule reconnue pour les droits de succession et certaines obligations familiales dans le droit romain). Elle serait intangible selon le corpus des oulamas, et dont la contestation provoque, comme d’autres règles successorales, des remous dans une puissance patriarcale se mobilisant pour son maintien. Et pour cause ! L’argent est central, c’est un pouvoir permettant aux hommes la domination des femmes. L’agnation s’affirme ainsi comme le stade suprême du patriarcat.
Cette règle impose dans le cas de familles n’ayant procréé que des filles, d’aller chercher aussi loin que nécessaire des membres mâles dans la lignée du père et de la mère, que ce soit la mère ou le père qui décède. Souvent ce sont des inconnus qui se précipitent en conquérants, fouinant, abusant, exigeant tout ce que la veuve ou le veuf ne peut prouver leur appartenir. Cela touche fortement des familles modeste, pauvres, allant jusqu’à les démunir de cuillères et autres ustensiles et biens dont l’inventaire serait long et stupéfiant. Quid du compte bancaire, des biens immobiliers, mobiliers, d’œuvres d’art, quand il s’agit de familles aisées. Déposséder s’affiche odieusement comme le maître mot. Toute pudeur éteinte, ce processus de dépouillement de femmes et d’enfants, souvent non encore adultes, ne laisse aux veuves et à leurs orphelines, que leurs yeux pour pleurer.
L’absurdité est à son summum dans la frilosité non seulement des oulamas mais aussi de politiques. Fermer les yeux n’est pas permis face à une règle qui n’est pas coranique, mais émanation du fiqh, donc production humaine, de fait non sacrée. Estampillée par al-ijmaâ, le consensus, réplique le corps religieux. Sans doute, mais seulement depuis la codification des normes religieuses au 8ème siècle, qui a établi la sacralité, et depuis les confusions se sont multipliées entre prescriptions divines et humaines.
L’intolérable, c’est la persévération dans l’injustice
La règle du Taâsib est discriminatoire, suscitant drames sociaux et violentes polémiques. Le problème vient de cette sacralité et c’est le cas de toutes les règles en matière successorales. Or, les révélations coraniques sont venues répondre à des contextes historiques. A l’avènement de l’islam, cette solution de taâsib était compréhensible étant donné que c’étaient les membres mâles de la tribu (oncles, cousins, neveux…) qui prenaient en charge matériellement la ou les filles du défunt ou de la défunte, qui supportaient le paiement de la « diya » (le prix du sang) des proches et participaient aux guerres pour défendre l’entité tribale.
Cela peut-il justifier qux revendications de la société civile et des mouvements féministes on continue de répondre aujourd’hui dans un rigorisme irrecevable qu’il faut maintenir taâsib et recourir à la justice pour dénoncer les héritiers mâles contrevenant à la prise en charge ? `
Quatorze siècles après, sommes-nous encore dans les mêmes réalité et contexte sociaux ? La tribu n’existe plus, la famille élargie est devenue nucléaire, la solidarité familiale s’estompe voire disparaît, le rôle économique des femmes est devenu important, essentiel, certaines femmes prennent en charge matériellement des familles et des hommes, contribuent au patrimoine familial, assument souvent des charges que les hommes n’assument plus, participent au développement de l’économie du pays. Et en dépit de ces évolutions majeures, il est rétorqué que Dieu sait ce qu’il fait.
‘’La ijtihad maâ ‘nnas’’ (لا إجتهاد مع النص), pas d’effort d’interprétation en présence de règles claires dans le Coran, assènent les oulamas. Tâasib, fruit d’interprétations et réinterprétations humaines, n’est d’évidence pas concerné. Cette règle est donc aisément abrogeable d’autant qu’elle est comme d’autres lois, en contradiction avec l’esprit même de l’Islam, l’Islam ouvert, l’Islam d’arrahma (la miséricorde), d’attaqwa (la piété), d’alhikma (la sagesse), d’aladl (l’équité). Le problème majeur est que dans la compréhension générale, taâsib est relié au Coran, négligeant aussi que l’ijtihad, l’effort jurisprudentiel intelligent est inscrit à plusieurs reprises dans le Coran comme recours recommandé. C’est d’ailleurs par un ijtihad fondé sur l’éthique de justice coranique que des juristes ont appliqué “ked wa alsi’aya” (الكَد و السْعاية), ce droit aux femmes d’hériter une partie du patrimoine conjugal auquel elles ont participé, alors que le Coran n’en parle pas. Le problème de fond n’est ainsi pas théologique, mais réside dans l’instrumentalisation de textes en s’éloignant des principes de compassion, de sagesse, de justice, de l’Islam.
Abroger la règle injuste de taassib s’impose. Car ce qui est injuste et non-islamique, c’est de continuer à fermer les yeux sur ces discriminations au nom même de l’islam.
L’aveu intangible
Les propositions des oulamas de ce mois de janvier 2025 sont inacceptables. Au lieu d’abroger
taâsib pour permettre aux filles de bénéficier de toute la succession de leurs défunts parents, les oulamas présentent une solution existant déjà en droit, pratiquée déjà sans leur avis par les parents de leur vivant en recourant à alwassiya (testament) ou alhiba (donation) à leurs filles.
Et c’est ainsi qu’en 2025, on croit inventer la roue !
Le constat est là : les oulamas ont rejeté l’abrogation du taâsib proposant son détournement par alhiba. Serait-on là en train de ruser avec des textes ‘’divins’’ supposément irréfragables ? Et que dire de ce contournement du taâsib sinon que la société fonctionne dans l’hypocrisie, que les adouls (notaires du chrâa), les fouqahas poussent à contourner une discrimination et que ce faisant, ils la reconnaissent ainsi comme telle ? C’est aussi le cas s’agissant de la règle de la double part au profit de l’héritier de sexe masculin. Les témoignages indiquent que des familles croyantes et pratiquantes, se fondant sur l’esprit de justice du coran, recourent, sans attendre l’avis des ‘’sentinelles du dogme’’, à la désactivation de taâsib par le testament et/ou la donation.
La société civile s’est toujours engagée sur ces sujets religieux. Toujours, elle fut sommée de les laisser à qui de droit. La démarche participative pour la refonte de la Moudawana initiée par le Souverain exprime tout le contraire et dit sa Haute volonté de n’exclure aucune partie du champ de la réflexion, de propositions.
La déception en ce mois de janvier 2025 ne tétanise pas la société civile qui poursuit et poursuivra sa mobilisation er son plaidoyer. La solution réside dans une réelle volonté politique autour d’un projet de société clairement défini, regardant courageusement les tendances sociétales, réfutant l’accusation de vouloir ébranler le socle identitaire. La Constitution 2011 établit que la règle suprême de droit est « L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». Quelle société voulons-nous pour notre pays ? Cette question majeure doit être posée et déboucher sur des réponses sans équivoque et des solutions claires. Sans cette clarté, la démocratie reste à l’épreuve et les femmes continueront de subir des lois inégalitaires, discriminatoires avec toutes les répercussions sur la cellule familiale, sur la société dans son ensemble, sur le développement du pays.