société
La frange rurale d’El Jadida : Chronique d’une disparition annoncée

Dans les années soixante du siècle dernier, et sur cette vaste étendue agricole située entre le Plateau, - constitué de coquettes villas, qu’on appelait Diour N’ssara (ou maisons des chrétiens) car y logeaient presque exclusivement des coopérants français -, et l’ancien aérodrome, il y avait seulement trois douars
Mémoire d’un territoire effacé. À travers Figues et Châtiment, recueil de nouvelles imprégnées de nostalgie et de précision ethnographique, Mustapha Jmahri ravive la mémoire d’une frange rurale d’El Jadida aujourd’hui disparue. Ce territoire périurbain, à la fois proche de la ville et pourtant oublié des cartes et des politiques, devient le théâtre littéraire d’une époque révolue, rythmée par la simplicité, la solidarité et la sobriété.
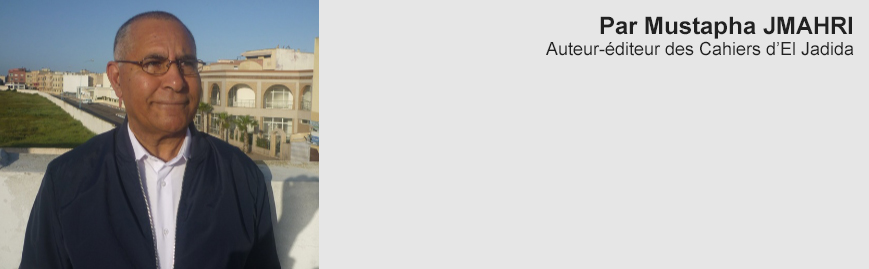
En publiant le recueil de nouvelles mazaganaises « Figues et châtiment », paru chez L’Harmattan en 2016, préfacé par l’ami Fouad Laroui, j’ai, en fait, honoré mon terroir, des années 1959-79, qui a disparu depuis et dont ma mémoire a gardé des traces. Je me suis demandé comment la frange rurale d’El Jadida, c'est-à-dire la zone, peu peuplée, qui enctourait la ville, a-t-elle pu disparaître en un demi-siècle ? La question n’est pas simple. Son analyse est compliquée, d’autant plus qu’elle pose un problème de définition : il s’agit d’une frange rurale et historique née au temps du Protectorat, « livrée à elle-même et ignorée par la puissance publique » selon l’expression d’Annie Fourcaut, ancienne directrice du Centre d’histoire urbaine à Lyon. Cette zone rurale juxtaposée à la ville était habitée majoritairement par des familles doukkalies, et non d’origine migratoire, dispersée en douars ou en petits azibs isolés (demeures entourées d’un enclos pour les animaux). Deux raisons m’ont poussé à me pencher sur ce phénomène : la première, ma qualité de chercheur en histoire locale, la deuxième, existentielle, puisque j’ai été témoin de cette rapide disparition.
Fouad Laroui, qui a connu cette même frange dans sa jeunesse alors qu’il vivait en ville, avait qualifié mes nouvelles dans sa préface de « madeleines de Proust » tant elles évoquaient des odeurs, des saveurs, des couleurs et des amours liées à un territoire précis, celui de l’adolescence. Par cet ancrage géographique, mon recueil de nouvelles voulait rendre hommage, sous forme littéraire, aux modestes personnages qui y ont vécu et que j’ai connus à cette époque. Les femmes, comme de rigueur à l’époque, gardaient le foyer, éduquaient les enfants, se chargeaient du ménage et surtout de la corvée d’eau, alors que les hommes vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ils étaient : agriculteurs, meuniers, anciens combattants, manœuvres ou cafetiers. Au-delà du lieu et des hommes, il y avait principalement une spécificité culturelle de ce terroir qui a également disparu depuis et dont l’essence se résume en trois mots (3 s) : simplicité, solidarité et sobriété.
La recherche sur l’origine locale du peuplement de cette frange révèle qu’il s’agit de familles d’autochtones. Nous sommes donc loin de la notion de banlieue marginalisée ou sensible qui a recueilli des asociaux, des immigrés ou des personnes qui ont fui la cherté de la vie en ville. Les parents étaient de petits agriculteurs, des ouvriers ou des marchands agricoles qui allaient travailler ou vendre leurs produits dans les quartiers modernes, alors que les enfants, notamment des années 1960 et 70, avaient beaucoup plus d’attaches avec la ville : scolarité, cinéma, loisirs, plage, petits achats et rencontres entre amis, dont parfois des Français encore résidents à El Jadida. Pour les collégiens de cet espace périurbain, El Jadida exerçait, sur eux, une grande attractivité. Ils la voyaient comme l’expression de la modernité et de la réussite.
Ma famille a atterri dans la frange rurale d’El Jadida en 1959 car mon père y possédait une petite sania (ferme dotée d’un puits équipé d’une motopompe), héritée de mon grand-père, connue sous le nom de « sania Jmahri ». Toute cette zone rurale était d’ailleurs dominée par les cultures, et parsemée de sanias, petites et moyennes, telles la sania Reddad, la sania Oulderra, ou la sania el-Ajmi qui a pris la place de l’ancienne ferme Rivault. Les sanias et les azibs portaient les noms de leurs propriétaires et étaient clairsemés de part et d’autre de la route goudronnée qui partait du quartier du Plateau, alors ultime limite de la ville, jusqu’à l’ancien aérodrome.
Dans les années soixante du siècle dernier, et sur cette vaste étendue agricole située entre le Plateau, - constitué de coquettes villas, qu’on appelait Diour N’ssara (ou maisons des chrétiens) car y logeaient presque exclusivement des coopérants français -, et l’ancien aérodrome, il y avait seulement trois douars : douar sania el-Morakib (du nom du mourakib/ contrôleur Marcel Rivault), douar Labiassoune (l’Aviation) du fait de sa proximité de l’aérodrome, et douar el-Ghazoua, un peu excentré. Chaque douar était éloigné l’un de l’autre. Outre les douars d’habitation, cette zone rurale hébergeait des fonctions que la ville rejetait : la carrière, le cimetière, la décharge publique et l’aérodrome.
Créé dans les années 1930, l’aérodrome s’étendant sur un immense terrain plat d’une centaine d’hectares était doté d’une piste non goudronnée de 1.200 m. Mais, en général, l’activité aérienne dans cet aérodrome était presque inexistante en dehors de l’atterrissage, bien rarement, de petits avions monoplaces ou biplaces. Pour toute infrastructure : un petit hangar accolé au logement du gardien et sa famille. Une ligne téléphonique permettait au gardien d’informer le Service des Travaux publics de la ville de chaque visite. Au printemps, ce grand territoire devenait un tapis de verdure de diverses fleurs -iris sauvages, coquelicots, asphodèles- où les riverains et autres villageois venaient se promener.
Pour se situer dans cet espace, les habitants désignaient les différents endroits par des microtoponymes ne figurant pas sur les cartes actuelles et ne demeurant plus que dans la mémoire des habitants les plus âgés : bir el-Caïd (puits du caïd), Chejrat tlata (les trois arbres), Jniyen (petit verger), bled Lihoudi (terre du juif), Hajrat Fekkak (rocher de Fekkak), et Dayat Founane (mare de Founane). Tous ces lieux sont ensevelis aujourd’hui sous les constructions, alors qu’ils constituaient autrefois des repères pour les résidents.
L’avenue actuelle Ibn Toumert, ancien boulevard Voltaire, qui part du phare Sidi Bouafi, construit en 1914 par des prisonniers allemands, longe le quartier du Plateau et se prolonge vers l’avenue de Varennes jusqu’au rond-point de Marrakech, représentait la dernière limite de la cité. Cette avenue de dix mètres de largeur séparait les deux territoires : du côté gauche de l’avenue c’était El Jadida et, du côté droit, c’était tout de suite les ouled Bouaziz Nord. Ouled Bouaziz du nom de la célèbre tribu dont le peuplement a constitué une partie du premier tissu humain d’El Jadida. Je me suis souvent demandé quel rapport la frange entretenait-elle avec les Ouled Bouaziz alors qu’elle pourrait être logiquement désignée sous le vocable « El Jadida-Banlieue ». Cette persistance du caractère patrimonial local a perduré plusieurs années jusqu'à l'extension du périmètre urbain de la ville vers la frange rurale à la fin des années 1970.
Triq el-Matar
La communication entre la périphérie et la ville se faisait par la route de l’aérodrome, dite en arabe Triq el-Matar, à l’origine dédiée exclusivement à l’aérodrome. Elle était bordée, de part et d’autre, de grands eucalyptus, et scindait la frange elle-même en deux blocs : un bloc côtier s’étendant du phare de Sidi Bouafi vers le littoral atlantique et un bloc dominé par la plaine. Triq el-Matar, a focalisé, à elle seule, toute l’histoire de l’ancienne périphérie. En fait, il n’y a pas eu évolution mais rupture. Hier encore, très rares étaient les voitures qui l’empruntaient alors qu’aujourd’hui ce tronçon vit l’étranglement, aux heures de pointe, alors même que la route a été très élargie et les eucalyptus, plantés au temps du Protectorat, sacrifiés sur l’autel du bitume.
L’une des nouvelles de mon recueil, ayant pour titre « Vermicelles pour minuit », rend compte de cette réalité flagrante de la solitude de la périphérie des années soixante. Elle dépeint le contraste entre l’image dudit espace comme endroit au plus près de la ville le jour mais s’en éloignant dans notre imaginaire dès que l’obscurité tombait. Au moment du coucher du soleil, le petit douar de Labiassoune, plus tard occupé, principalement, par trois coopératives d’habitat, fermait ses portes. À l’extérieur, pas âme qui vive sauf des chiens qui aboyaient de temps à autre. Rares étaient ceux qui osaient penser aller en ville même s’ils venaient à manquer de quelque chose. Pourtant, un soir, Mme Zahra demanda à son fils Mehdi d’aller chercher des vermicelles. L’épicerie la plus proche, celle du quartier du Plateau, était à trois kilomètres. Mehdi, âgé d’à peine onze ans, n’osa pas s’aventurer sur la route car on était proche du coucher du soleil. Les longs eucalyptus qui bordaient la route accentuaient son malaise : les ombres des branches lui donnaient l’impression de fantômes qui gesticulaient. Par chance un couple de voisins allait en ville, il l’accompagna. Arrivé au niveau de l’épicerie, la nuit s’installait et il craignait de faire le trajet retour tout seul. Malgré lui, il décida d’aligner son parcours sur celui du couple ami.
Entretemps, Mme Zahra attendait ses vermicelles. Anxieuse de ne pas voir son fils Mehdi de retour, elle alerta ses voisines. Les femmes sortirent pour le guetter sur la route obscure, toutes craignaient qu’il soit arrivé malheur à l’adolescent. Ce n’est qu’à 22 heures que Mehdi regagna, enfin, son douar en compagnie des voisins. Mme Zahra s’apaisa mais sa colère éclata contre son fils qui, d’après elle, pour une poignée de vermicelles, s’était fait toute une histoire.
Par cet exemple, j’ai voulu montrer combien cette route, qui était déserte et qui faisait peur aux adolescents dès la tombée de la nuit, a, en un demi-siècle, évolué, en un axe routier qui ne connait désormais aucun répit en matière de circulation.
À partir de la moitié des années 1980, cette frange rurale, la mienne, allait fondre peu à peu. L’urbanisation galopante consomma, graduellement, l’espace agricole. C’était le temps de la croissance exponentielle de la ville avec la création de lotissements pour loger une population exogène, majoritairement employée par le groupe OCP (Office chérifien des phosphates). La Compagnie générale immobilière réalisa un projet urbain sur le terrain de l’Aviation après son déclassement. D’autres édifices publics virent le jour grâce à l’Etat tels le Centre de formation des enseignants, l’Institut de technologie appliquée, et le tribunal. La frange rurale n’a pas reculé vers le sud, elle a tout simplement et progressivement cédé la place à l’extension inéluctable de la ville qui se trouvait à l’étroit. Ce qui est qualifié par certains sociologues d’étalement urbain.
En un demi-siècle, la physionomie de la ville d’El Jadida s’est beaucoup transformée. Quant à sa frange historique, il me semble qu’elle n’a pas changé mais qu’elle a quasiment disparu : seuls les trois douars subsistent encore, tels des enclaves rescapées du passé.
Références :
- Annie Fourcaut, Les banlieues populaires ont aussi une histoire (revue Projet, n° 4, 2007)
- Rolland Chapuis, L’espace périurbain une problématique à travers le cas bourguignon (In : L'information géographique, volume 59, 1995)
- M. Jmahri, Figues et Châtiment (Paris : L’Harmattan, 2016)





















