chroniques
Divorce : le culturel et le juridique dans le partage du patrimoine conjugal – Par Bilal Talidi

Faut-il inscrire, ou non, l’additif relative au partage du patrimoine conjugal en cas de divorce, prévu par la Moudawana comme optionnel, dans le registre de la contrainte ? Un débat qui ne fait que commencer.
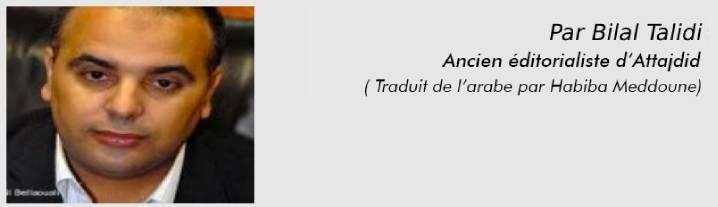
Deux décennies se sont écoulées depuis l’adoption du nouveau Code la famille (Moudawana) sur fond d’une polarisation tranchée des positions sur sa nécessité et sa mise en œuvre.
Les militants des droits de l’Homme placent actuellement plus haut la barre de leurs revendications, passant de l’amendement de certains articles à une remise à plat du texte de la Moudawana pour le mettre en phase avec les référentiels juridiques internationaux (charte et conventions des Nations Unies).
Dans le débat de pareils sujets sociétaux, il convient toujours de tenir compte de trois paramètres fondamentaux.
Le premier a trait au culturel. Il consiste à savoir si cette dimension de la problématique a connu des transformations de nature à autoriser une mise à niveau total avec le référentiel juridique international sans provoquer une rupture sociétale semblable à celle qui s’est produite avec le lancement du Plan d’action national pour l'intégration de la femme au développement. A tel point que pour la transcender, cette polarisation a nécessité une intervention royale avec la nomination d’une Commission consultative chargée de la révision de la Moudawana. Composée de toutes les sensibilités et d’une représentation des oulémas, son travail a été encadré par des orientations royales lui enjoignant d’œuvrer dans le strict respect des finalités de la jurisprudence musulmane (charia).
Le deuxième paramètre se rapporte aux mutations sociologiques et aux évolutions qu’elles produisent dans le corps social marocain. Ce paramètre cherche à vérifier la capacité de ce corps à supporter les revendications des droit-hommistes en vue de déterminer si leur satisfaction ne menacerait pas les bases de la stabilité sociale.
Le troisième paramètre enfin consiste à sonder les limites de l’esprit consensuel. Il s’agit d’examiner si les divers intervenants, aux référentiels divergents, sont arrivés à parler un même langage.
Sachant que les militants des droits de l’Homme ont fourni un effort pour enraciner leurs revendications dans le legs de la jurisprudence islamique, il reste à savoir si, au plan sociologique, les théologiens ont produit l’effort de comprendre les problèmes dont pâtit la femme marocaine pour prendre en considération les limites des textes de la Moudawana à y faire face.
Pour cerner cette difficulté, l’exemple du récent débat sociétal sur le partage du patrimoine conjugal en cas de divorce est assez parlant, tant ce problème requiert un examen serein et dépassionné, bannissant toute surenchère idéologique.
Ce qu’il faut savoir au préalable c’est que la prise en compte des trois paramètres précités lors de l’élaboration de la Moudawana a eu un impact considérable sur la finalisation d’une mouture consensuelle que traduit parfaitement l’article 49 du Code de la famille.
Cet article a en effet privilégié le principe de la convenance (commun accord, approbation mutuelle) pour l’adoption, à côté de l’acte de mariage, d’un additif destiné à régir les arrangements financiers entre les conjoints, en vue de préciser le patrimoine constitué durant le mariage. En contrepartie, le texte stipule le principe de l’autonomie financière des deux conjoints et le recours aux preuves en cas de litige sur le patrimoine constitué durant l’union.
Aujourd’hui, les militants des droits de l’Homme ne sont pas satisfaits de cette formule qui, selon eux, a démontré ses limites et doit en conséquence être modifiée avec l’adoption du principe de la contrainte au lieu de la convenance, le but étant de mieux protéger les droits financiers de la femme au patrimoine constitué durant la période du mariage.
Les théologiens sont d’un autre avis. Ils insistent sur le principe de la convenance qui, à leurs yeux, contribue à la stabilité de la famille et à la prémunir contre toutes sortes de menaces, estimant que le principe de la contrainte aura des répercussions incalculables sur l’institution matrimoniale et sur le taux de fécondité de la société. Ils estiment ainsi qu’il ne fera qu’aggraver la désaffection pour le mariage et se traduira par une hausse du phénomène du célibat des filles.
Le ministère de la Justice n’a jusqu’à présent publié aucune donnée statistique sur le nombre de mariages ayant conclu un acte additif sur les arrangements financiers entre les conjoints. Certaines activistes des droits de l’Homme évoquent un pourcentage infinitésimal (0,5%), soutenant que ce taux insignifiant révèle que la formule optionnelle adoptée n’était qu’un subterfuge pour mettre en sourdine les revendications féminines et justifier le statut quo.
Les défenseurs de la formule optionnelle, eux, considèrent que ce pourcentage est significatif en sens inverse, en ce sens que les revendications féministes n’expriment pas vraiment les doléances de la femme marocaine, mais plutôt celles d’agendas exogènes, obnubilées qu’elles sont par un alignement sur les sociétés occidentales sans tenir compte des spécificités culturelles et sociales du pays.
Disons-le sans ambages, pour sortir de cette controverse stérile : le débat ayant ponctué les travaux de la Commission consultative chargée de la révision de la Moudawana était d’une meilleure qualité. Il a au moins démontré que l’acception théologique n’était pas en décalage avec le corps social ni inconsciente des dangers de la consécration du principe de la contrainte dans le Code de la famille. Pour leur part, les défenseurs du partage du patrimoine ont admis la légitimité religieuse du régime politique en place, avec ce que cela implique en termes d’élaboration des textes de la Mouadawana qui, basés sur le référentiel islamique, s’inspirent des finalités suprêmes de la charia. D’où leur recours aux corpus et au patrimoine de la jurisprudence musulmane, comme en témoignent leur invocation des fatwas des Foukahas de Ghomara, dans le nord du Maroc qui ont jugé qu’une femme qui peine dans les champs contribue à la fructification du patrimoine familiale et a droit à une rémunération en cas de divorce.
Le Maroc a besoin aujourd’hui de poser des questions profondes qui nécessitent des statistiques malheureusement indisponibles, d’autant plus que le pourcentage insignifiant des familles ayant opté pour la mise en œuvre du principe de la convenance par la conclusion d’un acte additif de gestion financière est porteur d’interprétations contradictoires qui ne contribuent pas à faire avancer le débat.
D’autres statistiques font défaut, comme le nombre des affaires jugées ou en cours devant les tribunaux en lien avec les droits financiers spoliés des femmes. Le nombre de cas où des femmes ont eu recours, ou pas, au principe des preuves pour faire valoir leurs droits financiers constitués durant la période du mariage mérite un examen de près. De même que la de non activation de ces mécanismes pourtant disponibles, appelle un diagnostic pour en cerner les motivations.
Pour une vue d’ensemble exhaustive, on a besoin, en parallèle, d’études sociologiques continues sur le peu d’intérêt des familles pour la conclusion de l’acte additif de gestion financière des conjoints à côté de l’acte du mariage. On a également besoin d’examiner les statistiques du ministère de la Justice sur le phénomène de l’intensification du recours au principe de l’exception autorisant la polygamie et le mariage des mineures, afin d’explorer les paramètres en jeu dans ces phénomènes et déceler la part qui revient aux facteurs culturel, juridique et socioéconomique à l’œuvre.
Les réponses à ces questions permettront sans doute aucun d’enrichir le débat et de jeter les bases d’une plateforme commune pour évaluer la Moudawana en vue de l’améliorer et préciser laquelle des approches, la culturelle ou la juridique, serait la mieux indiquée.
A mon sens, il importe d’opérer une transformation dans la structure culturelle avant de passer à l’approche juridique. Elle seule est à même d’expliquer le désintérêt des Marocains pour la conclusion de l’acte additif à côté de l’acte de mariage. La prédominance de ce trait culturel particulier émane de la représentation qu’ils se font de l’institution matrimoniale et des rôles de la famille, et de la perception qu’ils en ont : une structure basée sur l’affection, la tendresse, la solidarité et la coopération, autant de fondamentaux qui forment l’assise de la famille, que toute intrusion d’ordre financier ne ferait que gangrener.
Il n’est pas possible d’avancer, de manière scientifique, sur ce que seraient les statistiques si la Moudawana devait consacrer dans les textes le principe de la contrainte du partage du patrimoine au lieu de la convenance. Il n’empêche que le nombre insignifiant enregistré par la formule optionnelle, couplé au recours massif au principe des exceptions dans le mariage des mineures, révèle déjà que la question dépasse la dualité conservateur/moderniste et pose le problème en termes culturel et social. Elles induisent enfin une question fondamentale : la structure socioculturelle et économique réunit-elle les conditions nécessaires à ce genre de revendications féministes ? Ou sont-elles subordonnées à une profonde transformation culturelle dont l’aboutissement est tributaire de la maturation des conditions socioéconomiques ?
Le fait est que dans une société marquée par l’accroissement de la désaffection pour le mariage et la hausse du chômage, où dans des régions (les campagnes notamment) le mariage constitue un outil fondamental de gestion de l’équilibre socioéconomique, il n’est ni aisé ni recommandé de lier le mariage à des considérations de gestion financière entre les conjoints et de comptabiliser le travail ménager comme une contribution au patrimoine conjugal. Pour de larges pans de la société, cela n’est ni plus ni moins qu’une menace pour la stabilité familiale.





















