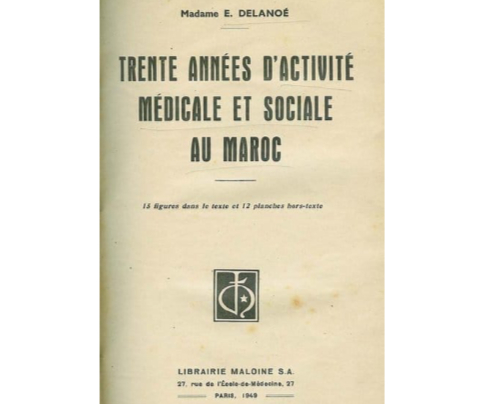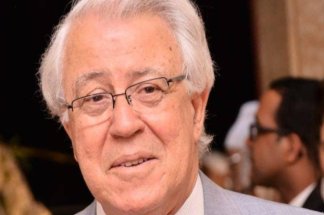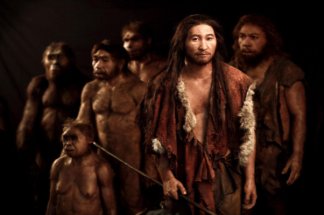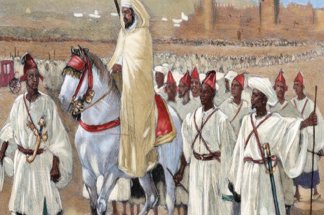chroniques
Mémoire oubliée : Eugénie Delanoë, témoin du Maroc féminin d’antan – Par Mustapha Jmahri

Arguments et exemples à l'appui, Eugénie Delanoë expose les multiples souffrances de la jeune mariée, auxquelles s'ajoutent les infections locales et générales
À l’heure où la recherche académique sur le Maroc d’autrefois se confronte souvent à une crise de documentation, l’oubli d’ouvrages essentiels handicape de nombreux travaux. Le cas du livre de la docteure Eugénie Delanoë, Trente années d’activités médicale et sociale au Maroc (1949), est révélateur, écrit Mustapha Jmahri : un trésor d’informations sur la condition féminine et la réalité sanitaire dans le Maroc rural du premier XXe siècle, méconnu des chercheurs contemporains.
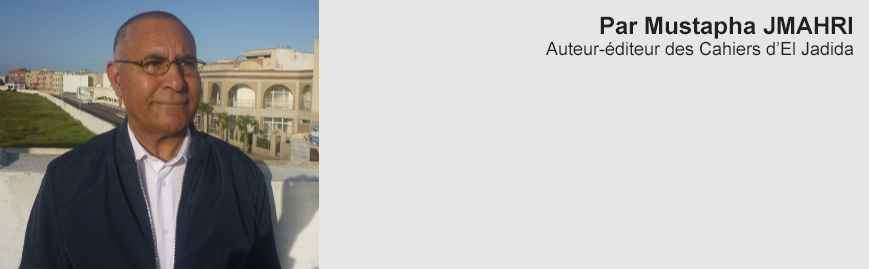
Une source inexploitée sur le terrain féminin et médical marocain
Beaucoup de jeunes chercheurs, notamment ceux qui font un doctorat ou une thèse, ont du mal à trouver les documents nécessaires à leur travail. Beaucoup d'études ont été réalisées, à l'époque du Protectorat, mais sont oubliées, inconnues ou introuvables faute de rééditions. Cela conduit certains jeunes à reprendre des sujets déjà traités et de meilleure façon ou à aborder un phénomène sans avoir l'éclairage historique requis.
Cette méconnaissance de la documentation de terrain existante concerne surtout des ouvrages à caractère social, médical ou administratif écrits par des étrangers pendant leur séjour ou leur activité au Maroc. Ainsi, je me suis toujours demandé pourquoi les doctorants en sociologie, en médecine, ou dans les questions du genre n'ont jamais consulté un livre important écrit par une doctoresse qui a passé plus de trente ans au Maroc et est enterrée à El Jadida en 1956. Il s'agit, de la doctoresse Eugénie Delanoë. Arrivée au Maroc en 1913, elle est l’auteure de plusieurs articles scientifiques inédits et d'un livre riche en informations sur la vie familiale marocaine intitulé : Trente années d'activités médicale et sociale au Maroc publié à Paris en 1949.
Cette docteure se donnait entièrement à sa tâche de médecin notamment pendant la durée de la Première Guerre mondiale où elle était seule médecin de la place et faisait les visites à domicile aidées par des infirmières marocaines formées dans son service.
Mariages précoces et violences invisibilisées
Le livre d’Eugénie Delanoë apporte des données importantes sur la vie de jeune fille dans la campagne marocaine, vie empreinte de souffrances du fait de son entourage ou de son conjoint. En le lisant, on est choqué par certaines violences endurées par les jeunes filles à cette époque.
Eugénie Delanoë parle du mariage précoce de la jeune fille marocaine musulmane à l’âge de 10 à 12 ans. Elle explique que ces mariages se faisaient pour des considérations d’intérêt immédiat avec des hommes mûrs, souvent âgés, très souvent vicieux et d’autant plus exigeants à l’égard de leur jeune épouse inexpérimentée.
Arguments et exemples à l'appui, l’auteure expose les multiples souffrances de la jeune mariée, auxquelles s'ajoutent les infections locales et générales. « La femme devient une véritable estropiée au point de vue génital ». Ces maladies et infections pouvaient provoquer la stérilité. La jeune fille n'avait pas son mot à dire et ne pouvait pas donner son avis ni à ses parents, ni à son mari. En fin de compte ces unions engendraient des accouchements difficiles, dans des conditions totalement inadaptées et la jeune fille pouvait y perdre la vie ou subir des dommages irréversibles : déchirures, fistules, infections incurables et fausses couches à répétition.
Un legs scientifique à redécouvrir dans les bibliothèques marocaines
Le livre de Eugénie Delanoë fourmille d'exemples de jeunes femmes, donne leurs noms et leurs lieux de résidence à El Jadida et alentours (Aounate, Sidi Bennour et Had ouled Frej). Elle les a examinées pour attester de leur état de santé, parfois comme experte mandatée par le tribunal lors de violences dues à un conflit familial ou conjugal.
Cet ouvrage reste l’un des très rares documents qui consigne l’état social et médical de la jeune Marocaine pendant la première moitié du XXème siècle. Son auteure y aborde les maladies vénériennes, les grossesses gémellaires multiples, les croyances locales sur la grossesse, le traitement de la syphilis chez la femme enceinte et d’autres points aussi délicats que sensibles.
Je pense que les chercheurs et chercheuses en études de genre au Maroc ne doivent pas ignorer cet ouvrage, disponible à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat et dans d’autres institutions de lecture publique. L’historienne Nelcya Delanoë, née au Maroc, petite-fille de l’auteure, avait elle-même, lors de son passage à El Jadida en 1995, déposé des copies de ce livre, scannées en France, à l’établissement Jean Charcot et à l’Institut français.