chroniques
Salimata, Fofana et tant d’autres – Par Fatiha SAIDI

Qui sait qu’à la fin d’une journée de mendicité nous avons 20 à 30 dirhams ? ». La bonne étoile était filante…
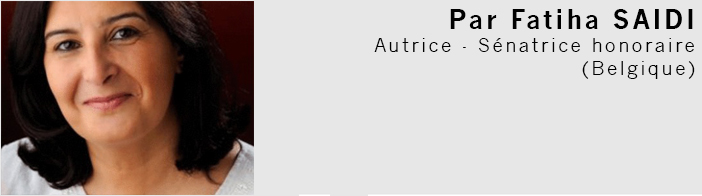
Al Hoceima, la petite ville du nord du Maroc se réveille paresseusement en ce mois de ramadan. Même le soleil semble peu enclin à donner du rayon. Certes, il le fera mais à un rythme lent, en s’étirant par-dessus les nuages. C’est le ramadan pour tout le monde somme toute. Sauf pour Salimata, Fofana, Zainab et Fatim, ainsi que leurs autres sœurs et frères d’infortune.

Qui sont-elles ? D’où viennent-elles ? Pourquoi ont-elles quitté leur pays ? Pourquoi sont-elles au Maroc ? Comment y sont-elles arrivées ? Pourquoi Al Hoceima ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ?Avec qui ? Quand ?
Car, malgré le jeûne qu’elles pratiquent, les journées pour elles se suivent et se ressemblent, dans un rituel immuable. Elles, ce sont des femmes subsahariennes qui ont quitté leur pays pour tenter l’aventure dans un ailleurs sublimé plus clément et plus généreux. Amassées en groupe de quatre à un feu rouge, elles mendient et tendent la main en sollicitant les automobilistes forcés à l’arrêt. Comme de nombreuses autres que l’on verra, à travers la ville, seules ou accompagnées par de jeunes enfants se prêter au même exercice.
Qui sont-elles ? D’où viennent-elles ? Pourquoi ont-elles quitté leur pays ? Pourquoi sont-elles au Maroc ? Comment y sont-elles arrivées ? Pourquoi Al Hoceima ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Quand ?
La réponse à ces nombreuses questions peut aider à comprendre la trajectoire et les motivations de ces femmes qui décident de quitter les leurs et de franchir des milliers de kilomètres dans des conditions bien éloignées de tout standard touristique.
A leur rencontre
Salimata, 18 ans et la plus jeune du groupe est arrivée au Maroc en octobre 2020. Elle était mineure à l’époque et quittait la Côte d’Ivoire en avion. Célibataire, sans enfant, la jeune fille atterrit dans la métropole casablancaise et met le cap sur Rabat dont on lui a dit qu’elle était la capitale du Maroc. Une capitale c’est assurément une ville importante pour un pays et elle lui ouvrira certainement des perspectives « pour trouver du travail, un logement et de quoi me nourrir. Mais aussi et surtout pour envoyer de l’argent à mes parents et mes trois frères et sœurs, toutes et tous plus jeunes que moi », récite-t-elle dans un français hésitant, dans un regard porté par des yeux fatigués et éteints.
Une lassitude formulée explicitement par Fofana, 37 ans, « peut-être car je n’ai pas été à l’école », souligne-t-elle. Native de Côte d’Ivoire elle aussi, elle a pris la route avec son jeune frère âgé de 11 ans à l’époque, qu’elle a élevé depuis sa plus tendre enfance, en l’absence de parents décédés tour à tour. « Je n’ai plus de force maintenant. Je ne peux plus pousser, je suis fatiguée », gémit-elle en rabattant son voile sur son visage pour se protéger du soleil sans doute mais certainement plus encore pour masquer son émoi. « Je compte sur Dieu maintenant et je regarde ce qu’il va décider pour nous. Je suis tellement désolée pour mon petit frère. J’aurais voulu lui donner une meilleure vie mais j’ai failli. Il a 16 ans aujourd’hui et la seule activité que je peux lui offrir c’est la mendicité ».
Zainab, 35 ans, guinéenne partage la même préoccupation pour ses enfants. Elle est au Maroc depuis 5 ans, après un périple fait d’un mois de traversée des différents déserts et une installation temporaire de trois mois au Caire. Elle y retrouvera ses deux enfants, âgés à l’époque de 5 et 2 ans, partis avec leur tante, sa propre sœur donc. « Elle est partie avant moi et avec mes enfants pour que je puisse régler toutes nos affaires en Guinée ». Surtout parce que Zainab doit trouver l’argent pour payer le voyage en voiture ainsi que le passeur Mais pas seulement. Elle craignait aussi que ses enfants soient enlevés par leur père qu’elle veut fuir à tout prix. Un homme qu’elle fut forcée d’épouser et qui la battra comme plâtre durant la vie commune. « La seule chose qui me donne un peu de satisfaction c’est de savoir que mes enfants vont à l’école. Ils sont à Casablanca, avec ma sœur qui est devenue une seconde maman pour eux ». Zainab tente alors de gagner un peu d’argent pour l’envoyer à sa petite famille laissée derrière elle.
Elle a décidé de faire confiance à sa bonne étoile lorsqu’une amie subsaharienne, lui a téléphoné et dit « viens à Al Hoceima, tu y trouveras du travail ». « Pour travailler à Casablanca, il me fallait une carte de séjour et un passeport dont je ne dispose bien sûr pas. Alors quand j’ai reçu l’appel de mon amie, je n’ai pas hésité une seconde. Mais j’ai vite déchanté car ici non plus il n’y a pas de travail. La seule activité qui nous permet de subsister et de manger c’est la mendicité. Je souffre quand les gens me disent « va travailler au lieu de mendier ». J’ai envie de leur dire que j’aimerais tellement mais je n’en trouve pas. Qui sait qu’à la fin d’une journée de mendicité nous avons 20 à 30 dirhams ? ». La bonne étoile était filante…
La mendicité, Fatim, 37 ans, originaire elle aussi de Côte d’Ivoire n’a jamais cru qu’un jour elle s’y adonnerait. Cette maman de deux enfants (12 et 2 ans), confiés à leur grand-mère maternelle à Danane, ville ivoirienne proche du Liberia et de la Guinée raconte la genèse de sa migration : « Je suis venue pour travailler comme nounou, avec un contrat et par l’intervention d’une femme qui m’a mise en contact avec une femme qui m’était présentée comme mon employeuse ». En guise de nounou, elle se retrouvera engagée à effectuer de multiples tâches, dans des conditions laborieuses et peu respectueuses des clauses du contrat, à commencer par le paiement d’un salaire dont elle ne verra jamais le moindre dirham. « J’ai vécu un cauchemar, un véritable calvaire. Je devais faire le ménage, m’occuper des enfants, les amener à l’école, les ramener… Je ne dormais que quelques heures par jour, dans le salon et sans aucun espace personnel m’assurant un minimum d’intimité. J’aurais pu continuer à faire ce travail même dans des conditions difficiles si j’avais été payée. Mais au bout de 5 mois j’ai compris que j’étais tombée sur des exploiteuses professionnelles. J’ai vraiment cru à un contrat en bonne et due forme car mon voyage en avion et mon séjour de trois jours à l’hôtel à Casablanca ont été pris en charge par ces deux personnes. Lorsque j’ai demandé mon salaire, mon employeuse m’a menacée de faire appel à la police. Alors j’ai décidé de fuir et je suis partie à Kenitra ».
Si la route de Fatim a croisé ces deux personnes mal intentionnées, toutes cependant insistent sur la générosité et la bienveillance des Marocain.es. « Les gens sont gentils, ils nous donnent de la nourriture, du pain, de l’eau et parfois même des vêtements. Parfois il y a des personnes qui nous disent qu’elles aimeraient bien nous aider mais qu’elles n’en n’ont pas les moyens », témoigne l’une d’elles, relayée par son amie qui nuance le propos « certes, il y a des personnes qui nous donnent un peu d’argent et de la nourriture mais certaines nous insultent ». A la question d’actes racistes dont elles auraient pu faire l’objet, la réponse sera, elle aussi, formulée tout en nuances. Si l’une d’entre-elles affirme haut et fort « je n’ai jamais subi de la violence ou du racisme », une autre soufflera, « oui il y a du racisme. Mais je n’ai jamais connu de violences. Mais les insultes c’est déshonorant et blessant. Moi ça me fait pleurer ».
La débrouille dans la solidarité
Salimata, Fofana, Zainab et Fatim puisent leur force pour contrer cette vie de misère, dans le groupement qu’elles ont constitué. Elles s’épaulent, partagent le produit de leur mendicité, veillent sur leurs effets mutuels lorsque l’une d’entre-elles quitte le groupe pour se rendre au marché afin de quémander quelques fruits et légumes qu’elles prépareront en rentrant « à la maison ». Une « maison » fabriquée de bric et de broc dans un chantier inachevé où elles ont choisi d’élire domicile. Sans eau ni électricité mais heureusement une source toute proche qui leur permet de s’alimenter en eau. Le soir venu, elles discutent entre elles, se tiennent au chaud et se réconfortent. Elles évoquent leurs enfants laissés à Casablanca ou à Danane, les horizons bouchés sur lesquels dansent parfois quelques rêves évanescents, comme celui de partir en Espagne ou d’être adoptée par une famille marocaine « avec laquelle je vivrais comme s’il s’agissait de ma propre famille ».
Que dire ? Que faire ?
A l’écoute de ces quatre femmes, durant plus de deux heures, il nous est impossible de clôturer les dernières lignes de cet article et de tourner les talons, sans nous questionner sur le soutien dont nous pourrions faire preuve à leur égard. Ces personnes, hommes et femmes, que nous nommons « les migrant.es subsaharien.nes » ne peuvent, leur vie durant être soumises à ces épreuves d’errance, de mendicité, de sans-abrisme, de souffrances, de racisme...
Vouées à elles-mêmes, vulnérabilisées par la dépendance à l’autrui, elles témoignent qu’aucune association ou institution ad hoc n’a été susceptible de leur venir en aide ou de les guider vers des instances compétentes en matière de droits des personnes migrantes. Seule l’église catholique leur fournit des réquisitoires médicaux pour les soins à l’hôpital Mohamed V et/ou l’achat de médicaments.
Dans le groupe des quatre femmes, deux exprimaient leur souhait de rentrer chez elles mais ne peuvent le faire, faute de moyens financiers. Dès lors, la responsabilité des institutions, associations, citoyen.nes que nous sommes est engagée et nous devrions l’assumer, l’assurer. La responsabilité de l’Europe l’est tout autant car si elle se mure dans sa forteresse en tentant de « gérer les flux migratoires » et en demandant aux pays de transit de lui servir de bouclier, elle ne peut fermer les yeux sur le sort et la désespérance humaine des centaines de milliers de personnes qui se pressent devant sa porte. Et piétinent sur son seuil durant de longues décennies.
Merci pour vos réactions et/ou suggestions de soutien : fatihasaidi2003@yahoo.fr






















