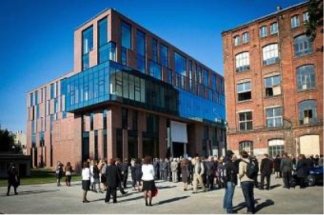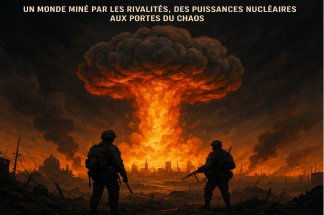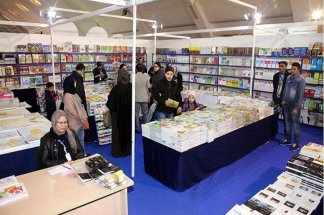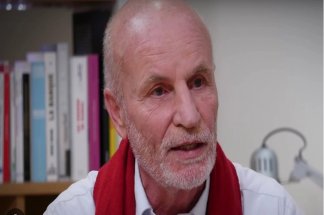chroniques
PJD, RNI et le choc des discours : entre pathos politique et rationalité technocratique - Par Yassir Mekouar

De G à D : Driss El Azami, Abdalilah Benkirane et Abdellah Bouanou - Le modèle discursif du PJD, empreint d’idéologie et de pathos, conserve-t-il encore une efficacité politique ? Et surtout, faut-il opposer ce modèle à une approche plus « instrumentale » du discours politique
À l’heure où le champ politique marocain semble en quête de souffle, le 9e congrès du Parti de la justice et du développement (PJD) ravive, selon Yassir Mekouar, étudiant charcheur, un débat essentiel : faut-il miser sur un discours politique émotionnel et idéologique pour exister, ou adopter une communication plus technocratique, rationnelle et pragmatique ?
Par Yassir Mekouar
Le retour du PJD : un congrès révélateur
Le Parti de la justice et du développement (PJD) a tenu, ce week-end à Bouznika, son 9e congrès ordinaire. L’événement, classique en apparence, a pourtant suscité un regain d’attention médiatique et politique. Ce n’est pas tant le congrès lui-même qui a créé l’événement, mais les débats, parfois acharnés, qui l’ont précédé. Comment évaluer l’héritage du PJD après ses mandats à la tête du gouvernement (2012-2021) ? Comment comprendre sa posture face à la normalisation avec Israël ?
Ces discussions mettent en lumière une problématique plus large : le modèle discursif du PJD, empreint d’idéologie et de pathos, conserve-t-il encore une efficacité politique ? Et surtout, faut-il opposer ce modèle à une approche plus « instrumentale » du discours politique, à l’image du style adopté par le RNI ?
Deux modèles de discours : idéologique vs technocratique
Dans le paysage politique marocain, deux formes de communication s’affrontent.
D’un côté, le discours idéologique, incarné par le PJD. Il mobilise les émotions, recourt aux symboles religieux, aux figures de style, aux slogans, et cherche à établir une proximité affective avec les citoyens. C’est un discours chargé, clivant parfois, qui s’appuie sur un leadership charismatique. Abdalilah Benkirane, fraîchement reconduit à la tête du parti, en est l’exemple emblématique.
De l’autre, un discours technocratique, plus sobre, incarné notamment par le Rassemblement national des indépendants (RNI). Lors de la campagne de 2021, les leaders du RNI affirmaient vouloir « faire sans beaucoup parler », misant sur la mise en œuvre concrète des programmes plutôt que sur la rhétorique. C’est un discours axé sur les résultats, les données, et une communication rationalisée, censée rassurer plutôt que mobiliser.
Cette dichotomie renvoie à des tendances plus globales : une défiance croissante envers les discours populistes en Europe ou en Amérique latine, au profit d’une parole politique technicienne, perçue comme plus responsable et moins manipulatrice.
Dynamisme politique et effet des discours
Peut-on dire que le style du discours influe directement sur la vitalité du champ politique ? En d’autres termes, le discours émotionnel rend-il la scène politique plus vivante, tandis que le discours technique l’endormirait ?
L’exemple du PJD semble donner une réponse provisoire. Malgré une présence institutionnelle réduite, le parti continue de peser dans les débats publics grâce à son discours clivant, capable de susciter des réactions, des controverses, et donc une forme de dynamisme.
Mais ce dynamisme n’est pas toujours synonyme d’adhésion. En parallèle, de nombreuses études pointent le désintérêt croissant des citoyens pour la politique. L’abstention reste forte. La méfiance envers les promesses électorales, les manipulations émotionnelles et les affrontements verbaux mine la confiance envers les élites politiques, qu’elles soient populistes ou technocratiques.
Pour un espace politique pluriel et réformé
Le défi actuel n’est peut-être pas de trancher entre discours émotionnel et rationnel, mais de repenser l’ensemble de l’architecture discursive. L’uniformisation du langage politique, quel qu’il soit, mène à l’ennui et à la défiance. La solution réside sans doute dans la diversification des formes de discours, à condition qu’elles soient accompagnées d’une véritable refondation du contrat politique.
L’ouverture de l’espace public à des formes variées de communication – y compris via les outils digitaux – pourrait contribuer à réconcilier les citoyens avec l’action politique. C’est par l’innovation discursive, la sincérité, et l’inclusion que le champ politique marocain retrouvera du souffle.
Le congrès du PJD est bien plus qu’un rituel partisan. Il soulève une question cruciale : comment parler au peuple aujourd’hui ? À travers quel langage reconquérir la confiance, susciter l’intérêt, provoquer l’adhésion ? L’avenir de la politique marocaine dépendra peut-être moins des programmes que des voix qui les portent – et de la manière dont elles s’adressent à nous.