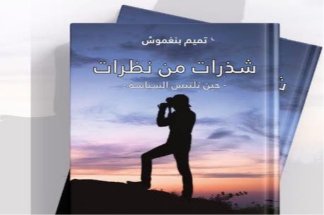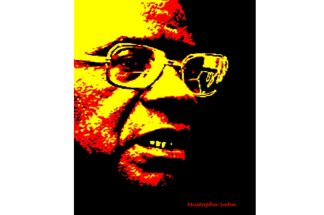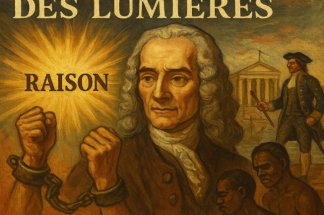Culture
II - …. Le mea culpa de Abdejlil Lahjomri … Les nouvelles heures françaises du Royaume
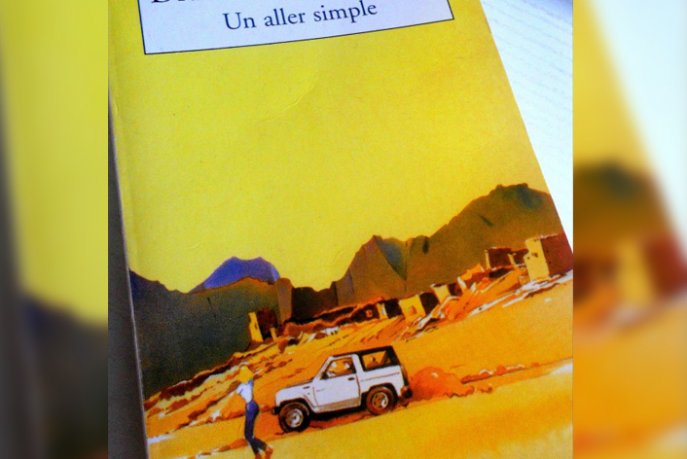
Dans la première partie de ce Mea-culpa, Abedjlil Lahjomri montre « l’évolution de la présence du Maroc dans l’actualité littéraire française […] qui, dès ses premières apparitions, hantait les personnages et leurs créateurs comme un pays de légende, de rêves inquiétant ou bienfaisants, se retrouve aussi dans des écrits, à l’instar d’Un Aller-simple, comme légende, rêve ou cauchemar. » Dans cette deuxième partie, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume évoque la mutation des personnages de cette littérature où le Maroc devient l’instance narrative et acquiert une dimension autrement symbolique, puisque la distance entre l’Autre et soi-même est abolie, abolition qui mène à une confluence insolite, inconfortable » :
èMais, ce ne sont plus les mêmes personnages qui rêvent de ce pays. Au commencement, c’est l’Autre qui s’en trouve obsédé, le découvre comme légende. Dans les récits d’aujourd’hui, c’est le marocain exilé et marginal, qui a peu connu son pays ou ne l’a jamais connu, qui en parle comme d’un rêve, le voyant pour la première fois, comme un étranger pourrait le voir. Ou, plutôt, c’est à la fois le rêve du « Marocain provisoire » et la « légende rêvée » du français dans son mal-être qui fait que le Maroc dans un Aller-simple se situe comme un « entre-deux-rêves » mortellement fascinant.
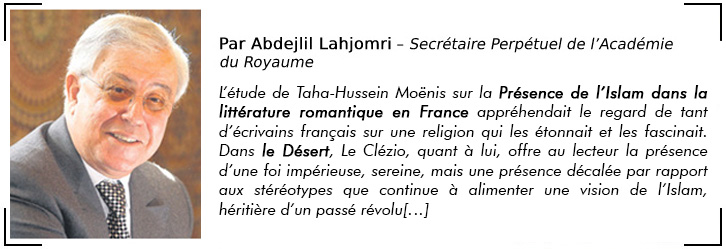
C’est une quête d’une identité perturbée, aussi bien celle de Aziz, le marocain provisoire, que celle de Jean Pierre Schneider, l’assistant humanitaire français, dont la blessure affective va accueillir « la légende d’Irghiz » comme une délivrance.
C’est le roman de « l’entre-deux », de « l’entre-deux pays » : celui du marocain provisoire dont le pays réel est la France et qui découvre « Le Maroc et la légende d’Irghiz », son vrai pays où, étranger, il sera à la recherche d’une identité improbable ; celui du français, déçu par une existence morne et tristement banale, qui s’accroche à une légende, à un pays, qu’il ne découvrira pas, mais qui déclenchera chez lui une telle tempête intérieure, que cette fascination réconciliera avec son enfance, au prix élevé qu’est la mort.
Le Maroc, dans tout cela ?
Dans le Chasseur zéro, Nathalie, venue incidemment du Maroc provoque le récit. Dans Un Aller-simple, ce n’est plus une coïncidence fortuite, un hasard, le Maroc devient l’instance narrative.
Cet aller-simple s’ingénie dans des allers-retours « entre la France et le Maroc-Légende d’Irghiz », entre l’itinéraire d’Aziz et celui de Schneider, un va-et-vient entre deux identités, entre Aziz et Jean-Pierre. Il s’ingénie surtout à faire du Maroc la légende qui lie le dessin de cet étrange couple.
Proche de la mort, Schneider s’éveille à la vie au Maroc, et c’est ce pays qui devient lieu de vie. C’est la légende d’Irghiz, qui accélère sa réconciliation avec l’enfance. C’est cet ailleurs qui le ramène aux racines du départ : c’est la légende qui fait naître la réalité.
Quête de soi à travers l’Autre, un intervalle où le Maroc acquiert une dimension autrement symbolique, puisque la distance entre l’Autre et soi-même est abolie, abolition qui mène à une confluence insolite, inconfortable. La mort de Schneider n’a rien de tragique en soi. Elle renvoie simplement de son pays, la France, une image terne, et par un retournement de situation, une image d’un Maroc lumineux tellement valorisée qu’elle constitue l’essentiel de l’imaginaire de Schneider.
C’est par Aziz, censé être le marocain, que l’entre-deux constitue un intervalle hautement symbolique puisque va surgir ce personnage nouveau, qui commence à hanter l’inconscient français, l’immigré, celui qui n’est « ni marocain, ni français », celui qui va être la composante essentielle de la littérature française relative au Maroc – le marocain provisoire, mais aussi le français provisoire, affublé d’une identité instable.
Et puis, par la magie de l’alchimie romanesque, ces deux personnages, à la fin du récit n’en feront plus qu’un. Une transcendance unique en son genre, puisque Jean-Pierre devient Aziz, et Aziz Jean-Pierre. L’entre-deux disparaît au profit d’un avenir, ouvert à tous les cauchemars.
L’immigré, au bout de ce long et tragique parcours finirait-il par s’insérer dans la société d’accueil et quitter une marocanité fragile, entrevue le temps d’un voyage ? Il ramène le cercueil de Jean-Pierre, s’approprie une identité qui n’est pas la sienne, avec une aisance et une insouciance déconcertantes. Le « je » devient « nous » et l’amour que ce « nous » aura bizarrement pour Agnès, portera en lui toutes les angoisses, toutes les incertitudes.
Le « je » devenu « nous » à la fin du roman de Didier Van Cauwelaert sollicite tous les possibles. L’aller a été simple pour Jean-Pierre Schneider. Pour Aziz, c’est un aller-retour où le retour se veut être la quête d’une insertion qui fera de ce « nous » hybride un nouveau « je », mais un « je » qui risquerait d’être sans âme, sans conscience, le symbole d’une sous-humanité souffrante, marginale, sans identité fixe.
Mais, cela est une autre affaire, le thème d’un autre roman. Un roman qui choisirait d’investir toute cette génération d’immigrés, de déracinés, de ces nouveaux damnés de la terre dont le destin est de vivre un aller-retour entre deux identités brouillées, et qui n’a pas encore été écrit.
Le serait-il qu’il devrait l’être par un de ces héritiers qui représentait cette deuxième génération comme la nomment tous les analystes, tous les médias, génération qui hante les banlieues et les décideurs et qui exprime son malaise, en des manifestations sporadiques et violentes, en des chansons rugueuses et rappeuses. Elle ne s’exprime pas encore dans une littérature libératrice de ses tensions et de ses frustrations, parce qu’elle est actuellement beaucoup plus objet d’étude que de sollicitude.
L’image n’est plus celle d’un pays, d’une société étrangère. Elle devient un élément constitutif d’une image de soi-même, puisque cette deuxième génération, qui porte en elle l’Orient, sa culture, sa religion, ses coutumes devient partie prenante du paysage quotidien de la France, devient, je crois, avec ce problème de la nationalité, une dimension d’une France devenue diverse.
Une image de l’Autre, d’abord lointaine, obsédante, mais attirante, devient, dès lors que l’histoire s’en est mêlée, un élément constitutif d’une culture devenue elle-même plurielle.
Dans un registre qui réactualise le type d’appropriation de la présence du Maroc dans les lettres françaises déjà rencontré chez François Bonjean et ses Confidences d’une fille de la nuit, il y a les publications de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, incontournables tant cette présence est forte et fascinante.
Dans la traduction que Mohamed Berrada a faite, avec bonheur, de la première nouvelle de Printemps et autres saisons de Le Clézio, l’auteur fait le récit de l’itinéraire d’une jeune marocaine Saba, qui s’appelle aussi Libbie, et qui, entre Saba et Libbie, ne sait plus qui elle est, où elle est, mais vit dans la nostalgie de ce qu’elle fut. Je me suis dit, après cette lecture, que si j’avais une traduction à faire, je choisirais dans la riche production de Le Clézio, son roman Désert qui, par sa densité émouvante et son ampleur, ne pouvait laisser indifférent tout lecteur attentif aux fluctuations de la représentation marocaine dans la littérature française.
Ce récit introduit d’emblée le lecteur dans un univers riche d’émotions, de spiritualité, dans une alternance entre l’évocation d’un passé épique et la déception d’un présent douloureusement pathétique. Puisqu’elle se présente comme un roman dans le roman, je n’aurais choisi de traduire que l’évocation des contes du passé qui submergent Lalla, au point que, dans son « exil français », « les Ancêtres redoublent de férocité » comme le disait Kateb Yacine, elle quittait brusquement la France, pour retrouver son Désert, la légende des hommes bleus, se réconciliant avec elle-même.
J’aurais traduit cette longue marche des tribus, leur remontée vers le nord fuyant l’oppression coloniale. J’aurais traduit la dignité de ces hommes, leur solitude, leur courage. J’aurais traduit la force de la séance du dikr. J’aurais choisi de traduire le regard de l’enfant Nour, regard lumineux, puis « Nour » veut dire lumière, et que, pour lui, le désert est d’abord présence lumineuse. Au-delà de la souffrance, c’est cette puissance de la lumière qui s’imposera à lui, comme elle s’imposera plus tard à Lalla, lui rappelant à chaque instant que sa civilisation est née de la lumière de Désert, qu’elle porte en elle comme un joyau incandescent.
Comme nous l’avions signalé au début de livre, l’étude de Taha-Hussein Moënis sur la Présence de l’Islam dans la littérature romantique en France appréhendait le regard de tant d’écrivains français sur une religion qui les étonnait et les fascinait. Dans le Désert, Le Clézio, quant à lui offre au lecteur la présence d’une foi impérieuse, sereine, mais une présence décalée par rapport aux stéréotypes que continue à alimenter une vision de l’Islam, héritière d’un passé révolu, et que ce texte neutralise, à lui seul. Cette présence, comme vécue de l’intérieur, donne à voir une transcendance spirituelle qui fait de la foi de Lalla l’exemple même des vertus qu’enseigne l’Islam aux plus humbles et aux plus démunis, et que ce récit rappelle souverainement à une conscience versatile.