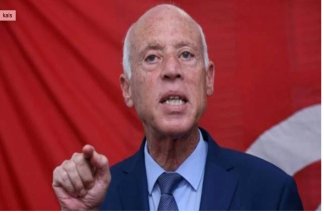chroniques
Ce que recèlent les déclarations de Trump sur le déplacement des Palestiniens - Par Bilal Talidi

Des Palestiniens déplacés marchent sur une route boueuse au milieu des destructions à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 6 février 2025. (Photo Bashar TALEB / AFP)
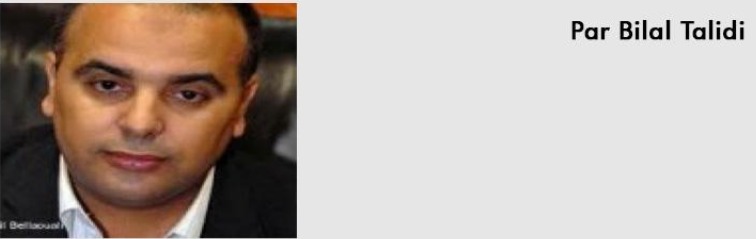
Lors d'une conférence avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, Donald Trump a annoncé de but en blanc que « les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza ». Il n’a pas caché que son administration exerce une pression importante sur les pays arabes pour qu’ils accueillent les habitants de Gaza et financent leur installation permanente loin de leur terre d’origine. Il a notamment mentionné la Jordanie et l’Égypte, bien que ces deux pays aient catégoriquement refusé l’idée de déplacer les Palestiniens de leur territoire.
Lorsqu'on a demandé à Trump si les Palestiniens auraient le droit de retourner à Gaza, il a précisé sa vision en déclarant que « la solution des colonies alternatives dissuadera les Palestiniens de vouloir revenir et mènera à la paix au Moyen-Orient ».
Les déclarations de Trump recèlent une énigme
Plus d'une semaine avant cette déclaration, s’adressant directement au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et au roi jordanien Abdallah II, le président américain avait déjà exhorté l’Égypte et la Jordanie à accueillir les Palestiniens déplacés de Gaza. Il a tenté de justifier cette demande en arguant que les États-Unis avaient aidé ces deux pays par le passé, laissant entendre que l’aide américaine, qu’elle soit militaire (pour l’Égypte) ou à la fois militaire et économique (pour la Jordanie), serait désormais conditionnée par leur rôle dans le règlement de la question de Gaza selon la vision américaine.
Comparées aux déclarations officielles de l’Égypte et de la Jordanie, qui ont refusé tout déplacement de population, ainsi qu’aux déclarations saoudiennes qui rejettent toute normalisation sans l’application de la solution à deux États et la création d’un État palestinien sur les frontières de 1967, les affirmations de Trump constituent une énigme. S’agit-il simplement d’une pression exercée sur les pays arabes ? D’une tentative de séduire l’extrême droite israélienne pour éviter l’éclatement du gouvernement avant la mise en œuvre de l’accord ? Ou bien cette initiative reflète-t-elle un plan sérieux de la nouvelle administration visant à revoir la vision américaine du Moyen-Orient, qui a perduré pendant plus de cinquante ans ? D’autant plus que Trump parle de Gaza comme d’une future « Riviera du Moyen-Orient » sous contrôle américain.
De nombreux analystes tentent d’interpréter ces déclarations en se basant sur la personnalité de Trump, son mode de pensée extravagant, son obsession pour l’argent, les affaires et les grands projets d’investissement. Ils soulignent qu’il aborde la politique avec la mentalité d’un homme d’affaires, augmentant la pression et élevant les exigences afin d’amener les parties concernées à céder à ses demandes implicites. Pour appuyer cette analyse, ils citent ses positions sur le Mexique et les pays d’Amérique latine (notamment la Colombie) concernant l’immigration, ainsi que ses fortes pressions sur le Canada et le Danemark.
Cependant, la situation à Gaza est bien différente. Sur le terrain, la résistance palestinienne a combattu l’armée israélienne pendant quinze mois, contraignant finalement Israël à conclure un accord que la plupart des Israéliens ont perçu comme une humiliation pour l’État hébreu. Comment alors les États-Unis oseraient-ils répéter cette expérience dans une région totalement dévastée, en y envoyant des milliers de soldats qui ne connaissent pas le terrain ? D’autant plus que les habitants de Gaza n’ont plus rien à perdre : ils ont perdu leurs maisons, leurs enfants, leurs proches, ainsi que toute possibilité d’une vie digne depuis presque un an et demi.
Le seul élément qui pourrait justifier ce plan insensé serait que les États-Unis aient identifié dans Gaza et sa mer une immense richesse, qui justifierait le sacrifice de milliers d'Américains pour en prendre le contrôle. Il existe donc un grand mystère autour des motivations réelles de Trump lorsqu'il évoque Gaza comme la « Riviera du Moyen-Orient ». Cette vision pourrait être liée à une richesse énergétique massive en mer Méditerranée, que les États-Unis jugeraient inaccessible tant que les Palestiniens occupent Gaza, en particulier sa partie nord. C'est dans cette optique que la stratégie des généraux israéliens visant à vider Gaza aurait été mise en place, mais celle-ci a échoué.
Les lectures possibles de la sortie de Trump sur Gaza
Cette analyse est solide, mais elle est troublée par le fait que Donald Trump a exercé une forte pression pour conclure l’accord entre le Hamas et Israël. Cet accord ne porte pas seulement sur l’échange de prisonniers, mais aussi sur des aspects humanitaires et de reconstruction. Il est certain que les factions de la résistance palestinienne ne feront aucun pas en avant lors des deuxième et troisième phases de l’accord sans obtenir un cessez-le-feu définitif et la levée du blocus. Lorsque l’accord atteindra le stade d’échange des hauts gradés militaires, son prix sera sans aucun doute très élevé.
L’émissaire de Trump, Steve Witkoff, lors de sa visite à Tel-Aviv, a transmis un message clair à Israël : Donald Trump souhaite une mise en œuvre totale du cessez-le-feu avec le Hamas, ainsi qu’un règlement des différends politiques et sécuritaires pour atteindre cet objectif. Il n’a fait aucune déclaration contredisant cette position, ni laissé entendre que l’accord ne serait pas appliqué dans ses trois phases. La seule nouveauté qu’il a introduite, coïncidant avec la visite de Benyamin Netanyahou à Washington, concerne une demande de révision de certaines clauses, notamment celles de la troisième phase. L’argument avancé est que cet accord a été conclu sous l’administration précédente et que la reconstruction de Gaza en cinq ans est irréaliste.
Alors que Trump déclarait à l’occasion de sa rencontre avec le président israélien qu’il n’avait aucune garantie quant à la viabilité de l’accord, son émissaire, à qui Trump a passé la parole, a affirmé que la situation était sous contrôle et que l’application du cessez-le-feu se poursuivait avec l’engagement de toutes les parties.
En réalité, le doute exprimé par Trump sur la solidité de l’accord, ainsi que les propos de son émissaire sur la nécessité de modifier certaines clauses, notamment lors de la deuxième phase, peuvent indiquer une volonté de renoncer à l’accord après qu’Israël ait obtenu la libération d’un grand nombre de ses prisonniers lors des deux premières phases. Cela signifierait que le compte à rebours de la mise en œuvre du plan de Trump commencerait à la fin de la deuxième phase. Mais un obstacle majeur demeure : la fermeté des factions palestiniennes dans les négociations. Ces dernières pourraient interpréter les signaux américains et israéliens comme une incitation à ne pas miser tous leurs atouts sur la deuxième phase, et à renforcer leur position pour la troisième.
Une seconde lecture de la situation est également possible. Donald Trump sait que le président israélien est venu à Washington avec des moyens de pression explicites. Netanyahou risque de perdre son gouvernement à cause des positions de l’extrême droite, et il menace de ne pas poursuivre l’application de l’accord ni d’aller à la deuxième phase, à moins d’obtenir de Trump des garanties pour l’éradication du Hamas – une mission dans laquelle l’armée israélienne a échoué. C’est pourquoi Trump tenterait de séduire l’extrême droite israélienne en élevant encore davantage le niveau de leurs attentes : il ne veut pas seulement détruire le Hamas et garantir la sécurité d’Israël, mais il veut également faire disparaître complètement Gaza, en dispersant ses habitants entre la Jordanie et l’Égypte. C’est dans cette optique qu’il affirme que ces deux pays accepteront son plan, gagnant ainsi du temps pour achever la mise en œuvre des autres phases de l’accord, ce qui pourrait finalement mener à l’éviction de Netanyahou et de son gouvernement.
Cette hypothèse est crédible, et elle est étayée par le fait que toute la pression exercée par Trump sur l’Égypte et la Jordanie vise à les contraindre à gérer Gaza après la troisième phase de l’accord. Or, presque tous les pays arabes ont refusé de s’impliquer dans ce bourbier.
Trump veut réellement réaliser une partie de son plan insensé, mais pas en recourant à une occupation militaire directe qui l’obligerait à affronter les factions palestiniennes. Il préfère passer par une force arabe, principalement égyptienne et jordanienne, avec peut-être la participation d’autres pays, afin de pacifier la bande de Gaza et de permettre l’exploitation des ressources énergétiques stratégiques qu’elle recèle.
D’un point de vue politique, sécuritaire et stratégique, l’Égypte ne peut accepter le plan de déplacement forcé de Trump, car cela compromettrait totalement sa sécurité nationale et exposerait le Sinaï comme prochaine cible après Gaza. Quant à la Jordanie, la situation serait encore plus critique : accepter ce plan signifierait que la Cisjordanie serait la prochaine étape, ce qui bouleverserait complètement la démographie jordanienne en faisant des Palestiniens une écrasante majorité, une perspective inacceptable sur le plan stratégique, sécuritaire et politique.
En l’absence d’informations détaillées sur ce plan fou – ou supposé tel – de Trump, la seconde lecture semble plus cohérente et moins contradictoire que la première.