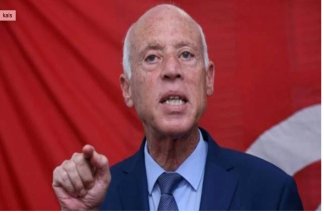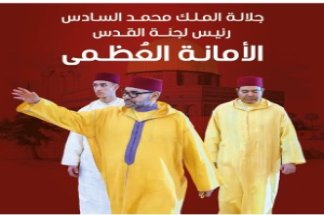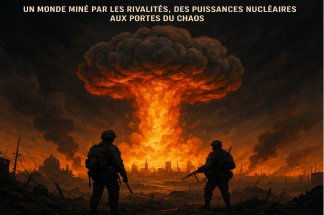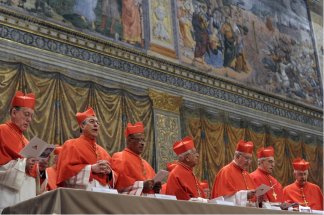International
Les trois grands et les leçons de l’histoire - Par Samir Belahsen

Churchill, Roosevelt et Staline à la conférence de Yalta 4 -11 février 1945
À l’heure où le monde vacille à nouveau, les leçons de Yalta et de l’alliance improbable entre Staline, Roosevelt et Churchill Samir Belahsen rappelle que le pragmatisme peut l’emporter sur l’idéologie, sans jamais en effacer les tensions.

“Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun.”
Stéphane Hessel / Indignez-vous !
“Ecrire l’Histoire, c’est foutre la pagaille dans la Géographie.”
Daniel Pennac
80 ans après la fin de la deuxième guerre, jetons un regard sur quelques-uns de ses aspects ! Espérons y trouver quelques éclairages à ce moment de bascule géopolitique !
L'histoire n’est-elle pas la philosophie enseignée par l'exemple comme le disait Denys d’Halicarnasse ?
Les trois grands de la Seconde Guerre mondiale - Staline, Roosevelt et Churchill - partageaient l'objectif commun de vaincre l'Axe, face auquel ils se sont trouvés réunis, leurs visions et intérêts restaient nettement divergents.
Ils cherchaient à coordonner leurs efforts, principalement, militaires pour écraser l'Allemagne nazie et mettre fin à la guerre.
Réunis en conférences comme celle de Yalta en février 1945, ils se sont forcés à collaborer pour organiser l'après-guerre. Ils voulaient tous assurer une « paix durable ». Ils ont notamment décrété la division de l'Allemagne en zones d'occupation et la création de ce machin : l'ONU.
Staline tenait à établir une zone d'influence en Europe de l'Est comme glacis protecteur, espace vital pour l'URSS, il voulait aussi d'importantes réparations.
Churchill, l’anticommuniste, craignait avant tout l'expansion soviétique en Europe centrale et la fin annoncée de la puissance britannique et de son empire colonial.
Roosevelt affaibli par la maladie, nous dit-on, cherchait à construire un nouvel ordre mondial fondé sur le droit international et la coopération organisée (ONU), il était, parait-il, plus enclin à comprendre Staline que Churchill, espérant maintenir l'alliance et faire de bonnes affaires dans la paix.
Il partageait avec Staline un certain pragmatisme, Churchill était plus méfiant quant aux ambitions soviétiques, ce qui créa des tensions.
C’est dire que, malgré les sourires, l'alliance de ces trois grands leaders était en fait une coalition de circonstances, un vrai choc de systèmes politiques. Le Nazisme était capable de réunir le Bolchevisme, la démocratie libérale et l’impérialisme britannique. L’union des trois personnalités contre un ennemi commun restait marquée par des visions géopolitiques opposées.
La convergence USA-URSS
Quels éléments ont permis l’alignement entre les intérêts américains et soviétiques malgré le fossé idéologique qui les séparait ?
Il y avait d’abord cette volonté commune d’écraser l’Allemagne nazie et de mettre fin à la guerre rapidement pour établir le nouveau monde partagé en zones d’influence : Une Europe occidentale sous influence américaine et une Europe de l’Est sous influence soviétique. Avec les termes d’aujourd’hui, on peut parler de concordance des intérêts stratégiques des deux camps.
Pour stabiliser durablement le système, les deux forces ont convenu de la création d’une organisation internationale de maintien de la paix, l’ONU, à laquelle les deux parties adhéraient et qu’elles se sont assurées de maitriser.
Elles ont aussi convenu de la division de l’Allemagne en quatre zones d’occupation - États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France - et du partage de Berlin. Loin de l’Europe, le Pacifique, les USA avaient demandé l’engagement de l’URSS à entrer en guerre contre le Japon.
Le pragmatisme a donc permis à Roosevelt et Staline de s’entendre.
80 ans après ?
80 ans après la deuxième guerre, alors que nous vivons un moment de bascule géopolitique, quels éclairages ?
La coopération pragmatique entre grandes puissances rivales est possible, elles y trouvent le moyen d’atteindre leurs objectifs aux moindres couts. Elle est possible mais elle reste fragile.
En oubliant les visions idéologiques opposées, des compromis peuvent être trouvés face à un enjeu commun jugé majeur. La fragilité s’est révélée rapidement, la méfiance a laissé place à la Guerre froide. Les arrangements temporaires peuvent couver des injustices et donc des rivalités futures.
Les grands compromis géopolitiques ont souvent des conséquences durables or les rapports de force varient et les outils qui peuvent être efficaces et suffisants peuvent s’avérer quelques années plus tard caducs et inopérants.
La création de l’ONU à Yalta avait illustré l’importance d’institutions multilatérales comme moyens de prévention des conflits. Renforcer la coopération internationale reste un défi crucial dans un monde multipolaire et “rénover le machin” est devenu une urgence…
La réforme du Conseil de sécurité pour qu’il reflète mieux les nouvelles réalités géopolitiques, en intégrant de nouvelles puissances émergentes, n’est pas la seule idée proposée.
Il y a lieu aussi de renforcer le multilatéralisme et la coopération internationale en s’appuyant sur des pactes globaux comme le Pacte pour l’avenir, pour mieux traiter les défis globaux concernant le climat, la santé, la paix et les inégalités.
Une autre exigence réside dans la simplification des structures de l’organisation, en déléguant davantage de pouvoirs aux coordonnateurs locaux et surtout en passant d’une culture du processus à une culture du résultat, afin d’améliorer la rapidité et l’impact de ses actions sur le terrain. Il s’agit de donner à l’organisation efficacité, légitimité et inclusivité.
La rénovation de l’ONU devrait, si l’on y arruve, combiner une réforme institutionnelle profonde, une meilleure représentativité géopolitique, une gestion plus agile et plus efficace et un engagement renforcé en faveur du multilatéralisme inclusif.
L’histoire éclaire les tensions actuelles ; la paix durable exige un équilibre entre la recherche des voies de dialogue, la coopération pragmatique, le respect des engagements et la construction d’un ordre international juste.