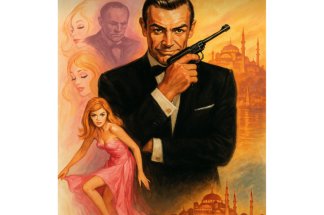International
L’Algérien et les États du Sahel : ‘’une profondeur stratégique’’ en rupture - Par Hassan Zakariaa

Le président de la Transition malienne le colonel Goïta et le président algérien Abdelmadjid Tebboune, un torchon qui brûle chaque jour un peu plus
Tensions croissantes, accusations d’ingérence, alliances bouleversées : l’Algérie et les pays du Sahel redessinent la carte fragile de l’Afrique de l’Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso resserrent leur alliance au sein de l’AES et se détournent chaque jour un peu plus de leurs anciens partenaires. Hassan Zakariaa revient sur une Algérie qui, confrontée à des accusations d’ingérence, des rivalités régionales exacerbées et une recomposition géopolitique aux frontières de plus en plus fermes, voit vaciller son influence au Sahel où elle vient de répliquer par la rappel de ses ambassadeursÒ et la fermeture de son espace aérien au Mali.
Par Hassan Zakariaa
Le 6 avril 2025, une rupture de plus s’est produite au cœur du Sahel : cette fois-ci les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) — le Mali, le Niger et le Burkina Faso — ont rappelé de leurs ambassadeurs en poste à Alger pour consultation. Ce rappel collectif sans précédent est un geste fort, destiné à protester contre la destruction d’un drone militaire malien par la défense aérienne algérienne, est nouvel épisode d’une détérioration constante des relations entre l’Algérie et ses voisins sahéliens.
Autrefois considérée comme un médiateur incontournable dans les crises du Sahel, l’Algérie se retrouve aujourd’hui marginalisée et accusée par ses voisins du Sud. La crise actuelle Ò-Ò-met ainsi en lumière une profonde recomposition géopolitique au Sahel, marquée par le rejet des anciens partenaires occidentaux, l’émergence de nouveaux soutiens comme la Russie et les Émirats, et la montée d’un souverainisme qui isole Alger accusé d’être de mèche avec une partie des milices jihadistes dans la région.
Aux origines de la Tension
Les tensions entre l’Algérie et les pays de l’AES trouvent leur source dans les soupçons de plus en plus avérés d’une manipulation algérienne des groupes terroristes, et d’une protection démontrée des mouvements séparatistes du nord du Mali, en vue d’entretenir l’insécurité et l’instabilité dans un espace qu’elle compte mettre sous sa coupe dans son ambition d’être effectivement, en symétrie avec ce qu’est l’Afrique du Sud pour la partie australe du continent, l’Etat-pivot de cette partie qui va du nord à l’ouest.
Le retrait contraint de la France, et les menées de plus en plus patents de l’Algérie de s’y substituer ont conduit à la rupture de l’Accord de paix d’Alger, signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Par cet accord, Alger avait réussi à s’imposer comme une ‘’puissance de médiation’’, supposée apporter la paix dans un contexte d’instabilité chronique. La dénonciation de cet accord par Bamako, début 2024, a été vécue comme une humiliation à Alger, qui en avait fait le symbole et l’outil de son influence régionale.
Mais les désaccords vont bien au-delà. L’arrivée au pouvoir des militaires à Bamako, Ouagadougou et Niamey, et leur décision de rompre avec la France, de se rapprocher de la Russie via le groupe paramilitaire Wagner, et de ne pas obtempérer aux injonctions de la CEDEAO, au point de ne pas souhaiter la réintégrer, ont radicalement changé la donne. La création de l’Alliance des États du Sahel en septembre 2023 a consolidé un axe militaire et souverainiste qui considère désormais l’Algérie non plus comme un allié, mais comme un obstacle à ses projets.
Des accusations d’ingérence et une hostilité croissante
Le climat s’est considérablement tendu depuis fin 2023. Alger est désormais ouvertement accusé par les autorités maliennes d’ingérences dans les affaires internes du pays. Le ton a encore monté en avril 2025, lorsque Bamako a dénoncé une action hostile préméditée de l’Algérie après la destruction d’un drone malien à proximité en territoire. Pour le gouvernement malien, cet acte constitue une agression, preuve de la posture « condescendante et inamicale » d’Alger.
Les accusations ne s’arrêtent pas là. Le Mali reproche aussi à l’Algérie d’entretenir des relations troubles avec certains groupes armés touaregs du nord, et de fermer les yeux sur les activités de figures jihadistes à l’instar d’Iyad Ag-Ghali, dirigeant du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda. Selon le journal français Le Monde du 6 octobre 2016, la France l’aurait eu dans sa mire, au sens propre, avant de le laisser disparaitre dans la nature sur insistance algérienne qui s’était engagée à ‘’en faire son affaire’’. Depuis, il court toujours.
Un isolement diplomatique croissant
L’influence croissante du Maroc dans cet espace et sa politique de la main tendue aux Etats du Sahel en accueillant fin 2023 les dirigeants de l’AES à Marrakech pour discuter d’un projet d’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, a été tout aussi mal vécu que l’incapacité d’Alger à rester l’interlocuteur privilégié de ces pays, si ce n’est l’unique. Voyant des complots partout, l’Algérie accuse tour à tour quand ce n’est pas en même temps, Israël, le Maroc, la France, les Émirats, la Turquie sans écarter son allié pourtant historique, la Russie, de manœuvre destinée à l’isoler et à affaiblir son rôle régional. Il n’y a que Washington et son Africa com qui échappent à la complotite d’Alger.
L’attitude de pays traditionnellement proches comme la Russie ou la Turquie, les actions du groupe Wagner au Mali, l’aide militaire d’Ankara (notamment via des drones Bayraktar TB2), et la coopération sécuritaire entre les pays de l’AES et ces acteurs, se font naturellment aux dépens des projets du pouvoir algérien pour la région.
Si bien que la diplomatie d’Alger est aujourd’hui sans boussole dans un espace sahélien qui cerne au sud plus de 2300 Km de ses frontières, 1 376 kilomètres avec le Mali et 956 avec le Niger. Incapable de se remettre en cause et de s’adapter à la nouvelle dynamique de ses voisins, Alger ne peut qu’assister dans l’agitation à la reconfiguration du Sahel, pour l’instant sans elle.
L’ombre du terrorisme et les ambiguïtés algériennes
La lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne reste l’un des sujets les plus sensibles dans les relations entre l’Algérie et l’AES. Alger revendique une approche fondée quasi exclusivement sur l’intervention sécuritaire, à travers des structures comme le Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc). Mais cette posture est aujourd’hui remise en cause et Bamako a récemment quitté cette structure.
Au Mali, on accuse désormais l’Algérie de duplicité, dénonçant ses contacts avec des mouvements jihadistes dans le nord du pays. Ces affirmations discréditent l’Algérie dans la guerre contre les groupes terroristes, sachant qu’historiquement le terrorisme s’est propagé au pays du Sahel depuis ce pays dont les services ont toujours entretenu des relations d’infiltration et de manipulation de ces groupes, sur le modèle du ce qu’ils faisaient avec le Groupe Islamique Algérien (GIA) qui a prospéré lors de la décennie noire en Algérie (1992-2000).
Des perspectives sombres
Le divorce entre les pays de l’AES et l’Algérie semble consommé, alimenté par des intérêts stratégiques divergents, une défiance croissante, et un enchevêtrement d’alliances contradictoires. L’Algérie devra faire un choix : maintenir son désordre actuel ou opérer un réajustement diplomatique pour renouer avec une influence aujourd’hui érodée.
En Algérie et dans certains pays africains, certains aimeraient assister à une relance du dialogue, de préférence à travers des médiateurs africains. Mais l’Algérie fidèle à sa tradition a réagi par un virulent communiqué bien exprimant sa "consternation". Elle également rappelé ses ambassadeurs au Mali et au Niger et différé l’entrée en fonction de son représentant au Burkina Faso. Alger a également annoncé la fermeture totale de l'espace aérien avec le Mali. Ce qui fait dire aux plus optimistes que la tension croissante autour des frontières verra surgir des incidents autrement plus graves dans un Sahel où la seule certitude est qu’il est traversé par des lignes de fracture géopolitiques inédites.