National
La question du Sahara dans la déclaration conjointe Macron –Tebboune... Par Abdelhamid Jmahri

Tebboune a tenté de convaincre les Algériens – et de se convaincre lui-même – que « l’autonomie est une idée française, et non marocaine », signifiant ainsi en filigrane qu’il ne saurait s’opposer à une idée de la France…
La déclaration conjointe entre Macron et Tebboune, évoquant un « dialogue équilibré » et la « légitimité internationale », essaye de raviver la question du Sahara sans jamais la nommer. Si Tebboune tente de minimiser la position française en faveur du plan marocain d’autonomie, la réalité diplomatique montre une Algérie contrainte de composer avec un nouveau rapport de forces... sous le plafond de la souveraineté marocaine. Une analyse de Abdelhamid Jmahri
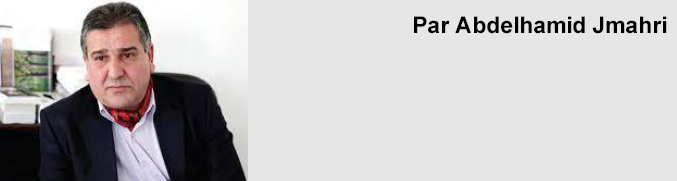
L’expression « retour à un dialogue équilibré entre les deux pays en tant que partenaires et acteurs majeurs en Europe et en Afrique, pleinement engagés à respecter la légitimité internationale ainsi que les objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies », dans la déclaration conjointe suite à l’entretien téléphonique entre les présidents algérien et français, semble faaire écho, comme un reflet, aux propos tenus par Abdelmadjid Tebboune lors de son entretien périodique avec les médias algériens, à propos de la question du Sahara marocain. Il avait déjà déclaré que « la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ne dérange pas l’Algérie », ajoutant : « le sujet dérange l’ONU, pas nous ». Il avait même précisé ailleurs que « cette reconnaissance gêne la légitimité internationale, pas l’Algérie ».
Une clarification nécessaire
On pourrait interpréter la formule utilisée dans la déclaration conjointe comme une réaffirmation de cette position algérienne. Pourtant, elle demeure vague, voire évidente au point d’en devenir aveuglante.
Premièrement, toutes les relations internationales s’appuient sur le respect de la légitimité internationale et sur les principes de la Charte des Nations Unies. C’est une règle générale dans les relations entre États, d’autant plus lorsqu’ils sont membres de l’organisation internationale mentionnée.
Deuxièmement, l’Algérie, qui s'auto-proclame depuis longtemps comme "gardienne" du droit international, sait mieux que quiconque que ce droit constitue avant tout un "modus vivendi", sinon une méthode d’action, soumise aux rapports de force sur le terrain. C’est ce qui garantit la légitimité des États à défendre leur intégrité territoriale et protéger leurs peuples.
Troisièmement, c’est Abdelmadjid Tebboune lui-même qui a reconnu dans son entretien avec le quotidien français L’Opinion que la France est « la protectrice de la légitimité internationale », ce qui implique qu’elle en a une meilleure compréhension que lui. Sa position sur le Sahara et sur la souveraineté du Maroc découle, même si tardivement, de cette légitimité internationale fondée sur le droit historique.
Quatrièmement – et c’est le plus important – aucune mention, même implicite, n’a été faite dans la déclaration conjointe au sujet du Sahara, alors même que cette question a été à l’origine du conflit aigu entre les deux pays, provoquant une crise sans précédent entre Paris et Alger. Le simple fait de ne pas l’évoquer constitue en soi une position claire : ce n’était pas un sujet abordé dans les discussions.
Ce point ne doit pas être négligé dans l’analyse du communiqué ni dans la lecture de l’évolution de la situation relative au Sahara, d’autant plus qu’à quelques jours de sa visite à Alger, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot a rappelé à l’Assemblée Nationale française la position claire de son pays : “il y a quelques mois, nous avons exprimé notre vision du présent et de l’avenir du Sahara occidental qui s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, en conséquence directe du plan d’autonomie marocain. Il n’y a pas aujourd’hui d’autres solutions réalistes et crédibles ».
Sous le plafond de la souveraineté marocaine sur le Sahara
Tebboune a tenté de convaincre les Algériens – et de se convaincre lui-même – que « l’autonomie est une idée française, et non marocaine », signifiant ainsi en filigrane qu’il ne saurait s’opposer à une idée de la France… surtout dans une position conjointe avec elle !
Il apparaît donc naturel qu’il laisse à la France le soin d’apprécier cette question, ce qui, in fine, renforce la position marocaine, soutenue par Paris.
En d'autres termes, il tente de justifier son échec à faire reculer la France en prétendant lui « céder » la question de l’autonomie, afin de ne pas paraître avoir été contraint à le faire… au profit du Maroc !
Il est utile de rappeler ici que la diplomatie algérienne évolue aujourd’hui « sous le plafond de la souveraineté marocaine sur le Sahara ». Il convient également de souligner que la partie qui devrait revoir son attitude vis-à-vis de la légitimité internationale, c’est bien l’Algérie elle-même, que ce soit en ce qui concerne les critères de règlement, la participation aux tables rondes, ou la nécessité de cesser d’attiser les tensions dans la région nord-africaine et le bassin méditerranéen.
N’est-ce pas elle qui initie des brouilles avec les États qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara, à l’instar de ce qu’elle a fait avec Madrid ou Paris ?
C’est donc à elle qu’il revient de respecter la légitimité internationale et d’entrer dans une nouvelle phase dans la gestion de ce dossier. Pourquoi ne pas envisager un changement de cette approche, en l’alignant sur la dynamique internationale, notamment dans l’espace euro-méditerranéen et avec l’Union européenne, avec laquelle elle souhaite établir un nouveau partenariat avancé – avec l’aide de la France ?
Qui sait ?
Le Maroc, lui, n’a jamais dicté à la France ce qu’elle devait faire. Il a simplement gardé son prisme national sans excès, laissant à Paris la liberté de son choix. Et la France a choisi – pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à l’autre partie ou à l’évolution de leur relation – de s’inscrire dans le sens de l’Histoire !
Personne au Maroc – ni les décideurs ni les élites – n’ignore que la France a les yeux tournés vers l’Algérie, et qu’il est dans la logique du jeu géostratégique qu’elle cherche à « capter » l’Algérie. Elle l’a d’ailleurs souvent fait en jouant de la carte de sa relation avec le Maroc !
Le Maroc, fort de plus d’un demi-siècle de mutations, sait que bien des choses ont changé dans cette ancienne Afrique française du Nord, et que cette région ne répond plus aux mêmes logiques d’autrefois. Il a lui-même contribué à modifier les paradigmes géopolitiques de la zone.
L’un des faits marquants est que l’histoire commune des trois pays (Maroc, Tunisie, Algérie) n’implique pas nécessairement une même vision de la part de la France, ni un même attachement émotionnel.
La logique – si elle devait prévaloir et si Abdelmadjid Tebboune n’est pas « mis à l’écart » par ceux qui détiennent le véritable pouvoir – voudrait que la réconciliation de l’Algérie avec l’Espagne et la France (qu’elle a affrontées en raison de leur position souveraine sur le Sahara) soit le point de départ d’une révision de la nature de l’agression menée contre le Maroc, et la fin de ses séquelles.
Elle devrait aller jusqu’à intégrer les données du réel, en répondant à la main tendue par le Roi du Maroc. Un rêve qui semble aujourd’hui lointain, mais l’accumulation de signaux positifs allant dans le bon sens pourrait éclairer ceux qui ne voient pas encore… et rectifier le regard. Qui sait ?





















