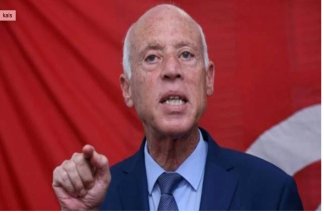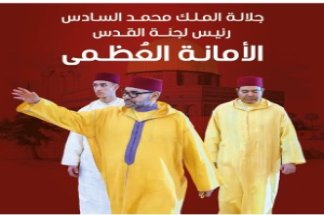International
Sous terre, la mort et l'or des oubliés – Par Hatim Betioui

Connus localement sous le nom de Zama Zama, ce qui signifie « ceux qui essaient », représentent une large frange de marginalisés et de chômeurs, poussés par la pauvreté et l’absence d’alternatives à risquer leur vie
Dans plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud, des milliers de personnes marginalisées s’aventurent dans des mines abandonnées, à la recherche d’or. Connus sous le nom de Zama Zama, ils creusent sans sécurité, sous le joug de gangs, dans un vide économique et légal où l’or devient autant une promesse de survie qu’un piège mortel. Hatim Betioui raconte leur survie, mais aussi, souvent, synonyme de mort.
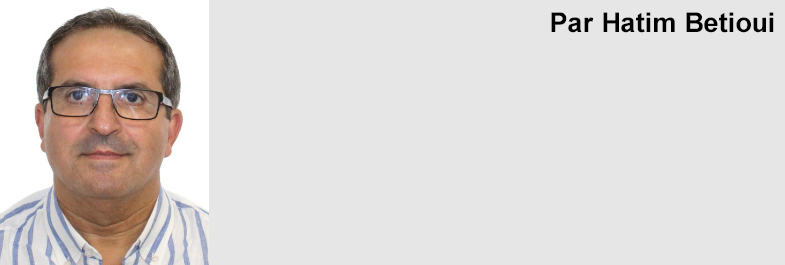
Plusieurs pays africains, au premier rang desquels l’Afrique du Sud, connaissent une montée du phénomène de l’exploitation minière illégale dans des mines abandonnées. Des milliers de chercheurs d’or s’installent dans d’anciennes excavations laissées par les grandes entreprises, transformant ces lieux en espaces de survie dans un contexte social et économique en crise.
Au péril de leurs vies
Ces individus, connus localement sous le nom de Zama Zama, ce qui signifie « ceux qui essaient », représentent une large frange de marginalisés et de chômeurs, poussés par la pauvreté et l’absence d’alternatives à risquer leur vie dans des galeries non sécurisées, qui se transforment souvent en tombes collectives en cas d’éboulement ou de catastrophe soudaine.
Rien qu’en Afrique du Sud, les estimations font état de plus de six mille mines abandonnées, vestiges de siècles d’exploitation intensive de l’or et du charbon. Après le retrait des grandes entreprises pour des raisons économiques et environnementales, ces mines ont été laissées sans surveillance ni protection, devenant la cible de bandes criminelles qui exploitent la misère des pauvres et gèrent une activité parallèle hors de tout contrôle officiel.
Le tournant décisif dans ce secteur est survenu en 2002, lorsque le gouvernement a adopté une nouvelle loi dans le cadre de la politique de « large autonomisation économique des Noirs », visant à corriger les injustices du passé en offrant davantage d’opportunités aux citoyens noirs dans le secteur minier. Mais cette loi a aussi entraîné un désengagement des grandes entreprises, un assouplissement des normes environnementales et un relâchement de la surveillance, créant ainsi un vide propice à l’expansion de l’activité des Zama Zama.
Ces mineurs travaillent dans des conditions extrêmement dures, au sein d’un réseau de tunnels sans éclairage ni aération, échappant à toute forme d’organisation. Ils utilisent des outils rudimentaires pour creuser, et recourent parfois à des explosifs non réglementés, augmentant ainsi le risque d’accidents.
Dans la ville de Stilfontein, à 170 kilomètres de Johannesburg, des centaines de mineurs vivent sous terre pendant des périodes pouvant aller jusqu’à trois mois consécutifs. Ils vendent l’or qu’ils trouvent sur le marché noir et sont rémunérés par les chefs de gangs qui supervisent l’opération. Certains témoignages indiquent qu’un travailleur peut gagner entre 15 000 et 22 000 dollars par an, soit bien plus que ce qu’il pourrait espérer toucher dans un emploi formel du secteur.
L’Afrique du Sud mais pas seulement…
Mais ces gains ne sauraient masquer la dureté de ce travail. Certains évoquent des lieux souterrains surnommés « la tombe des Zama Zama », où des travailleurs morts n’ont jamais pu être extraits. Des cas d’enlèvements ont également été signalés : des mineurs contraints de travailler dans des conditions proches de l’esclavage. En l’absence de toute autorité, les gangs contrôlent tous les aspects de la vie dans les mines, surveillant les travailleurs 24h/24 et les obligeant à remettre tout l’or trouvé contre un salaire hebdomadaire ou bimensuel.
Ce phénomène ne se limite pas à l’Afrique du Sud. Il concerne également plusieurs autres pays africains comme le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et la République démocratique du Congo. Rien qu’au Ghana, on estime à 4,5 millions le nombre de personnes impliquées dans l’économie informelle de l’orpaillage. Bien qu’il s’agisse d’une activité illégale, elle constitue une source de revenus essentielle pour des millions de pauvres, dans un contexte de déclin agricole, d’absence de développement en zones rurales et de manque de protection sociale. Cependant, cette activité provoque aussi de graves dommages environnementaux à cause de l’usage de substances toxiques comme le mercure et le cyanure, polluant sols et nappes phréatiques, et sapant les efforts de développement durable.
Et si une approche strictement sécuritaire ne suffit pas à traiter ce phénomène, il est nécessaire d’adopter un cadre législatif et réglementaire qui prenne en compte la réalité de la pauvreté, en réintégrant l’exploitation artisanale dans l’économie formelle, tout en garantissant un minimum de conditions de sécurité, de santé et de justice. Car le problème, en essence, ne concerne pas uniquement l’or, mais aussi les droits humains, la justice sociale et la redistribution des richesses dans un continent qui possède tant, alors que des millions de ses habitants vivent avec si peu.