National
Réforme universitaire : grandes ambitions et moyens inadaptés Par Bilal TALIDI

Abdellatif Miraoui (photo) a porté un projet de réforme d’apparence étincelant et opté pour une stratégie séduisante mais, pour n’en avoir pas correctement évalué les contours en rapport avec la réalité et pour n’avoir pas osé le changement d’une loi archaïque portant sur l’organisation de l’enseignement supérieur, il n’a trouvé d’autres issues que d’appeler à la rescousse les doctorants en vue de combler le déficit des enseignants, sans peut-être en mesurer toutes les conséquence
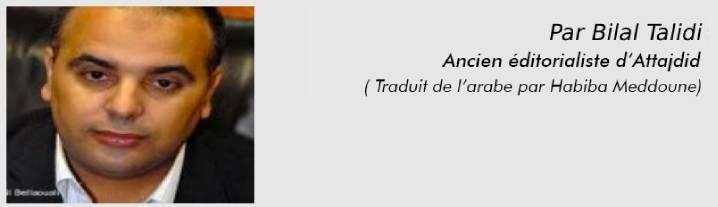
Il y a deux ans, le ministre de l’Enseignement supérieur Abdellatif Miraoui, a longuement parlé de la réforme pédagogique universitaire, en s’arrêtant à plusieurs reprises sur des décisions qu’il avait prises, afin d’en défendre le sérieux et de mettre en exergue la fermeté avec laquelle il comptait déployer sa stratégie de réforme.
Il s’agit, entre autres, de la décision relative à l’arrêt des postes de transformation, sous prétexte que les fonctionnaires contribuaient à affaiblir le niveau des apprentissages académiques, et au prérequis exigeant la maîtrise préalable d’une langue étrangère pour l’obtention d’un diplôme universitaire.
En réalité, les évolutions que connaissent les fonctions des universités de par le monde exigent du milieu académique marocain une adaptation et une intégration rapides dans la génération des nouvelles universités qui se concentrent plus sur les compétences de la vie et des soft-skills, en orientant les unités d’enseignement vers les nouveaux métiers, qui attirent un nombre important de compétences et répondent mieux aux attentes du marché de l’emploi, sachant que c’est de cette adaptation que dépend l’amélioration du classement international de l’université marocaine.
Sous cet angle, on ne peut que soutenir les grandes lignes que promet la conception de M. Miraoui en matière de réforme pédagogique. Encore faudrait-il que les ressources humaines sur lesquelles il compte s’appuyer pour faire aboutir cette réforme, soient à la mesure du challenge.
Les statistiques indiquent que le personnel académique dans les universités s’élève à 15 000 enseignants et qu’il faudrait, à l’horizon 2027/2028, plus de 1500 enseignants chaque année pour combler le déficit occasionné par le départ à la retraite d’entre 2 000 et 3 000 enseignants par an.
Et s’il est certainement possible de combler le déficit au plan quantitatif, le problème se pose avec acuité au niveau de la qualité des effectifs. C’est que les personnes concernées par la retraite sont toutes titulaires du titre d’enseignant du cycle supérieur, l’épine dorsale de la majorité des programmes de formation, d’encadrement et de la recherche scientifique. Car la loi octroie exclusivement à l’enseignant du cycle supérieur le titre de coordinateur des Unités de recherches, ainsi que dans les filières des Masters et des centres de Doctorat, ce qui en fait l’axe nodal de l’équipe pédagogique universitaire. Dès lors la question de leur remplacement pas des compétences qui leur sont égales devient bien plus difficile au vu de la réalité universitaire aujourd’hui.
Les statistiques ajoutent une touche supplémentaire à ce tableau en pointant une dissymétrie entre deux indicateurs ; en l’occurrence la baisse du taux d’encadrement en raison de l’hémorragie du départ à la retraite des enseignants universitaires et l’augmentation du nombre des étudiants à raison de 7% au cours des dernières années.
Avant l’arrivée de M. Miraoui, le ministère de l’Enseignement supérieur alliait deux types de recrutement, à savoir les postes de création au nombre de 700 postes budgétaires et les postes de transformation au nombre de 800, soit un total de 1500 postes budgétaires. Ce qui était suffisant pour assurer l’équilibre dans le taux d’encadrement.
Or, fait surprenant, M. Miraoui rejette de façon catégorique les postes de transformation réservés aux fonctionnaires, alors qu’il a accepté, de manière incompréhensible, de remplacer ces postes par des postes de doctorants à travers le régime contractuel qui leur garantit des émoluments de 7 000 Dh par mois pour les cours dispensés.
Nulle objection à l’idée de qualifier, d’accompagner et d’encadrer scientifiquement cette catégorie de doctorants et de les doter des compétences devant leur permettre d’accomplir leur mission d’enseignants à l’avenir. Mais, les différentes expériences mondiales, aussi bien que le simple bon entendement, montrent que cette catégorie ne peut en aucun cas se substituer aux enseignants du cycle supérieur, en matière d’encadrement, de formation, de correction et de recherche scientifique.
Dans les facultés des sciences, les doctorants sont chargés, selon les usages en vigueur, des travaux dirigés (TD) et des travaux pratiques (TP), sans jamais se voir confier la mission de dispenser des cours théoriques aux étudiants. Dans les facultés des sciences humaines, ils s’y attellent, mais toujours sous la supervision d’un prof universitaire. De là à les catapulter, comme il en est advenu avec M. Miraoui, pour assurer les cours et l’encadrement dans les filières de licence, ou encore dispenser les matières principales censées relever de la compétence de l’enseignant universitaire, il y a plus qu’un pas qui a été incompréhensiblement franchi.
Les doctorants ont besoin, particulièrement dans le contexte connu du déclin de la qualité de l’enseignement pré-universitaire, d’un degré élevé d’accompagnement scientifique et de supervision précise afin de pouvoir réaliser leurs thèses dans le respect des standards scientifiques et académiques. Nombreuses sont en effet les thèses soutenues récemment qui confirment qu’un certain nombre de ces doctorants ne sont pas encore suffisamment outillés pour assurer l’encadrement et la formation des étudiants. M. Miraoui leur a ouvert grandes les portes en vue de combler le déficit des enseignants, au risque de renier les conditions fermes qu’il avait brandies contre les postes de transformation réservés aux fonctionnaires.
Pourtant, les indicateurs d’évaluation au sein de son propre département révèlent une grande différence entre cette catégorie et les fonctionnaires du ministère de l’Education nationale ayant intégré l’enseignement supérieur. Ces derniers se sont révélé les plus qualifiés et les plus compétents en raison de leur expertise et de leur savoir-faire scientifique. Certes, les fonctionnaires qui occupaient des fonctions administratives dans nombre de secteurs avant de rejoindre les rangs de l’université n’ont pas été très probants et ont même grandement contribué à la baisse du niveau des apprentissages, mais fallait-il étendre les résultats de cette évaluation sectorielle aux fonctionnaires du département de l’Education nationale dont les indicateurs témoignent de leur compétence.
Il ne s’agit pas ici de prendre parti pour une catégorie contre une autre, mais force est de constater qu’il existe un vrai fossé entre les grands objectifs affichés de la réforme pédagogique universitaire et les moyens mobilisés pour la réaliser.
Deux autres problèmes compliquent davantage la situation : le premier concerne les diplômés qui ont obtenu leur doctorat et le second porte sur la mobilisation de compétences de l’étranger pour renforcer le personnel de la formation et de la recherche scientifique au sein de l’université.
Les statistiques en lien avec le premier problème sont effrayantes. Alors que l’université marocaine avait pour ambition d’atteindre entre 4 000 et 5 000 titulaires de doctorat chaque année, ce nombre ne dépasse guère 1500 diplômés, dont près de la moitié (700) appartiennent aux filières de la médecine, dont la majorité des lauréats choisit l’expatriation pour ne pas dire la migration. Ce qui fait que l’université marocaine forme un nombre limité de diplômés qui ne répond pas aux besoins de toutes les spécialités et sue au service d’autres marchés d’emploi au lieu du marché national.
Le deuxième problème tient au fait que l’université est régie aujourd’hui par une loi vétuste vieille de plus de 23 ans, la loi cadre 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur devenue désormais en déphasage avec les transformations que connaît le milieu universitaire de par le monde, autant en termes de fonctions, de missions, d’incitations financières et d’ouverture sur l’innovation et les expertises. Ce qui induit des questions incontournables : comment peut-on attirer des compétences qui travaillent sur des fonctions universitaires de nouvelle génération avec une loi qui adopte toujours des fonctions académiques traditionnelles ? Comment une loi archaïque peut-elle attirer de l’étranger un expert disposant du niveau requis pour améliorer le niveau de l’université marocaine et lui demander de commencer par une carrière de maître-assistant pour un salaire de moins de 15 mille dirhams, alors qu’il gagne à l’étranger, dans des conditions meilleures, un salaire déjà plus attractif pour les nationaux ?
En définitive, M. Miraoui a porté un projet de réforme d’apparence étincelant et opté pour une stratégie séduisante mais, pour n’en avoir pas correctement évalué les contours en rapport avec la réalité et pour n’avoir pas osé le changement d’une loi archaïque portant sur l’organisation de l’enseignement supérieur, il n’a trouvé d’autres issues que d’appeler à la rescousse les doctorants en vue de combler le déficit des enseignants, sans peut-être en mesurer toutes les conséquences sur la qualité des apprentissages, de l’image de l’université et de son classement à l’international.





















