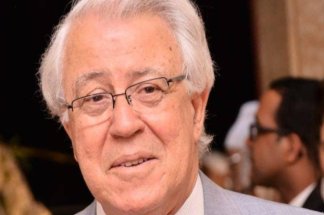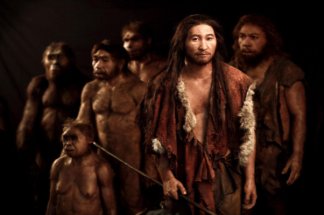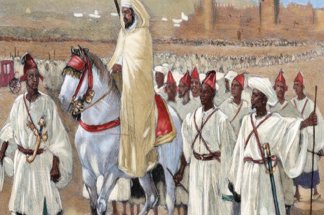chroniques
Du succès bancaire en Afrique à l’influence économique : un virage à construire – Par Adnan Debbarh

La présence bancaire marocaine en Afrique est souvent saluée comme un franc succès. Discrète mais solide, elle s’étend du nord au sud du continent. Mais une question s’impose de plus en plus : à qui profite cette présence ? Et surtout, à quoi sert-elle dans notre propre vision nationale ?
Le succès des banques marocaines en Afrique est indéniable, mais leur impact réel sur l'économie nationale interroge Adnan Debbarh qui plaide pour une redéfinition stratégique : faire de ces relais puissants non seulement des outils de rentabilité, mais des leviers d'intégration continentale et de projection économique marocaine.

Avec plus de 1 200 agences réparties sur le continent, les banques marocaines ont su s'imposer comme des acteurs majeurs de la finance en Afrique. Leur présence est particulièrement notable en Afrique de l'Ouest, où elles détiennent une part significative des dépôts bancaires. De plus, une portion importante de leurs résultats provient de leurs activités africaines. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants se cache un paradoxe : moins de 5 % de leurs financements profitent à des entreprises marocaines. Nous avons conquis l’Afrique… sans nos propres soldats économiques : les PME.
La présence bancaire marocaine en Afrique est souvent saluée comme un franc succès. Discrète mais solide, elle s’étend du nord au sud du continent, dans les capitales comme dans les régions reculées, tissant des réseaux de confiance, finançant des économies locales, accompagnant des entrepreneurs africains dans leur quotidien. Mais une question s’impose de plus en plus : à qui profite cette présence ? Et surtout, à quoi sert-elle dans notre propre vision nationale ?
Il est temps d’entamer le débat. Pas pour critiquer, ni pour troubler l’ordre actuel des choses, mais pour évaluer en conscience si cette projection extérieure de nos banques est à la hauteur des défis d’aujourd’hui et des aspirations collectives de demain.
Le Maroc s’implique profondément dans la construction africaine. Sa diplomatie est résolue, son engagement sur les grands chantiers du continent est reconnu. Mais nos entreprises, elles, peinent à suivre le rythme.
Pourquoi ce décalage entre la vitalité de notre système bancaire à l’étranger et la faible internationalisation de nos filières productives ? Pourquoi nos banques, si performantes à l’échelle continentale, semblent-elles évoluer sans réel dialogue avec les besoins stratégiques du pays et de ses entreprises ? Pourquoi ne voit-on pas plus de synergies, de complémentarités, de projets conjoints ?
Certains répondront que les banques sont des entreprises privées, qu’elles agissent selon leurs intérêts, leurs équilibres et leurs analyses de risques. C’est vrai. Mais cela ne suffit plus. Dans un monde fragmenté, instable, où la souveraineté économique devient une exigence vitale, peut-on encore concevoir qu’un pan aussi stratégique de notre présence internationale évolue sans cap national, sans boussole collective, sans vision partagée ?
Ce questionnement n’est pas propre au Maroc. D'autres nations, dans l’histoire, ont utilisé leurs systèmes bancaires comme levier d’influence, comme soutien à l’export, comme moteur d’expansion économique. Certaines ont même instrumentalisé leurs banques jusqu’à l’absurde, faisant d’elles des outils d’assujettissement plus que de coopération. L’Afrique porte encore les stigmates de ces logiques-là. Il ne s’agit pas de répéter ces erreurs, mais d’inventer un modèle nouveau, équilibré, respectueux, fécond pour toutes les parties.
Peut-on imaginer un jour que les filiales de nos grandes banques africaines deviennent les premières promotrices de l’investissement marocain en Afrique ? Qu’elles soient capables d’identifier des opportunités, de conseiller les PME marocaines, de les accompagner dans la durée ? Peut-on rêver d’un système où les banques ne se contentent pas de croître dans les bilans, mais contribuent activement à la projection de nos savoir-faire, de nos filières, de nos talents ? Un système qui n’oppose pas logique de rentabilité et intérêt national, mais les conjugue dans une perspective d’intégration continentale ?
Ces questions sont d’autant plus urgentes que le contexte international change. Les grandes puissances se replient, les chaînes d’approvisionnement se réorganisent, les alliances se reconfigurent. L’Afrique devient un terrain de compétition féroce, entre Chine, Russie, Turquie, États-Unis, Union européenne. Le Maroc, lui, avance avec constance, mais ses outils doivent évoluer. Une diplomatie sans économie n’a pas d’ancrage. Et une économie sans relais stratégiques ne peut s’imposer dans la durée.
C’est peut-être ici que réside notre point aveugle. Nous avons des banques africaines… mais pas encore un projet africain dans lequel les inscrire. Nous avons des implantations solides… mais pas de stratégie partagée entre l’État, les banques et les entreprises. Nous avons la confiance de nombreux pays frères… mais nous n’en faisons pas toujours un moteur de codéveloppement.
Le moment est venu d’ouvrir un débat serein, mais ambitieux. Non pour imposer, mais pour proposer. Non pour restreindre, mais pour orienter. L’Afrique de demain se construira avec les Africains. Et le Maroc, s’il veut y jouer un rôle à la mesure de son histoire, de ses choix souverains et de ses ambitions, doit penser ses instruments à cette échelle. Nos banques peuvent être plus que des institutions financières : elles peuvent devenir des vaisseaux d’une ambition collective.
Mais pour cela, encore faut-il que le système bancaire accepte de se penser comme un acteur stratégique du développement régional, et non comme un simple opérateur financier. Encore faut-il que l’État joue son rôle de stratège et de coordinateur, en créant les conditions d’un dialogue fécond et respectueux. Encore faut-il que nos entreprises, grandes ou petites, soient encouragées à penser l’Afrique non comme une terre de conquête, mais comme un prolongement naturel de notre avenir partagé.
Car en fin de compte, la question est simple : à quoi sert d’être présent si l’on n’est pas utile ? Et à quoi bon être utile si l’on n’est pas solidaire ?
Le chantier est immense, mais l’élan est là. Il ne s’agit pas de plaquer un modèle extérieur, ni de forcer une intégration artificielle. Il s’agit de bâtir un projet marocain et africain, enraciné dans la confiance, la réciprocité et la co-construction. Et pour cela, il faudra peut-être accepter de remettre en question certaines routines, certains cloisonnements, certaines indifférences.
Le Maroc a les moyens d’ouvrir ce débat. Il en a la légitimité, l’expérience, et l’horizon. Encore faut-il qu’il en ait la volonté.