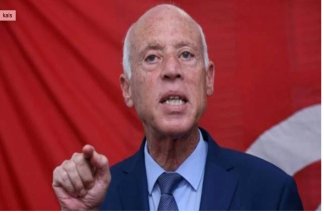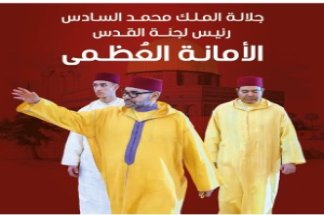International
Les nouveaux tarifs douaniers américains : une politique à hauts risques aux conséquences mondiales – Par Hassan Zakariaa

Une photo qui a fait le tour du monde, Trump brandissant un tableau des nouveaux tarifs douaniers appliqués aux pays partenaires », à la Maison Blanche à Washington, DC, le 2 avril 2025. Trump s'est préparé à dévoiler de nouveaux droits de douane radicaux pour le « Jour de la libération », ce qui risque de déclencher une guerre commerciale mondiale dévastatrice. (Photo / AFP)
Par Hassan Zakariaa
Les nouveaux tarifs douaniers américains secouent le commerce mondial, provoquant tensions diplomatiques, réactions en chaîne et incertitudes économiques. Hassan Zakariaa compile et analyse l’action et les réactions.
Washington, Bruxelles, Pékin, Séoul, Tokyo, Londres, Berlin, Buenos Aires – Le 2 avril, le président américain Donald Trump a décrété unilatéralement une série de mesures tarifaires visant à corriger ce qu’il qualifie de "déséquilibres systémiques" dans les échanges commerciaux internationaux. Ce geste spectaculaire, annoncé comme un "Jour de la Libération" pour l’économie américaine, marque un tournant majeur dans la politique commerciale des États-Unis et déclenche une onde de choc planétaire.
Le nouveau dispositif prévoit une taxe de 10 % sur ‘’tous’’ les biens importés aux États-Unis, à laquelle s’ajoute une surtaxe spécifique, allant jusqu’à 46 %, ciblant 60 pays accusés de maintenir des barrières commerciales "inacceptables". La Chine, principal excédentaire vis-à-vis des États-Unis avec 295 milliards de dollars en 2024, se voit infliger un tarif de 34 %, suivie par l’Inde (26 %), le Japon (24 %), l’Union européenne (20 %) et le Vietnam (46 %). Si le Canada et le Royaume-Uni s’en tirent avec des ‘’hausses modérées’’ ou différées, la portée globale des décisions américaines est considérable.
Une stratégie offensive aux motivations politiques et économiques
L’administration Trump justifie ces mesures par la nécessité de protéger l’économie américaine, en particulier l’industrie manufacturière, de ce qu’elle perçoit comme une concurrence déloyale. Le président affirme vouloir rétablir la "réciprocité" commerciale et réduire le déficit extérieur américain, qui s’élevait à près de 900 milliards de dollars en 2024.
Ce changement de cap s’inscrit dans une logique électoraliste, mais pas seulement. En agitant la bannière du protectionnisme, Trump s’adresse certes directement à sa base : ouvriers industriels, petits entrepreneurs, électeurs des zones désindustrialisées. Il entend leur offrir un symbole fort : la reconquête de la souveraineté économique américaine. Mais au-delà de cette dimension, Trump déploie une doctrine globale qui sous-tend son MAGA (Make America Great Again) porté par le césarisme (de César), un mouvement qui a ses ‘’philosophes’’ glorifiant le chef suprême et qu’il entend étendre à la gestion des affaires mondiales.
Mais au-delà du symbole, et du retour à l’impérialisme pure et dure, les risques économiques sont multiples. L’effet boomerang d’un tel isolement tarifaire pourrait non seulement renchérir les prix pour les consommateurs américains, mais aussi exposer les entreprises exportatrices américaines à des représailles. Les premières ripostes internationales : entre fermeté et prudence
Chine : une ligne rouge franchie
La réaction la plus vive est venue de Pékin. La Chine a dénoncé des mesures "unilatérales et subjectives" qui bafouent les règles de l’OMC. Le ministère du Commerce a promis des contre-mesures "résolues" pour défendre ses intérêts économiques. La suppression de l’exemption de droits pour les colis de moins de 800 dollars – dont bénéficiaient des géants du e-commerce comme Shein ou Temu – est particulièrement perçue comme une attaque frontale.
Outre les surtaxes sur des produits stratégiques (automobiles, acier, panneaux solaires), cette nouvelle salve douanière ravive le spectre d’une guerre commerciale ouverte entre les deux plus grandes économies mondiales. Un conflit que ni l'une ni l'autre ne peut se permettre sans dommages collatéraux.
Japon et Corée : pragmatisme diplomatique, inquiétude économique
Le Japon, allié traditionnel de Washington, a exprimé son "profond regret" face à cette politique jugée contradictoire avec les engagements bilatéraux. Malgré les investissements massifs japonais aux États-Unis – jusqu’à 1.000 milliards de dollars annoncés –, Tokyo devra faire face à un tarif de 24 % sur ses exportations, sans exemption pour son industrie automobile, pourtant essentielle à son économie.
À Séoul, même ton d’alerte. Le président Han Duck-soo a convoqué ses ministres pour mobiliser toutes les ressources diplomatiques afin de contenir les effets de cette tempête commerciale. L’impact immédiat se fait déjà sentir : l’indice Kospi a chuté de 3 %, tandis que les valeurs phares comme Samsung ou LG ont dévissé en Bourse. La taxation des produits en provenance du Vietnam, où sont implantées de nombreuses firmes coréennes, vient aggraver le tableau.
Union européenne : une riposte voulue stratégiquement unitaire et volontariste
Face à Washington, l’Europe tente de faire front commun. Ursula von der Leyen a vivement critiqué une décision "désastreuse pour l’économie mondiale" et appelle les États-Unis à "passer de la confrontation à la négociation". Un nouveau paquet de contre-mesures est à l’étude, notamment pour répondre aux taxes sur l’acier.
L’Allemagne, première puissance exportatrice du continent, défend une réponse "équilibrée, claire et déterminée". Olaf Scholz a dénoncé une "attaque contre l’ordre commercial mondial", tandis que la Fédération de l’industrie allemande (BDI) évoque des risques pour "la stabilité, l’emploi et l’innovation".
L’Italie, par la voix de Giorgia Meloni, s’oppose, elle aussi, à ce qu’elle qualifie de "mesure erronée", tout en appelant à éviter une escalade. Une position qui illustre les tensions internes en Europe entre fermeté et volonté de dialogue.
Royaume-Uni : entre sang-froid et incertitude
Avec un tarif de seulement 10 %, Londres s’estime "relativement épargnée". Le Premier ministre Keir Starmer a promis de réagir "avec calme", tout en reconnaissant que l’impact sera significatif. Son gouvernement espère négocier un accord commercial pour lever ces barrières. Mais les milieux d’affaires restent prudents : dans un contexte post-Brexit, tout choc commercial fragilise un peu plus une économie britannique déjà en quête de nouveaux équilibres.
Les Amériques : choc différencié et réponses variables
Canada : sous tension malgré l’accord de libre-échange
Le Canada est officiellement exempté des surtaxes générales, mais les produits en dehors de l’accord de libre-échange nord-américain sont taxés jusqu’à 25 %. Ottawa réagit avec fermeté. Le Premier ministre Mark Carney promet des contre-mesures ciblées et dénonce un bouleversement fondamental de l’ordre commercial mondial. Pour un pays dont 76 % des exportations vont vers les États-Unis, la dépendance est telle que chaque modification tarifaire est potentiellement dévastatrice.
Amérique du sud : diversification et incertitudes
En Argentine, le président Javier Milei, un chantre pourtant du trumpisme, cherche à éviter l’affrontement tout en prônant le principe de réciprocité. Le Brésil, cible potentielle, a d’ores et déjà adopté une loi pour riposter. Le Chili, exportateur majeur de cuivre, s’inquiète des effets indirects sur les cours mondiaux.
Au Pérou et en Colombie, les gouvernements minimisent pour l’instant l’impact, mais reconnaissent que des secteurs sensibles, comme le cuivre ou les produits agricoles, pourraient être touchés si les mesures s’intensifient.`
Une mondialisation en crise
La multiplication des barrières douanières relance un débat majeur sur l’avenir du commerce international. Ce virage protectionniste marque-t-il la fin d’une ère d’ouverture ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’économie mondiale s’est structurée autour d’un consensus libre-échangiste incarné par l’OMC. Or, ce consensus est aujourd’hui mis à mal par les grandes puissances elles-mêmes.
Pour Donald Trump, le libre-échange n’est plus un objectif mais un piège. Il voit dans les déficits commerciaux le symptôme d’une faiblesse structurelle. Cette vision, largement critiquée par les économistes, ignore cependant les interdépendances complexes des chaînes de valeur mondiales. En frappant les importations, les États-Unis risquent aussi de nuire à leurs propres entreprises, qui dépendent souvent de composants ou de matières premières étrangères.
Vers une guerre commerciale mondiale
La dynamique actuelle évoque celle de 2018-2019, lorsque la précédente administration Trump avait engagé un bras de fer avec la Chine. Mais cette fois, l’ampleur des mesures, leur caractère global et la conjoncture économique mondiale – marquée par une croissance molle et des tensions géopolitiques – font craindre un enchaînement plus sévère.
La réponse des partenaires des États-Unis oscille entre volonté de dialogue et menace de représailles. Si les négociations échouent, une guerre commerciale à grande échelle pourrait s’enclencher, avec pour victimes collatérales les consommateurs, les entreprises et les économies émergentes.
Face à cette incertitude, une question demeure : jusqu’où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour redessiner, seuls, les règles du commerce mondial ?