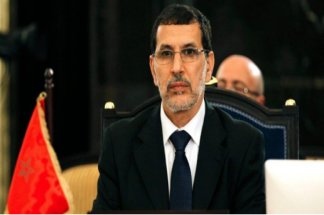Politique
Partis politiques : Pourquoi la désaffection des citoyens ?

Il était une fois la Koutla, quand les partis faisaient encore illusion. De gauche à droite : Ali Yata (PPS), Abderrahmane Youssoufi (USFP), Mhammed Boucetta (Istiqlal), Abdellah Ibrahim (UNFP) et, dernier survivant, Bensaïd A¨t Idder (OADP). Tout-à-fait à droite : Le grand absent de l’alternance consensuelle de 1998, Abderrahim Bouabid, décédé six ans auparavant après avoir mis sur les rails, avec Mhammed Boucetta, l’éphémère réunification de l’opposition.

La désaffection est certaine à l'endroit des partis politiques. Plusieurs facteurs cumulatifs poussent dans ce sens. Le premier a trait à l'insuffisance de l'encadrement qui se vérifie chez les jeunes, les femmes et dans d'autres forces vives. Une enquête du HCP, il y a quelques années, donne des indications significatives à cet égard. L'on ne compte ainsi que 1% des jeunes qui ont une carte d'adhésion à des partis. Ce phénomène se prolonge d'ailleurs dans le milieu associatif - censé être plus attractif - où les jeunes ne constituent que 4% des effectifs.
Pourquoi une telle situation ? Intervient ici un autre facteur : l'offre partisane. Celle-ci est sans doute plurielle et on peut ici distinguer entre celle faite par des partis progressistes ou nationalistes ( l’Istiqlal, USFP, PPS, PSU et FGD) et celle des partis dits "administratifs" (RNI, UC, MP et PAM). Les parcours historiques et militants des premiers les rendent-ils pour autant plus attractifs par rapport aux seconds ? C'est une question.
Un autre facteur doit être mis en relief: il porte sur la nature et la portée de l'action politique. Celle-ci pèse-t-elle réellement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques ? Par-delà le cadre institutionnel en place (parlement, gouvernement, secteur public ou semi-public,...). Les véritables centres de décision ne sont-ils pas ailleurs, là ou le contrôle démocratique fait défaut ? Référence est faite notamment à des centres de fait de grands groupes privés et la technostructure qui ont la haute main sur la vie économique nationale…
Si bien que le désintérêt des citoyens est sans doute l'illustration de ceci : en l'état, avec une telle pratique, l'action politique est peu productive ; elle n'est pas un vecteur ni un levier de changement. D'où des dynamiques sociales de changement, parfois sous forme contestataire, hors du champ institué (hirak, Jerada, boycott,...) lesquelles traduisent de la vitalisation de mobilisations d' "en bas"...
Il faut faire référence à la place et au rôle des élections, elle peut être alors entendue comme le surdimensionnement du scrutin dans la vie politique. Il est vrai que de ce point de vue, l'on peut se demander si la finalité première des partis - ou à tout le moins de la majorité d'entre eux - n'est pas de "faire du chiffre" lors des élections. Cette quête d'un chiffrage, en amont donc, ne se fait pas dans des conditions sincères et régulières. Deux facteurs différents sont décisifs à cet égard : l'intervention de l'administration sous des formes diverses et l'achat de voix avec de l'argent, qualifié souvent de « sale »…
C'est dans ce sens -là, me semble-t-il, que l'élection qui est pourtant l'expression la plus achevée de la démocratie et donc de la citoyenneté ne permet pas vraiment - et c'est un paradoxe - de consolider la construction démocratique. Les citoyens ne l'ignorent pas avec un modeste taux de participation de 43% au scrutin législatif du 7 octobre 2016 pour 15.700.000 électeurs inscrits. Ce palier ne va-t-il pas se retrouver en 2021 ? L'état des lieux aujourd'hui permet-il d'écarter cette interrogation ? Il ne faut pas minorer le sens et la portée du vote et des élections - la démocratie c'est le vote libre ! Pour autant, le vote doit faire sens, permettre de choisir après une délibération, donner l'occasion d'adhérer à un programme, à des objectifs, à des réformes pouvant être conduites et mises en œuvre par des élus. Est-ce le cas aujourd’hui ?
Ce phénomène d'affaissement de la fonction de représentation devant être assumée par les partis politiques ne signifie pas pour autant le déficit de la conscience civique : tant s'en faut. Avec le digital, le périmètre de la conscience civique s'est considérablement élargi ; c'est un nouvel univers qui est là et qui offre un cadre d'expression inédit. L'internaute n'a-t-il pas remplacé le citoyen d'hier ? Le "clic" et le partage paraissent ainsi être une forme avancée d'expression, déclassant dans le même temps le vote qui, lui, n'intervient qu'à l'occasion d'un agenda institutionnel tous les cinq ou six ans. Il s'en suit que ce mode digital n'est pas neutre, aseptisé, une sorte de marais ; bien au contraire, il génère des élans, des indignations, des colères ; des contestations et des mobilisations. Tout ce qui s'est passé depuis quatre ans témoigne de cette situation : le hirak du Rif, Zagora et les "émeutes de la soif", Jerada sans oublier le boycott du printemps 2018, les enseignants contractuels, les étudiants en médecine,... Autant de mobilisations sociales qui présentent ce trait commun: celui de se déployer en dehors du cadre institutionnel en place (partis, syndicats, collectivités locales, ...).
Peut-on parler de transition démocratique ? Il manque -toujours ? - une stratégie universelle dans ce domaine parce que c'est la vie sociale n'est pas prédictive. Il n'y a pas de recette magique, mais des principes. Or, au Maroc, les anciennes règles de jeu ont-elles changé ? Voit-on s'installer de nouvelles configurations stratégiques et politiques ? La gestion du système partisan a-t-elle libéré certaines contraintes et favorisé une libération de la dialectique démocratique ?