chroniques
Au commencement de Darwich était la poésie – Par Rédouane Taouil

Mahmoud Darwich (13 mars 1948 – 9 août 2008), en médaillon, l’auteur avec le poète
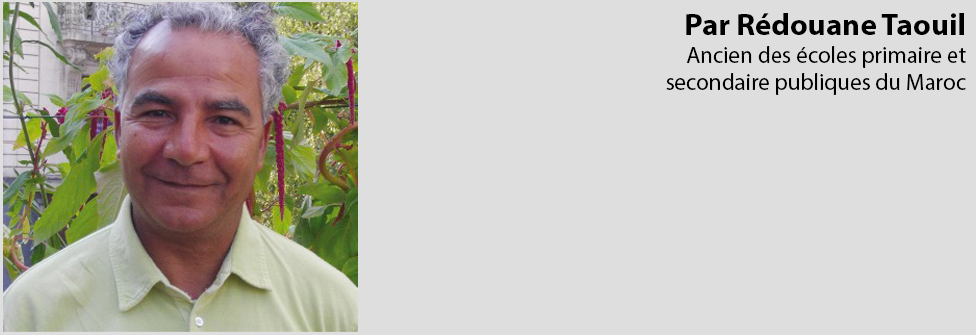
Disparu il y a quatorze ans, ce poète qui a consacré la Palestine comme une métaphore maîtresse a légué une œuvre essentielle de la poésie contemporaine aux multiples ombres inspiratrices des ascendants et des trombes de la résidence sur la terre.
C’est dans l’Andalousie, célébrée par le poète palestinien à travers la mélancolie enflammée des violons, que Ibn Shuhayd assonance son « Épître des ombres et des trombes » où il relate les souffles que lui prodigue la haute fréquentation émerveillée des vals de la langue et de la prairie des belles lettres depuis les odes du roi errant Imru Al Qays jusqu’aux séances du prodigieux Badi Zaman, et les vertiges infligés par les bourrasques de l’ici-bas. L’œuvre de Darwich possède, à l’instar de cet /épître, ses ombres inspiratrices et ses trombes accompagnatrices que sont l’arrachement au village natal et la dépossession, les meurtrissures des pertes et les rétrécissements de l’espoir, les exils et la fragilité du temps.
Les inspirateurs du chantre de l’étroitesse de la terre, depuis les « Feuilles d’olivier » en 1964 jusqu’au poème-testament « Je vois ce que je désire » reflètent un implacable engagement existentiel dans la poésie. L’oliveraie, génie de l’initiation au champ du verbe, est emblématique des stigmates de la tourbe dépossédée des pas de moineaux et des hommes, des angoisses et des attaches de l’exil, du tressage inlassable de l’espoir et de la dignité de l’endurance, de la douleur de l’arrachement et de l’odeur du caroubier qui y a échappé. « Si l’olivier se remémore/ Celui qui l’a planté/ l’huile deviendra larme ». Cet arbre, qui se pare de sa discrète pudeur et ne se dénude pas sous la tempête, évoque, volubile, les blessures originelles, la splendeur de la femme aimée mais aussi la soif inapaisée de la paix :
« Ô Noé
Donne-moi une branche d’olivier et à ma mère une colombe ».
Dans le tronc comme dans les racines résonne le génie de la terre que le poète résume prodigieusement dans un formidable oxymore qui préfigure des antonymes et consonances, des irruptions et sentences.
« Belle et immense est la terre
À travers un chas d’aiguille ».
Exiguë comme un miroir et étendue comme la langue, la terre est indéfectiblement unie aux seuils rasés par les conquérants, aux débris des corps et aux sentiers des vergers, aux essaims de deuils et aux élans des ailes battantes, aux senteurs de l’enfance et à l’empreinte indélébile du papillon, à l’eau qui pleure et rit et, aux orées de l’amour et au sel des larmes et à leur frisson. L’aimant de la métonymie de la terre fréquente volontiers le génie nourricier de la mémoire. Il se souvient pour oublier et oublie pour se ressaisir des « humeurs d’Aneth », symbole de la fertilité et de l’Histoire de la Mésopotamie et de la Méditerranée, de l’idylle des Peaux-rouges et de leurs forêts, des soupirs de Grenade, des sifflements des obus des sièges et des vertiges des aéroports, des invites du sarment. C’est grâce à de tendres exhortations ou de tristes interpellations que le poète rend hommage au génie de l’attente avec lequel il arpente les vals de l’amour et de la mort.
« Attends-là
Et ne t’impatiente pas
Si elle arrive après
Attends-là
Si elle arrive avant
Attends-là ».
L’art d’attendre l’aimée est serti de sensations inouïes et d’espérances graciles, de bonheurs friables et du polissement des heures, des fleurs de la patience et de l’effleurement de la lune, comme de paroles unies comme les sons de la flûte et du violon. « Ô mort, attends-moi à l’extérieur de la terre ». Le poète s’adresse ainsi à la souveraine du silence qui vainc mais ne contraint point l’art de chanter à se taire, l’impératif d’être à s’amoindrir et le vœu et la vocation de liberté à s’évanouir comme en témoigne la dédicace au gardien du siège à qui l’assiégé entend enseigner les marques de la mort ajournée et du chagrin qu’infusent le jasmin et la mélodie langoureuse.
« Une poésie – écrit André Velter- est ressentie, pulsée, éprouvée, mise en pensées et en actes ». Cette réflexivité parcourt de bout en bout la poétique de Darwich qui, soucieuse de renouvellement, n’a eu cesse de s’interroger sur le déploiement du langage, l’ordonnancement des images, l’ajustement des rythmes et les échos réciproques.
Qu’elle s’accompagne des ciseleurs des colliers des poèmes suspendus ou de l’inquiet chevalier du vent, Al Moutanabbi, du déçu des promesses des nuées, Jamil Boutayna, ou des strophes ornées de l’Andalus, des fervents vers des mystiques ou des jardiniers du poème moderne, la poésie de Darwich est en tous horizons une allégeance amoureuse à la langue et une fusion harmonieuse entre le lyrique et l’épique. Elle a hissé la Palestine à la hauteur de la maîtresse des métaphores et la parole poétique comme une demeure de communion :
« Voici ma langue collier d’étoiles aux
Cous de ceux que j’aime ».





















