chroniques
Quelles mains invisibles injectent la peste et contaminent les mouches ?

Les vivants d’aujourd’hui pourront témoigner, sans être pris pour des fous, qu’ils ont vécu la fin du monde. L’apocalypse se réalise à l’échelle planétaire. Aucune fraction de l’humanité n’échappe au cataclysme. Les pays s’enclosent. Les frontières se ferment. Les avions s’abandonnent sur le tarmac. Les navires se déroutent. Les peuples se terrent. Les sociétés s’immobilisent. Les économies se paralysent. La culture s’ankylose. Les théâtres, les opéras, les cinémas, les music-halls se cadenassent. Les musées, les sites archéologiques se virtualisent. Les individus s’encagent devant leur ordinateur, sans d’autre ouverture que leur lucarne à cristaux liquides.
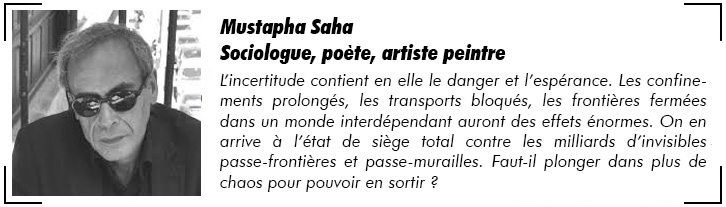
Le président, d’un ton martial, déclare la guerre au virus, et par-delà, aux velléités de résistance des réfractaires, des frondeurs, des regimbeurs, des irresponsables, des inconscients qui, faute de cafés ouverts, s’agglomèrent dans les parcs publics et les berges de la Seine. L’anaphore « Nous sommes en guerre » se martèle comme un coup de clairon. « Une guerre sanitaire ». Paradoxe des paradoxes, une guerre thérapeutique. La rhétorique jupitérienne, à force de justifier l’audace des oukases, finit par se trahir : « Jamais la France n’avait eu à prendre de telles décisions par temps de paix ». « La situation est grave, mais qu’est-ce que cela prouve ? Cela prouve qu’il faut des mesures encore plus exceptionnelles » (Albert Camus, La Peste, éditions Gallimard, 1947). La théorie microbienne des maladies impose la viralisation mentale, la moléculisation sociétale, l’atomisation totale. « L’ennemi est là, invisible, insaisissable ». La personnalisation du poison amplifie l’angoisse. « Les regroupements familiaux ou amicaux ne sont plus permis ». Les boucs émissaires sont les autres, tous les autres, condamnés préventivement pour leur proximité physique. S’invente le délit de contact. Il est désormais interdit de se tenir la main sous peine d’une forte amende. Les agents sanctionnateurs traquent sans merci les accolades, les embrassades et les promiscuités coupables. Cent mille policiers et gendarmes sont mobilisés pour effectuer les contrôles et aligner les contraventions. Se joue, à vrai dire, une répétition générale d’incarcération globale de la population.
Mustapha Saha avec Edgar Morin
L’idéologie sécuritaire s’infiltre dans l’intime sous prétexte hygiénique. Les gestes-barrières formatent les comportements et les agissements. S’entretient la phobie collective à force de dramatisations graduellement intensifiées. Se distillent les mots-clés anxiogènes. Les contraintes s’ajoutent aux contraintes jusqu’à privation de la liberté de circulation. La disciplinarisation des citoyens ne souffre aucune contestation. Se dissimule sous discours d’urgence des modalités de conditionnement de la population, d’habitation au consentement, de domestication des consciences. « Nos concitoyens se sont mis au pas. Ils se sont adaptés, comme on dit, parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont encore, naturellement, l’attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n’en ressentent plus la pointe. C’est cela le malheur. L’habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même » (Albert Camus, La Peste). Le président : « À mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra, en lien avec les éclairages donnés par les scientifiques, nous adapter ». « Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules. Mais, dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose sauvage, les signes du ciel, les visages d’été, la grande voix de la mer, les instants du déchirement et la colère des hommes… Le désespoir est un bâillon. C’est le tonnerre de l’espoir, la fulguration du bonheur qui déchirent le silence de cette ville assiégée… Détruisez vos certificats, crevez les vitres des bureaux, quittez les files de la peur, criez la liberté aux quatre coins du ciel… Jetons tous ces bâillons. Sur la terre sèche, dans les crevasses de la chaleur, voici la première pluie. Voici l’automne où tout reverdit, le vent frais de la mer » (Albert Camus, L’État de siège).
Dans sa retraite montpelliéraine, mon ami Edgar Morin allume chaque soir sa lanterne philosophique, lance de temps en temps une flèche éclairante dans la confusion twitterienne. J’assemble, combine et recombine ses aphorismes sur le coronavirus. « La prévisible imprévisibilité est arrivée. Le petit virus a déclenché sur la planète des interactions et des rétroactions innombrables. Le coronavirus a non seulement éclairé crûment l’interdépendance et la communauté de destin des peuples du monde, il la perturbe en y introduisant de nouveaux conflits. Plus je lis des informations sur le virus, sur les stratégies de lutte, sur le confinement et ses conséquences à terme, et plus je suis dans l’incertitude. Alors, il faut supporter toniquement l’incertitude. L’incertitude contient en elle le danger et l’espérance. Les confinements prolongés, les transports bloqués, les frontières fermées dans un monde interdépendant auront des effets énormes. On en arrive à l’état de siège total contre les milliards d’invisibles passe-frontières et passe-murailles. Faut-il plonger dans plus de chaos pour pouvoir en sortir ? Le Corée du Sud, où le taux de mortalité est le plus faible, a endigué l’épidémie sans confinement ni mesures coercitives. Une autre voie a été choisie : l’hygiène, la détection systématique des malades, l’information et les soins individualisés. La vie est une chose fabuleuse, étonnante, incroyable, créatrice, que l’on trivialise et banalise en la réduisant à des jeux de molécules » (Edgar Morin, mars 2020)
L’interdiction des rassemblements signifie aussi la prohibition des activités collectives, la proscription des manifestations protestatives, la répression des volontés rétives. L’inconscient collectif ingère les nouvelles lexies frustratives, le confinement, pour ne pas dire cloisonnement, enfermement, la distanciation sociale, pour ne pas dire éloignement, séparation, les gestes-barrières…. "Ce que nous devons faire en ce moment, c’est tout simplement éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n’utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles ». « Impatients de notre présent, ennemis de notre passé, privés d'avenir, nous ressemblons bien à ceux que la justice ou la haine humaines font vivre derrière des barreaux » (Albert Camus, La Peste).
L’épreuve incontrôlable, ingérable, devient une aubaine pour reprendre les cartes en main, renverser le jeu politique, faire renaître le phénix de ses cendres. La nécessité occulte l’austérité. Le golem rothschildien se rooseveltise. L’intrépide néolibéral se métamorphose en samaritain providentiel. Une société totalement paralysée n’est-elle pas le meilleur étouffoir des grèves récurrentes, des colères transparentes, des récusations populaires. La presse répercute docilement les semonces présidentielles comme des prescriptions impératives. « La presse, si bavarde dans l’affaire des rats, ne parle plus de rien. C’est que les rats meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre. Et les journaux ne s’occupent que de la rue » (Albert Camus, La Peste).
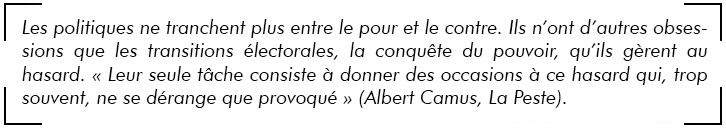
Le président s’entoure d’un Conseil scientifique, investi de prérogatives exclusives, composé de onze membres, huit médecins, un mathématicien, un sociologue, une chercheuse, tous spécialistes d’immunologie, d’infectiologie, de virologie, d’épidémiologie, de réanimation. L’encoffrage de soixante-six millions de personnes dépend d’une poignée de techniciens. L’incohérence se drape d’intransigeance. Le président du Conseil scientifique motive le confinement par l’accélération de la contagion, mais aussi par l’attitude problématique des citoyens. La raison sanitaire légitime les liberticides. On dresse le bétail. On achève bien les chevaux. Pour effectuer des achats de première nécessité, sortir pour des soins médicaux, se porter au secours d’un proche en détresse, se rendre à une activité professionnelle qui ne peut être accomplie sous forme de télétravail, il faut être muni d’une attestation de déplacement dérogatoire en bonne et due forme. «Deux ou trois médecins s’exclament. Les autres semblent hésiter. Quant au préfet, il sursaute et se retourne machinalement vers la porte, comme pour vérifier qu’il a bien empêché cette énormité de se répandre dans les couloirs… Les hypothèses, en science comme dans la vie, sont toujours dangereuses » (Albert Camus, La Peste).
Le président concède que « dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger », sauf bien entendu, pour « les personnes âgées ou affectées par des maladies chroniques comme le diabète, l’obésité ou le cancer ». Le discours équivoque, ambivalent, élusif, salue les citoyens pour leur calme et leur civisme, et les critique pour leur grogne et leur indiscipline. Le technocrate récuse méthodiquement l’imprévisible, l’insoupçonnable, l’inexplicable, tout ce qui échappe à ses planifications rigides. Et dans les situations imprédictibles, il se réfugie derrière la science. La science, rien que la science. La science comme connaissance absolue, irréfutable, irrécusable. Le Conseil scientifique est érigé en d’arbitre suprême. Tous les autres ne sont que des « experts autoproclamés ». Le président : « Les irresponsables ne deviennent pas intelligents avec un simple virus ». A bon entendeur politique, salut.
L’éponge rhétorique absorbe sans complexes ses paradoxes, ses contradictions, ses dissonances. Le virus sans passeport dicte les pires mesures protectionnistes, impose des frontières entre régions, entre villes, entre quartiers, entre personnes. « A l’intérieur même de la ville, on isole certains quartiers particulièrement éprouvés... Ceux qui y vivent considèrent cette mesure comme une brimade spécialement dirigée contre eux et pensent, par contraste, aux habitants des autres quartiers comme à des hommes libres. Ces derniers, en revanche, dans leurs moments difficiles, trouvent une consolation à imaginer que d’autres sont encore moins libres qu’eux » (Albert Camus, La Peste). Se justifient les agonies dans la solitude. « Les malades meurent loin de leur famille. On interdit les veillées rituelles si bien que celui qui est mort dans la soirée passe sa nuit tout seul... C’est au moment du malheur qu’on s’habitue à la vérité, c’est-à-dire au silence » (Albert Camus, La Peste).
Le préfet du Morbihan suspend toutes les messes, toutes les obsèques, toutes les épousailles, toutes les célébrations publiques. Les séances de catéchèse et d’aumônerie sont annulées. Les fidèles suivent les cérémonies religieuses par procuration sur les ondes de Radio Sainte Anne. L’archevêque de Paris dispense ses ouailles de l’obligation dominicale. Les curés célèbrent la Messe et les Vêpres entre eux. Pendant la confession, le prêtre garde une distance sanitaire d’un mètre avec le pénitent. « Trop longtemps, ce monde a composé avec le mal, trop longtemps, il s’est reposé sur la miséricorde divine » (Albert Camus, La Peste). Lourdes, capitale des miracles, ferme ses portes pour la première fois de son histoire. La Sainte Vierge elle-même est mise en quarantaine.
L’efficacité recommande le confinement à la source, et quand les sources se déplacent et se multiplient, c’est l’humanité entière qui se retrouve en ergastule. Les rumeurs ancestrales, les peurs séculaires, se réactivent et se répandent sur le web comme vérités éternelles. Les recommandations prophylactiques côtoient les recettes délirantes. Des mécréants se remettent à jeter du sel par-dessus l’épaule pour éloigner le virus délétère, neutraliser son mystère, amadouer les mauvais esprits. Retour spectaculaire au millénarisme. L’apocalypse s’abat sans crier gare sur le monde à la dérive. Nous voilà devant les sept plaies d’Egypte et la malédiction de pharaons. « Les eaux du fleuve se changent en sang. Les grenouilles envahissent les terres. Les poussières se transforment en moustiques. Les mouches dévorent les corps. Les sauterelles dévastent les cultures. Les troupeaux périssent. Le pays entier plonge dans les ténèbres » (Le Livre de l’Exode). La mémoire collective intériorise d’ors et déjà le coronavirus comme un désastre historique. Les réseaux internétiques donnent au fléau une ampleur mythique. La charge émotionnelle prend une démesure tétanisante. Le terreau des légendes se fertilise. Le traumatisme partagé annonce des ruptures irréversibles. « A mesure que les jours passent, on se met à craindre que ce malheur n’ait véritablement pas de fin et, du même coup, la cessation de l’épidémie devient l’objet de toutes les espérances. On se passe ainsi diverses prophéties de mages et de saints. Des imprimeurs voient très vite le parti qu’ils peuvent tire de cet engouement… Lorsque l’histoire elle-même est à court de prophéties, on en commande aux journalistes qui, sur ce point au moins, se montrent aussi compétents que leurs modèles des siècles passés » (Albert Camus, La Peste).
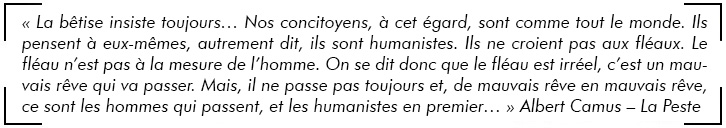
Le président : « Je vous demande de continuer à faire des sacrifices et plutôt d’en faire davantage pour notre intérêt général ». « Le prêche rend plus sensible à certains l’idée, vague jusque là, qu’ils sont condamnés pour un crime inconnu à un emprisonnement inimaginable… La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la peste » (Albert Camus, La Peste). Le président : « Nous fermons, sans délai, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes aiguës de la maladie ». Une jeunesse entière cloîtrée par principe de précaution. « Ce n’est pas la loi qui compte, c’est la condamnation… Si c’était un tremblement de terre ! Une bonne secousse et on n’en parle plus. On compte les morts, les vivants, et le tour est joué. Mais cette cochonnerie de maladie ! Même ceux qui ne l’ont pas la portent dans le cœur » (Albert Camus, La Peste).
Les politiques ne tranchent plus entre le pour et le contre. Ils n’ont d’autres obsessions que les transitions électorales, la conquête du pouvoir, qu’ils gèrent au hasard. « Leur seule tâche consiste à donner des occasions à ce hasard qui, trop souvent, ne se dérange que provoqué » (Albert Camus, La Peste). Je pense à ce dialogue entre Denis Diderot et Jean Le Ronde d’Alembert : « Diderot : Croyez-vous qu’il y ait une seule question discutée sur laquelle un homme reste avec une égale et rigoureuse mesure de raison pour et contre. D’Alembert : non, ce serait l’âne de Buridan ». L’âne de Buridan ou l’allégorie selon laquelle un âne est mort de soif et de faim parce qu’il n’a su choisir entre le sceau d’eau à sa droite et le pot d’avoine à sa gauche. « Diderot : en ce cas, il n’y a donc point de sceptique, puisqu’à l’exception des questions de mathématiques, il y a du pour et du contre dans toutes les autres. La balance n’est donc jamais égale, et il est impossible qu’elle ne penche pas du côté où nous croyons le plus de vraisemblance. D’Alembert : Mais, je vois le matin la vraisemblance à ma droite, et l’après-midi, elle est à ma gauche. Diderot : C’est-à-dire que vous êtes dogmatique pour le matin, et dogmatique contre l’après-midi. D’Alembert : Et le soir, quand je me rappelle cette circonstance si rapide de mes jugements, je ne crois rien, ni du matin, ni de l’après-midi. Diderot : C’est-à-dire que vous ne vous rappelez plus la prépondérance des deux opinions entre lesquelles vous avez oscillé, que cette prépondérance vous paraît trop légère pour asseoir un sentiment fixe…» (Diderot : Le Rêve de d’Alembert, 1769, éditions Marcel Didier, 1951).
Nous sommes, dans tous les domaines, dans la fabrique du doute. Le néolibéralisme confectionne, avec un art consommé, des rideaux de fumée pour transformer le mal en bien et le bien en mal. La fabrique du doute, conçue par l’industrie du tabac dans les années cinquante, génère des lobbyings redoutables. Les laboratoires pharmaceutiques financent les fausses études scientifiques, manipulent les protocoles méthodologiques, instillent la perplexité dans les esprits, corrompent les décideurs politiques, contrecarrent furieusement l’interdiction des médicaments toxiques. Il est pourtant prouvé que le paracétamol, molécule présente dans deux cents analgésiques, prise à forte dose, détruit irrémédiablement le foie. L’Agence du médicament se contente d’inciter les fabricants à inscrire un avertissement sur les boîtes. L’endoctrinement des consommateurs transite par les médias sans scrupules. Les substances nuisibles s’écoulent librement dans les pharmacies. Il en va de même pour les pesticides, les organismes génétiquement modifiés (OGM), les additifs alimentaires léthifères… Il est avéré que le bisphénol, composé chimique utilisé massivement dans la fabrication des plastiques et des résines, est cancérigène, avec des effets catastrophiques sur la reproduction, le métabolisme des sucres et des graisses, les pathologies cardiovasculaires. La société de consommation empoisonne le peuple en toute légalité malgré les rapports alarmants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).
La gestion de la crise du coronavirus révèle des projets de restructuration économique, de réorganisation sociétale, élaborés de longue date. Se dévoilent les alternatives programmées, les robotisations fantasmées, les remodelages des services publics, les virtualisations abstractives, la dislocation des sociabilités dans l’atomatisation généralisée. Les écoles se dissolvent subrepticement dans les plateformes en ligne. Le président : « Je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Nous avons beaucoup développé le télétravail. Il faut l'intensifier au maximum ». Un vieux rêve technocratique. Le télétravail, baptisé telecommuting par Jack Nilles, est perçu par le gouvernement français, dès les années soixante-dix, comme une méthode d’aménagement du territoire. Le juste-à-temps, ou flux tendu, issu du toyotisme, promu par le rapport Martin Bangemann (1994) et la commission européenne, utilise l’ordinateur personnel comme outil d’externalisation, de délocalisation, de précarisation de l’emploi. L’ordonnance du 24 septembre 2017, dont la paternité revient au président, définit comme télétravail « toute forme d’organisation dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Un simple accord épistolaire ou verbal suffit. Aucun avenant au contrat de travail n’est exigé. L’accord de l’employé n’est pas requis dans les circonstances exceptionnelles d’épidémie et de force majeure. L’inviolable « continuité de l’activité de l’entreprise » permet toutes les dérogations. Le tiers des salariés français du privé ont été placés en télétravail pendant les mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Ainsi se réalise l’intangible désirabilité patronale dans la flexibilisation des ressources humaines, l’augmentation de la productivité, la réduction des investissements, des coûts et des frais généraux, l’optimisation des profits. La logistique s’y prête. Trente millions des foyers français sont pourvus d’un Internet fixe haut débit (ADSL) ou très haut débit (fibre ou 4G). Le paradigme néolibéral instrumentalise la révolution numérique, les technologies de l’information et de la communication, pour cognitiver la machine et déshumaniser l’humain. Le brouillage du temps personnel et du temps professionnel se traduit par des pratiques internétiques addictives et des comportements autistes. Des mutualisations anciennes disparaissent. Des pathologies psychiques inédites apparaissent.
Le mea-culpa présidentiel rappelle un triste souvenir, la fameuse phrase « Mon véritable adversaire, c’est le monde de la finance » (discours du Bourget 22 janvier 2012), immortalisée, sans d’autres effets, dans les anthologies des formules démagogiques. Le président : « Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies, qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, est un bien précieux, un atout indispensable quand frappe le destin. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, nos soins, notre cadre de vie à d’autres est une folie… Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai ». Et l’on retrouve la sainte maxime des temps de guerre, « cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin ».
« La bêtise insiste toujours… Nos concitoyens, à cet égard, sont comme tout le monde. Ils pensent à eux-mêmes, autrement dit, ils sont humanistes. Ils ne croient pas aux fléaux. Le fléau n’est pas à la mesure de l’homme. On se dit donc que le fléau est irréel, c’est un mauvais rêve qui va passer. Mais, il ne passe pas toujours et, de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier… Nos concitoyens ne sont pas plus coupables que d’autres. Ils oublient d’être modestes, voilà tout. Ils pensent que tout est possible pour eux, ce qui suppose que les fléaux sont impossibles. Ils continuent de faire des affaires, ils préparent des voyages. Ils ont des opinions. Comment penseraient-ils à la peste qui supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ? Ils se croient libres. Personne n’est jamais libre tant qu’il y a des fléaux » (Albert Camus, La Peste).
Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre.
*Nouveau livre : Mustapha Saha, Haïm Zafrani, Penseur de la diversité, éditions Hémisphères / éditions Maisonneuve & Larose, Paris, 2020.
Albert Camus. Portrait. Par Mustapha Saha.
Peinture sur toile. Dimensions : 100 x 81cm.
Edgar Morin et Mustapha Saha





















