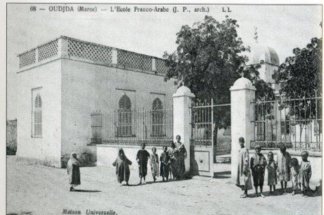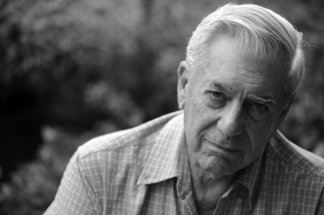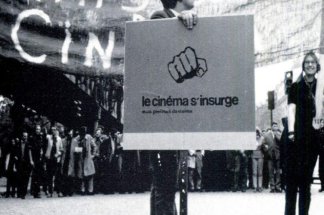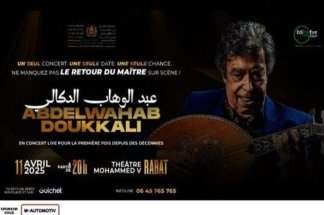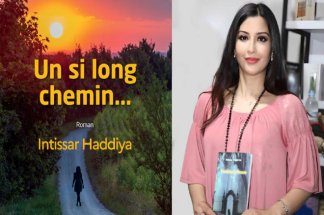Culture
Les retours - Par Samir Belahsen

Gazaouis déplacés marchant vers la ville de Gaza le 27 janvier 2025. Un flot ininterrompu a remonté la côte de Gaza le 27 janvier, transportant leurs affaires dans des sacs en plastique et des sacs de farine réutilisés à travers la ville centrale de Nuseirat (Photo AFP)

« Qui ne défend pas ses droits mérite de les perdre. »
Gérard Haas
« Si cette immigration des Juifs en Palestine avait eu pour but de leur permettre de vivre à nos côtés, en jouissant des mêmes droits et en ayant les mêmes devoirs, nous leur aurions ouvert les portes, dans la mesure où [...] »
Yasser Arafat
Les images fortes du retour vers le nord de ce qui reste de Gaza sont significatives. Elles resteront gravées dans les mémoires. J’ose espérer que la littérature ne manquera pas de s’en approprier.
Historiquement, les déplacements de populations sont marqués par des séries d'événements qui ont entraîné ces mouvements massifs de personnes à travers le monde.
Aux guerres - guerres mondiales et conflits régionaux - il faut ajouter les catastrophes naturelles, les sècheresses et les persécutions politiques. Ces phénomènes ont eu des répercussions profondes sur les sociétés, les familles et les personnes.
Les déplacements forcés ont engendré des conditions de vie difficiles pour les populations déplacées, les exposant à la souffrance, la précarité, la perte de repères culturels et parfois à la désintégration des communautés. Les déplacés sont souvent invisibilisés puis déshumanisés.
Les représentations des populations déplacées dans la littérature classique sont souvent pleines de stéréotypes faciles et de préjugés, reflétant les idées préconçues de l'époque.
Les personnages déplacés sont souvent dépeints comme des victimes impuissantes, souffrant passivement de leur situation, de leurs destins sans profondeur, sans complexité.
On utilise souvent leurs histoires comme des ressorts dramatiques pour accentuer la misère humaine, certes réelle, mais sans donner voix à leur identité et à leur expérience propre.
De rares œuvres parviennent à dépeindre ces populations déplacées de manière plus nuancée, mettant en lumière leur résistance, leur résilience, leur force et leur capacité à aimer la vie, à la reconstruire malgré les difficultés rencontrées.
On peut constater dans la littérature contemporaine, une évolution notoire des représentations des populations déplacées. Certains écrivains contemporains abordent de manière plus sensible et plus réaliste les expériences des personnes déplacées. En mettant l'accent sur les émotions, les défis et les traumatismes qu'elles rencontrent, on leur rend leur humanité. Les personnages sont plus humains, plus développés et complexes. Ils nous offrent une vision plus humaine et plus authentique de la réalité des déplacements forcés. L’approfondissement des aspects sociopolitiques des déplacements forcés donne une dimension plus nuancée à ces œuvres.
La littérature joue un rôle crucial dans la sensibilisation aux problématiques liées aux déplacements de populations en représentant de manière authentique les expériences des personnes déplacées et en suscitant de l'empathie chez les lecteurs de manière à élever la conscience collective sur cette question.
La littérature peut encourager des discours mieux informés, plus lucides et des actions concrètes pour soutenir le retour des personnes déplacées à leur communauté d'origine, à leur terre.
Leur regard artistique et leur capacité à communiquer des émotions de manière profonde sont en fait de puissants moyens de sensibilisation et de plaidoyer pour leur cause.
"Refuge" de Dina Nayeri 2017
Le roman analyse de manière approfondie les thèmes de la migration, de l'identité et des relations complexes entre un père et sa fille séparés par les circonstances. Niloo Hamidi est une jeune fille iranienne qui fuit l'Iran avec sa mère, tandis que son père y reste luttant contre l'addiction et des difficultés personnelles. Les souffrances du déplacement s’ajoutent aux autres souffrances de la vie.
Niloo et son père ne se rencontrent que quatre fois en deux décennies, Dina nous explique qu’à chaque rencontre l’éloignement fait croitre la distance émotionnelle entre fille et père. Niloo navigue en Occident entre son héritage iranien et le sentiment d'être une étrangère, elle navigue entre identité et assimilation. Elle illustre comment le traumatisme et le déplacement façonnent les identités. Le foyer : est-ce juste un lieu physique ou peut-il se trouver dans les relations avec autrui ? Elle nous explique que la quête d'identité face à la dislocation culturelle est le quotidien des réfugiés.
Retour à Haifa de Ghassan kanafani
Dans une chronique réservée à cette nouvelle sur ces colonnes, j’avais écrit : « A travers le drame singulier de cette famille, Kanafani nous montre que quand on déroule à froid les cartes de l’avancement territorial de l’entité occupante, on oublie souvent que ce sont aussi des maisons confisquées, des hommes et des femmes déplacés, des familles déchirées, des vies brisées, des drames individuels et collectifs, et des morts …beaucoup de morts. A l’origine, il y avait l’occupation, la colonisation… »
Lire aussi : Retour à Haïfa de Ghassan Kanafani - Par Samir Belahsen
La spécificité de Kanafani, c’est qu’il raconte un retour individuel provisoire pour traiter le rêve d’un retour collectif pour lequel il a offert sa vie et qui continue à être le rêve d’un peuple. Les images des Gazzaouis qui ont marché vers le nord le montrent…
En termes juridiques, Le droit au retour des palestiniens est un principe adopté dans la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies concernant les réfugiés palestiniens qui étaient 700 000 êtres humains à la suite du déplacement forcé de 1948. Leurs descendants sont estimés aujourd’hui à près de 7 millions réfugiés, principalement, dans les territoires palestiniens et en Jordanie, au Liban et en Syrie. Le président Américain « El Conquistador » projette aujourd’hui de déplacer les restants en forçant l’Egypte et la Jordanie à les accueillir.